Search results for lave

Les décors de linteaux dans l’architecture de Guimard
Nous avons été heureux de pouvoir acquérir récemment en vente publique[1] un décor de linteau en grès émaillé d’Hector Guimard édité par Bigot. Tout en le présentant à nos lecteurs, nous le replaçons dans le contexte de sa création, le comparons aux autres décors de ce type et décrivons brièvement leur évolution dans l’œuvre de Guimard. Cet article recoupe des informations contenus dans de précédents articles consacrés au stand Gilardoni & Brault de 1897, aux décors en céramique du Castel Béranger, au décor du vestibule du Castel Béranger, ainsi que dans le livre consacré à la céramique et à la lave émaillée de Guimard (éditions du Cercle Guimard, 2022).

Décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.
Rappelons que les linteaux sont des traverses horizontales reposant sur deux points d’appui au-dessus d’une ouverture ou d’une baie et ayant pour fonction de soutenir la maçonnerie. Leurs décors, qu’ils soient sculptés sur les pierres du linteau ou plaqués devant elles, sont des éléments décoratifs des façades et des intérieurs dont l’origine se confond avec celle de l’architecture. En extérieur, sous nos climats, leur colorisation était problématique et ce n’est qu’avec l’arrivée de la lave émaillée à partir des années 1830 puis de la faïence ingerçable à partir des années 1840 que des décors architecturaux colorés et résistants aux intempéries ont pu commencer à enjoliver les façades de façon pérenne. Cette offre s’est multipliée avec l’augmentation du nombre de fabriques capables de les proposer et surtout avec leur industrialisation permettant de les éditer sur catalogues. L’apparition du grès émaillé à la toute fin du XIXe siècle est venue compléter une palette de produits déjà étendue.
Dès ses premières œuvres architecturales, Guimard a créé des décors de linteaux. Celui ornant l’hôtel Roszé (1891), a été sculpté en pierre. Pour cette raison, malgré le caractère répétitif de ses motifs floraux, il a sans doute été le plus coûteux de ces petites villas de l’ouest parisien.

Décor de linteau en pierre sculptée de la travée gauche de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 34 rue Boileau à Paris XVIe (1891). Photo F.D.
Car la presque totalité de ces premiers décors, notamment au niveau des linteaux et des tympans de ces premières villas a été réalisé de façon plus économique en céramique cloisonnée d’après les dessins de Guimard. Ils ont tous été exécutés et en partie édités par Muller & Cie. On se réfèrera à notre ouvrage La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard qui les décrit entièrement pour l’hôtel Roszé (1891), l’hôtel Louis Jassedé (1893), la villa Charles Jassedé (1893), l’hôtel Delfau (1894) et la galerie Carpeau (1894-1895). Ces décors sont constitués d’éléments séparés avec motif de début, de milieu et de fin, illustrant des motifs floraux plus ou moins identifiables.

Décor de linteau de la travée de droite de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 34 rue Boileau à Paris XVIe (1891). Panneau en terre cuite émaillée cloisonnée exécuté par Muller & Cie à exemplaire unique. Photo F.D.
D’autres décors sont plus simplement composés d’éléments identiques répétés (métopes), souvent encadrés par des barres métalliques orthogonales. Avec la métope n° 13, Guimard évolue stylistiquement par rapport aux motifs précédents en évoquant la poussée d’un bouton floral repoussant ses involucres avec une stylisation qui en rend la lecture difficile au premier abord.

Décor de l’encorbellement de la travée de droite de la façade sur rue de la villa Charles Jassedé à Issy-les-Moulineaux (1893). Métopes, en terre cuite émaillée, éditées par Muller & Cie sous le n° 13 et barres métalliques. Photo F.D.
Pour les façades du Castel Béranger (1895-1898), immeuble qui a marqué son entrée dans le style Art nouveau, Guimard a également conçu des décors de linteaux. Quelques-uns sont en pierre sculptée, particulièrement épais et occupant toute la hauteur de la corniche du 4e étage de la façade sur rue.

Détail de la façade sur rue du Castel Béranger (4e travée à partir de la gauche, 3e et 4e étage). Les pavillons en tôle découpée placés sous les linteaux étaient destinés à recouvrir l’enroulement des stores (à présent disparus) et n’avaient pas de fonction structurelle. Photo André Mignard.
Mais la plupart des décors de linteaux des façades du Castel sont beaucoup plus discrets, masquant un linteau métallique par des métopes encadrées par des lames métalliques. Techniquement, Guimard agit ici dans la continuité de sa mise en place de décors de linteaux quelques années plus tôt sur l’hôtel Louis Jassedé et la villa Charles Jassedé. Mais stylistiquement, ses motifs ont évolué vers un modelage où l’évocation du monde du vivant est perceptible mais sans que l’on puisse réellement identifier une espèce, ni même la rattacher au règne animal ou végétal. Les colorations ont également changé, passant d’aplats de couleurs vives cloisonnées à des camaïeux de couleurs ocres ou bleutées fondues.

Vue partielle d’un décor de linteau avec des métopes répétées et encadrées, au niveau des façades sur rue ou sur cour du Castel Béranger, de fabricant incertain (Gilardoni & Brault ou Bigot). Photo F.D.
Comme nous l’avons établi dans le livre sur la céramique de Guimard, les décors extérieurs en céramique émaillée du Castel Béranger ont été produits par Gilardoni & Brault et non en grès par Bigot. Cependant nous savons qu’un exemplaire de cette métope a été repéré à Cour-Cheverny dans le Loir-et-Cher[2]. Sa localisation à 25 km de Mer, lieu d’implantation de l’entreprise A. Bigot et Cie, dans une zone géographique où la diffusion de Gilardoni & Brault était nulle, introduit un doute quant à son attribution. Contrairement aux autres décors en céramique des façades du bâtiment, ce modèle précis de métope pourrait donc avoir été produit par Bigot.
À l’extérieur du Castel Béranger, un autre décor de linteau est particulièrement remarquable. Il s’agit de celui qui coiffe la (ou les) devanture(s) de boutiques(s) se trouvant à l’origine au niveau des 7e et 8e travées, du côté droit de la façade[3]. Ce linteau métallique, comparable à son contemporain du préau de l’École du Sacré-Cœur[4], était visiblement destiné à recevoir une (ou deux) enseigne(s). Le décor qui le surmonte est des plus étranges. Trois groupes de deux types de métopes (un grand modèle et un petit) sont enserrés dans des cornières métalliques en arc de cercle, séparés par des motifs en tôle découpée pouvant évoquer des fleurs en boutons. Les métopes, en céramique émaillée, ont l’aspect inédit d’une matière informe et convulsive, s’écartant radicalement de la plupart des autres décors des façades qui conservent une parenté avec le monde du vivant.

Vue partielle du décor de linteau au-dessus des boutiques en façade sur rue du Castel Béranger. Métopes en céramique émaillée, produites par Gilardoni & Brault. Photo Nicholas Christodoulidis.
Ce style nouveau et propre à Guimard se retrouve largement sur les éléments en grès émaillé, cette fois produits par Alexandre Bigot, qui garnissent les parois du vestibule. Leur matière bouillonnante qui semble contenue par le strict motif de treillage en barres métalliques orthogonales présente des empreintes de doigts qui ont été enfoncées dans la terre glaise au moment de leur modelage.
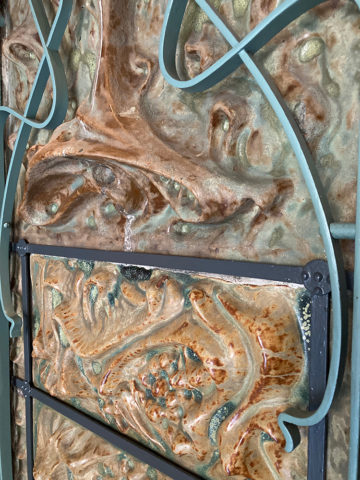
Détail d’une paroi du vestibule du Castel Béranger en grès émaillé par Bigot. Photo F.D.
C’est sans doute dans le même laps de temps (vers 1897) qu’ont été conçus les décors de linteaux en grès émaillé dont nous présentons un exemplaire en début d’article. Ils peuvent dissimuler un linteau métallique en étant placés devant lui, mais leur forme semi-elliptique les destine aussi à être mis en place sous un arc porteur en briques[5]. Cette disposition permet alors d’équiper les baies par des fenêtres à vantaux rectangulaires, plus économiques que des vantaux à traverses supérieures arquées.
Comme sur les panneaux en grès émaillé du hall du Castel Béranger, on trouve de multiples empreintes de doigts, regroupées dans de petites zones comme si ces empreintes appartenaient à une même main.

Détail d’un décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.
On retrouve sur leur tranche supérieure, tracées à la pointe, les signatures « Hector GUIMARD Arch[6] » et « A Bigot cer ». Ils sont donc signés de façon similaire à certains panneaux en grès émaillé du vestibule du Castel Béranger et aux cheminées en grès émaillé, éditées par Bigot et placées à une vingtaine d’exemplaires dans les salles à manger de l’immeuble (« GUIMARD Arch » et « A Bigot cer »).

Signatures de Guimard et de Bigot sur la tranche supérieure du décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.
Contrairement à ces cheminées du Castel Béranger, le revers de notre décor de linteau ne présente pas le logo de Bigot : une tour crénelée.

Revers du décor de linteau par Guimard en grès émaillé, édité par Bigot, vers 1897. Les cloisonnements sont nécessaires au maintien du volume avant la cuisson. On relève des traces de scellement au ciment sur les bords. Coll. part. Photo Auctie’s. Droits réservés.
L’édition de ce décor de linteau est attestée par sa présence au sein du catalogue édité en 1902 par la société A. Bigot & Cie qui le commercialisait au prix de 40 F-or. Il est annoncé en longueur courante de 1 m avec la possibilité de porter celle-ci à 1 m 30. Pour l’instant, nous ne connaissons aucun exemplaire de cette dernière longueur. Mais même dans sa dimension courante, il a sans doute été peu diffusé puisque, sauf nouvelle découverte, nous n’en connaissons aucun exemplaire en place ailleurs que sur des bâtiments de Guimard.

Linteau par Guimard, catalogue Bigot, 1902. Coll. Françoise Mary. Photo © Ceramique-architecturale.fr.
Non seulement Guimard semble avoir été le seul à utiliser ces décors de linteaux édités par Bigot, mais qui plus est, il ne les a pas employés au moment de leur conception, préférant créer à chaque fois de nouveaux modèles. C’est seulement quelques années plus tard, alors que son style avait radicalement évolué et que ces décors s’étaient dèjà fort démodés, qu’il a commencé à s’en servir. Bien qu’il ait toujours été soucieux d’harmoniser ses créations, Guimard a parfois ainsi réutilisé des éléments décoratifs plus anciens, en décalage avec l’évolution de son style, mais qui ne nuisaient pas pour autant au résultat final.
La première occurrence de leur utilisation s’est faite au Castel Val, construit en 1903 par Guimard à Auvers-sur-Oise. Plusieurs décors de linteaux ont été insérés dans les balustrades des terrasses de la villa et du garage.

Guimard au Castel Val avec Mme Chanu en août 1904. Un décor de linteau se trouve derrière son doigt levé. Photo Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.
Dans une seconde phase d’aménagement de la propriété en 1911-1912, l’architecte Eugène Daubert, sous la supervision probable de Guimard, a sans doute complété cette longue balustrade en ciment joignant la villa au garage, portant à seize le nombre de ces décors de linteaux [7]. Dans cette configuration architecturale, ils perdent alors leur signification pour ne plus être que des éléments décoratifs colorés utilisés pour ponctuer le chemin. Au fil du temps cette balustrade du Castel Val s’est dégradée et a été restaurée en 2003-2004. Le seul décor original intact qui subsistait a été moulé et des copies en ciment ont été replacées dans chaque module de la balustrade.

Copie en ciment d’un décor de linteau Guimard sur la balustrade en ciment armé construite en 1911 du Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903). L’arceau le coiffant évoque ceux en fonte des balustrades du métro de Paris. Photo Nicolas Horiot.
En 2021, lors de sa revente, le Castel Val comportait encore l’élément original exposé en intérieur. Il est possible que l’élément que nous avons acquis provienne lui aussi de la balustrade originale.

Exemplaire original de décor de linteau en grès émaillé Guimard édité par Bigot, posé en 1911 au Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903). Photo F.D.
L’autre occurrence de ces décors de linteaux en grès émaillés édités par Bigot s’est faite à deux exemplaires dans la cour de l’hôtel Deron Levent en 1907. Ils surmontent effectivement des fenêtres (au premier étage) mais, placés plus en hauteur au sein de la maçonnerie, ils perdent également leur fonction primitive, celle de dissimuler (ou d’accompagner) une poutrelle métallique industrielle. Ces dernières sont pourtant bien visibles, mais enjolivées par des décors en fontes alors créés spécialement à cet usage par Guimard et dont il sera question plus loin dans notre article.

Un des deux linteaux placés au-dessus des deux fenêtres du premier étage dans la cour de l’hôtel Deron Levent de Guimard, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GC. Photo F.D.
Très similaire à notre décor de linteau en grès émaillé, mais pourtant légèrement différent, un autre modèle a été retrouvé à deux exemplaires sur un immeuble banal, non daté et d’architecte inconnu, à Courbevoie[8] en banlieue parisienne. Scellés en linteaux de fenêtre de rez-de-chaussée, ces décors ne révèlent pas le nom de leur fabricant, mais leur attribution à Guimard ne fait aucun doute. Mesurant également un mètre de longueur et relevant donc d’une offre équivalente à celle du catalogue de Bigot, ils ont nécessairement été produits par un concurrent, le nom de Gilardoni & Brault étant sans doute le plus probable. On observe qu’ils ne comportent pas de coulures de l’émaillage comme on en trouve sur tous les décors de linteaux de Guimard édités chez Bigot.

Décor de linteau de Guimard, de fabricant inconnu, d’une paire, au rez-de-chaussée de la rue du 22 septembre à Courbevoie. Photo F.D.
Si nous revenons à présent en arrière, au moment de l’aménagement du Castel Béranger, nous retrouvons d’autres décors de linteaux et en particulier au sein de l’agence de Guimard, située au rez-de-chaussée de l’immeuble. Nous écartons de notre sujet les décors des chambranles des deux fenêtres du bureau du Guimard, assez grossièrement creusés à même la pierre.

Fenêtre du bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. Photo F.D.
De véritables décors de linteaux se trouvent sur le mur orthogonal à celui de la rue, et tout d’abord au-dessus de la porte du dégagement permettant la sortie sur cour. Guimard y a placé un décor de linteau qui est cerné par des cornières de métal découpées et coudées. Son style est proche du linteau que nous avons acheté et, si l’on se réfère à la carte postale de l’agence Guimard, ce linteau était coloré (mais pas nécessairement en bleu) probablement avec des nuances.
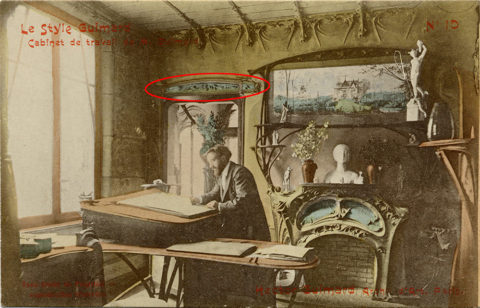
Bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger . Carte postale ancienne n° 10 de la série Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.
À l’heure actuelle, ce décor de linteau et ses cornières en métal sont uniformément peints d’une couleur verdâtre. En s’en approchant, on constate que le décor en relief n’est pas, comme on pouvait s’y attendre, en céramique mais simplement en staff.

Linteau de la porte donnant dans le dégagement permettant d’accéder à la cour dans le bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.
De l’autre côté de cette porte, dans le dégagement permettant la sortie sur cour, se trouvent deux autres décors de linteaux, jumelés à angle droit. Ils sont de même nature que le précédent (cornières et staff) et actuellement entièrement peints en blanc.

Double linteau du dégagement vers la cour de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.
Toujours dans le bureau de Guimard, mais de l’autre côté de la cheminée, une autre porte donnant cette fois dans le bureau des dessinateurs est surmontée d’un linteau. Il est d’une plus grande longueur car il englobe aussi une niche séparée de la porte par un épais pilier. Au-dessus de ce pilier, le staff modelé est remplacé par une plaque métallique savamment découpée.

Linteau englobant la porte du bureau de Guimard donnant dans le bureau des dessinateurs et une niche dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.
Le dessin des parties métalliques de ces trois derniers décors de linteaux existe dans le fonds Guimard du Musée d’Orsay. Il comporte sur sa droite un quatrième linteau qui n’est pas identifié. Ce dessin n’est pas daté mais pourrait approximativement remonter à l’année 1897, époque où Guimard a conçu l’aménagement de son agence.
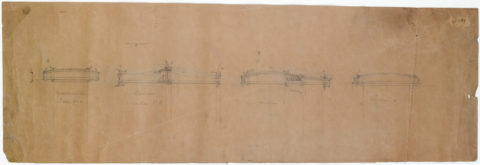
Plan des parties métalliques des décors de linteaux du bureau de Guimard dans son agence d’architecture au Castel Béranger. De gauche à droite : linteau de la porte donnant dans le dégagement, double linteau du dégagement, linteau de la porte donnant dans le bureau des dessinateurs, linteau non identifié. Vers 1897. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 584.
Face à la cheminée, un troisième décor de linteau, beaucoup plus important, surmonte la large baie séparant en deux le bureau de Guimard. Il est de même nature que les précédents, combinant les fers industriels pliés et découpés avec des surfaces modelées en staff.

Linteau de la baie de séparation du bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.
Enfin, un linteau spectaculaire sépare le bureau des dessinateurs du couloir d’entrée. Il comporte une partie centrale horizontale, comparable à celles des précédents linteaux. Mais ce sont ces consoles latérales qui assurent l’essentiel de l’effet.

Linteau entre le couloir d’entrée et le bureau des dessinateurs dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.
Guimard a reproduit ces deux consoles sur une planche consacrée à des éléments métalliques dans le portfolio du Castel Béranger et a mentionné dans les légendes : « Console en fonte des filets en fer ». Mais leur examen révèle que, comme la totalité des consoles de l’agence et des espaces communs, elles ont été moulées en staff et non en fonte. Ce choix, probablement dicté par une recherche d’économie et de facilité de mise en place, vient contredire le crédo rationaliste de Guimard[9] puisque les consoles expriment une fonction de soutien.
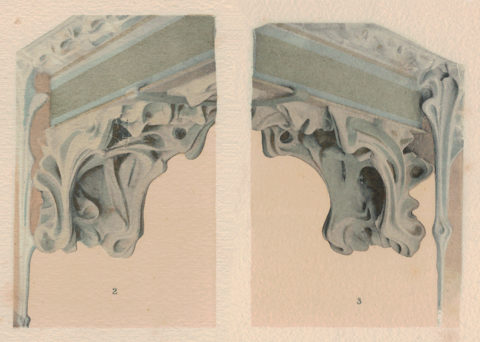
Consoles du linteau entre le couloir d’entrée et le bureau des dessinateurs dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. Photomontage par infographie de deux illustrations de la planche 51 du portfolio du Castel Béranger.
Toujours en 1897, Guimard est chargé de la construction du stand Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique. Comme nous l’avons vu précédemment, lors de la phase de décor du Castel Béranger, il a sollicité cette tuilerie implantée à Choisy-le-Roi. L’entreprise, dotée d’un solide savoir-faire en matière de décor architectural, lui a alors fourni les décors externes et une partie des rétrécissements de cheminées des salons. Le stand Gilardoni & Brault, sous la forme du « Porche en Céramique d’une Habitation » présente certes des produits fabriqués par la tuilerie (tuiles, briques, et même deux modèles de sculptures de style historique) mais surtout un étourdissant ensemble de décors en grès émaillé, modelés par le sculpteur Raphanel[10]. Le nouveau style de Guimard s’est ainsi trouvé révélé d’une manière radicale au grand public qui n’avait pas encore vraiment eu connaissance de cette construction excentrée qu’était le Castel Béranger. Linteaux, appuis de fenêtres, meneaux, corniches, chéneaux et faitières, sans compter un décor complet d’escalier sont l’occasion d’un déchaînement de formes abstraites mouvantes, concentrées dans un espace bien plus réduit qu’au Castel. Seul le panneau au chat faisant le gros dos[11], vraisemblablement exposé ici avant sa mise en place sous l’oriel du Castel Béranger apporte une note de réalisme à cet exercice de style en forme de façade.

Stand de Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique en 1897 à Paris, au sein du Palais des Beaux-Arts . Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. La date de 1898 portée sur la carte est erronée. Coll. part.
Au-dessus de la petite fenêtre à gauche et de la petite porte à droite, Guimard a placé des décors de linteaux qui sont encadrés par des cornières (à gauche) ou des lames en tôle découpée (à droite). Là encore, l’aspect de leur modelage est très proche du décor de linteau édité par Bigot (ou l’inverse). Le fait que nous sachions que pour cet ensemble Guimard a eu recours au sculpteur Raphanel peut nous laisser supposer, mais sans certitude, que ce dernier a aussi participé au modelage du décor de linteau édité chez Bigot, ainsi qu’au modelage des décors de linteaux présents dans l’agence du Castel Béranger, le tout d’après des dessins de Guimard.

Décor de linteau de la petite porte à droite du stand Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique en 1897. Détail de la Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.
Presqu’en même temps que le Castel Béranger, Guimard a construit au Vésinet la villa Berthe en 1896. D’aspect plus conventionnel que le Castel par la symétrie de sa façade tournée vers la rue, la villa possède néanmoins de très beaux détails décoratifs comme les décors des linteaux des fenêtres du premier étage, probablement élaborés à la même époque (1897) que ceux du stand Gilardoni & Brault et du Castel Béranger.

Façade sur rue de la villa Berthe au Vésinet, 1896. Photo F.D.
Sur la travée centrale, légèrement bombée, le décor est divisé en trois parties, elles-mêmes subdivisées en trois éléments en grès émaillé. Les jonctions entre les éléments sont masquées par des lames en tôle découpée. À la différence de la disposition des panneaux du vestibule du Castel Béranger, ces lames ne sont plus strictement orthogonales mais courbes, participant ainsi davantage au décor. Cette innovation pourrait être le signe d’une création légèrement postérieure, mais elle apparaît pourtant sur les plans datés d’avril 1896. Là aussi, la planéité de ces lames, contrastant avec la protrusion des éléments en grès émaillé, semble leur donner une fonction de contrainte s’opposant au bouillonnement de la matière.

Partie centrale en trois éléments du décor de linteau de la travée centrale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). Photo Nicolas Horiot.

Partie latérale en trois éléments du décor de linteau de la travée centrale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). Photo Nicolas Horiot.

Décor de linteau en onze éléments de l’une des quatre travées latérales de la façade principale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). L’élément central a été scindé en trois pour l’allonger légèrement et l’adapter à la largeur de la fenêtre. Le décor du linteau de la fenêtre de la travée latérale droite de la façade postérieure est identique. Photo Olivier Pons.

Décor de linteau en onze éléments de la travée latérale droite de la façade droite du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). L’élément central a été raccourci à ses extrémités pour l’adapter à la largeur de la fenêtre. Les décors des linteaux des fenêtres des deux travées latérales gauches de la façade postérieure sont identiques. Photo F.D.
Rapidement, à partir de 1898, Guimard a été attiré par l’utilisation de la lave émaillée qui se sculpte, ou qui, dans sa version dite de la lave reconstituée[12], se moule. Son émaillage permet une vivacité des coloris et une précision de leur mise en place que le grès émaillé aux tons plus ternes et plus fondus n’atteint pas. Vaporisé sur des panneaux ou des blocs de lave naturelle « sabrée » ou « rustiquée », cet émaillage permet aussi d’ajouter une coloration presque inaltérable à un travail traditionnel de la pierre. L’une des premières utilisations architecturales de la lave émaillée par Guimard s’est sans doute faite sur les linteaux de l’hôtel Roy, 81 boulevard Suchet à Paris en 1898. Sa destruction ne nous permet pas de connaître la couleur exacte employée car la colorisation de la carte postale représentant sa façade sur rue n’est pas forcément un reflet de la réalité. Outre les linteaux des trois fenêtres de la grande baie du rez-de-chaussée, du grand linteau qui la surmonte et du grand linteau placé au-dessus des fenêtres du premier étage, il est probable qu’au niveau de l’annexe à droite, sous la terrasse, les décors des linteaux des fenêtres étaient aussi en lave émaillée.
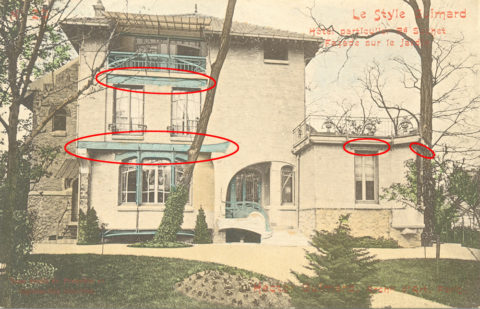
Hôtel Roy, 81 boulevard Suchet, Paris, en 1899. Carte postale ancienne n° 20 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.
La photo en noir et blanc de l’article d’Abel Favre consacré à Guimard et paru dans la revue Le Mois de septembre 1901, montre, là aussi, la présence de lames courbes en tôle découpée entourant et divisant les plaques de lave émaillée.
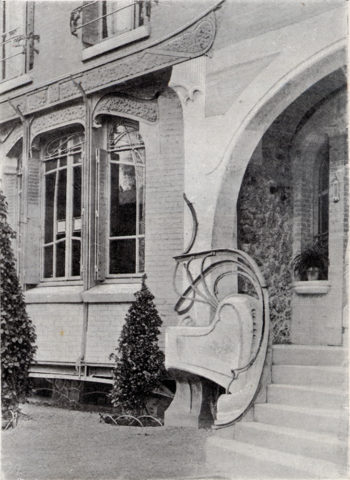
Détail de la façade sur rue de l’hôtel Roy, 81 boulevard Suchet à Paris. Revue Le Mois, septembre 1901. Coll. part.
L’immeuble de Guimard le plus emblématique de l’utilisation de la lave émaillée est bien sûr la maison Coilliot à Lille en 1898-1900. Guimard a revêtu sa façade sur rue par des panneaux sabrés et émaillés en vert en y intégrant deux importantes enseignes. Elles se distinguent du reste de la façade par leur surface lisse et leur fond jaune mais ne sont pas des décors de linteaux.

Enseignes en lave émaillée naturelle de la façade de la Maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille, 1898-1900. Photo F.D.
À l’intérieur de la maison, Guimard a disposé plusieurs décors de linteaux dont un double au-dessus des deux portes du palier donnant accès à l’appartement du premier étage. Au moins quatre autres petits décors de linteaux en lave émaillée étaient disposés au sein de l’appartement, enserrés par des lames de fer pliées. Pour leur modelage, l’évolution stylistique de Guimard est patente par rapport au décor de linteau édité par Bigot. Réalisés en lave reconstituée par estampage sur un moule avant cuisson et émaillage, ils auraient pu facilement être multipliés et employés sur d’autres constructions de Guimard. Mais pour l’instant nous n’en connaissons pas d’autres tirages. Comme pour le Castel Béranger et le stand Gilardoni & Brault, ces décors de linteaux étaient enserrés dans des lames de fer pliées.

Recto, verso et encadrement d’un décor de linteau en lave émaillée reconstituée provenant du premier étage de la maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille, 1898-1900. Long.1,05 m, haut. 0,19 m. Coll. part.
Lors de la première partie de sa carrière, plus « militante », au lieu de dissimuler les linteaux métalliques en les recouvrant par un décor, Guimard a aussi cherché à les mettre en valeur. Lorsque des poutrelles en I étaient employées, en particulier pour les soubassements, il a agi de la même manière qu’avec des fers industriels en cornière, en U ou en T, en découpant la partie centrale et en pliant les ailettes

Extrémité de la poutrelle en I du soubassement de la villa Berthe au niveau de la terrasse. Photo Nicolas Horiot.
En hauteur, il a parfois créé de véritables décors d’une grande complexité tout en leur donnant une impression de légèreté en combinant de la tôle rivetée à des cornières découpées, elles-mêmes doublées ou triplées par des barres de fer pliées. La dépense entraînée par la forte augmentation du métrage des fers a été habilement compensée par l’économie réalisée en employant des matériaux industriels mis en œuvre par un serrurier et non par un ferronnier. Le plus bel exemple d’un tel linteau est sans doute celui de la boutique Coutollau à Angers en 1896.

Détail d’une photographie ancienne non datée de la boutique Coutollau, 6 boulevard de Saumur à Angers, 1896. Coll. part., droits réservés.
En se tournant de plus en plus vers la production en série, Guimard a pu créer un important corpus de fontes ornementales, édité par la fonderie de Saint-Dizier et diffusé sur un catalogue spécial. Parmi ces fontes, plusieurs modèles de décors d’extrémités de linteaux peuvent s’adapter aux poutrelles en I de dimensions normalisées (IPN) en s’insérant le long de l’âme. Ils sont pourvus d’un œillet pour leur fixation par rivetage ou boulonnage.
Le modèle GA est le plus grand, conçu pour une âme de 12 cm.
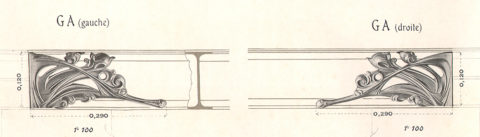
Ornements de linteau GA. Détail de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.
Les modèles GB et GC sont conçus pour des âmes de 10,5 et 8,5 cm.
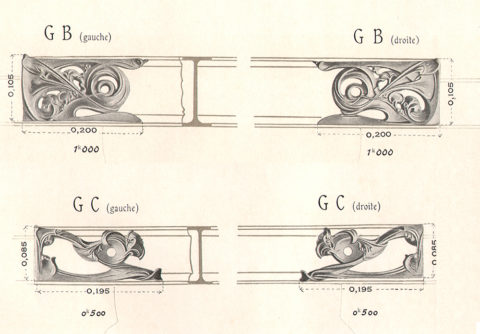
Ornements de linteaux GB et GC. Détails et photomontage de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.
La rosace GE[13] a la même hauteur que les ornements GB. Également pourvue d’un œillet, elle est destinée à ponctuer les poutrelles. Nous ne connaissons cependant aucune occurrence d’une telle utilisation.

Ornements de linteau GE. Détails de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.
Les modèles GD sont différents car ils ne comportent pas d’œillet et sont conçus pour s’adapter à deux petits fers en T, l’un horizontal et l’autre cintré. En raison de la faiblesse de leur section, ces fers ne peuvent avoir de fonction de linteau et cette combinaison de fers et de fontes ne peut donc qu’être plaquée devant un linteau porteur ou se placer sous un arc[14].
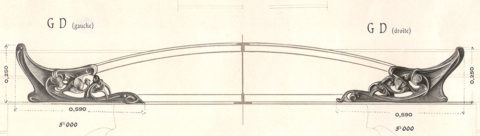
Ornements de linteau GD. Détails de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.
Guimard les a largement utilisés sur les deux immeubles Jassedé du 142 avenue de Versailles et du 1 rue Lancret[15] à Paris (1903-1905) en les appliquant contre des poutrelles en I.

Ornements de linteau GD sur l’immeuble du 14 avenue de Versailles à Paris, façade rue Lancret, 1903-1905. Photo F.D.
Le dernier exemple d’utilisation des ornements de linteaux GD par Guimard s’est sans doute fait sur la fenêtre du premier étage sur rue de la petite villa d’Eaubonne que nous datons approximativement de 1907. Sans doute pour donner plus de discrétion à ce linteau, Guimard ne lui a pas adjoint le fer supérieur arqué.

Ornements de linteau GD sur une villa de Guimard à Eaubonne, 16 rue Jean Doyen, vers 1907. Photo F.D.
Contemporain de la villa d’Eaubonne, l’hôtel Deron Levent, villa de la Réunion à Paris, comporte également plusieurs linteaux en poutrelles métalliques recevant des ornements en fonte (GA, GB, GC). Cependant, pour cette construction plus luxueuse qui se hausse au statut d’hôtel particulier, Guimard a éprouvé le besoin d’ajouter des décors modelés en stuc surmontant les linteaux des fenêtres du premier et du deuxième étage de la travée centrale. Et dans le même but, il a fait sculpter les consoles soutenant les balcons de cette travée, ainsi que l’arc de la fenêtre du second étage.

Linteau métallique, tympan en stuc et arc de la fenêtre du premier étage de la travée centrale de l’hôtel Deron Levent, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GA. Photo F.D.

Linteau métallique, tympan en stuc et arc de la fenêtre du second étage de la travée centrale de l’hôtel Deron Levent, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GB. Photo F.D.
Nous avons vu plus haut que, dans la cour de cet hôtel, Guimard avait placé deux linteaux métalliques au-dessus des fenêtres du premier étage et qu’il les avait pourvus d’ornements GC. Là aussi, il a voulu en renforcer l’effet décoratif en leur adjoignant cette fois ses anciens décors de linteaux en grès émaillé édités par Bigot.
La villa d’Eaubonne et l’hôtel Deron Levent sont pratiquement les dernières constructions[16] sur lesquelles Guimard a fait apparaître des linteaux métalliques. Par la suite, l’expression d’une élégance de bon aloi a supplanté la volonté d’afficher la structure du bâtiment sur les façades. C‘est donc la sculpture de la pierre qui a progressivement pris le relais des multiples décors de linteaux que nous avons répertoriés. Mais là encore, Guimard a su s’écarter du conformisme de ses confrères. Alors que la plupart des architectes concentrent le décor des linteaux des portes d’entrée en leur milieu pour y placer une tête, un motif quelconque ou un simple numéro de rue, Guimard a pris le contre-pied de cette habitude en évidant au contraire la partie centrale et en augmentant le décor sur la partie haute des jambages et sur les angles supérieurs.

Porte d’entrée de l’hôtel Mezzara. Photo F.D.
Même sur la porte de son hôtel particulier, avenue Mozart, où Guimard a placé son monogramme au centre du linteau de la porte d’entrée, la surabondance du décor latéral rend plus discrète la présence de ce motif.

Photographie ancienne de l’hôtel Guimard, 122 avenue Mozart, 1909-1912. Coll. Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Le décor des linteaux a donc fidèlement suivi l’évolution du style de Guimard en matière d’architecture, passant d’une multiplicité de matériaux, souvent très colorés, à une restriction de leur nombre et à une plus grande sobriété dans la coloration. Dans le même temps, leur modelage, bouillonnant à l’époque du Castel Béranger, s’est assagi pour se tourner vers la recherche d’élégance.
Frédéric Descouturelle
Notes :
[1] Vente Auctie’s du 02 décembre 2022, à Drouot salle 10, lot 183.
[2] Information fournie par Mme Françoise Mary.
[3] L’aspect réel de ce (ou ces) boutique(s) nous est pratiquement inconnu. Dans le portfolio du Castel Béranger, aux planches 1 et 2, Guimard en donne deux versions dessinées, à la fois différentes et imaginaires. Seule une petite partie des devantures est photographiée (sans avoir été retouchée) aux planches 3 et 6 et fait apparaitre de simples panneaux de verre verticaux étroits conformes au premier projet du Castel Béranger avant sa transformation par Guimard en un immeuble de style Art nouveau. Ces ouvertures ont été par la suite réduites en simples fenêtres reprenant le gabarit de la fenêtre de droite de l’agence de Guimard.
[4] 9 avenue de la Frillière, Paris XVIe, 1895.
[5] Il devient alors nécessaire pour l’architecte et pour l’entrepreneur de concevoir leur arc en suivant les dimensions et la courbure du décor de linteau. Il s’agit du même phénomène de renversement des rôles qui s’est répandu tout au long du XIXe siècle en raison de l’édition en série des décors et qui voit, par exemple, les menuisiers tenus de fabriquer leurs huisseries en fonction des dimensions des panneaux de fontes ornementales disponibles sur catalogues.
[6] Guimard a donc préféré se prévaloir de la fonction d’architecte qu’il tenait en haute estime, plutôt que celle de sculpteur-modeleur qu’il aurait plus logiquement utilisé en signant « Hector Guimard sc ».
[7] Ce chiffre est celui de l’actuelle disposition après restauration de la balustrade. Cependant une photographie ancienne montre que la répartition des décors de linteau était sans doute différente de l’actuelle. De plus, deux autres modules de balustrade existent aussi au niveau du portail de l’entrée carrossable sur rue, sans que nous sachions s’il s’agit bien d’une disposition d’époque.
[8] Nous remercions Georges Barbier-Ludwig, ancien conservateur du musée Roybet-Fould de Courbevoie de nous avoir signalé leur existence.
[9] « Guimard me disait ce matin une chose juste : dissimuler le moins possible la nature des matériaux — que du bois reste du bois, etc. — et si pour des raisons pratiques on est forcé de les recouvrir, que l’on conserve le plus possible les caractères de chaque matériau, sinon dans leur teinte, pour se garder de toute imitation, mais dans leur ton pour rester logique… » Signac, Paul, Journal, 15 janvier 1899, cité par Thiébaut, Philippe, La Revue de l’Art, 1991, vol. 92 ; n° 1, p. 72-78.
[10] Le nom de Raphanel est le seul nom de collaborateur cité dans la presse. Il l’est également sur le plan du stand et sur le projet d’enseigne du stand dessiné par Guimard. Il apparait également en compagnie de celui du sculpteur plus connu Jean-Désiré Ringel d’Illzach dans le portfolio du Castel Béranger où tous deux sont crédités de l’exécution des modèles de sculpture. Il s’agit vraisemblablement du sculpteur Xavier Raphanel (1876-1957), auteur de nombreuses statuettes historicistes et de quelques objets d’art décoratif.
[11] On se réfèrera au livre La Céramique et la lave émaillée de Guimard où nous faisons l’hypothèse que ce panneau au chat faisant le gros dos est la réduction d’un panneau légèrement plus grand, édité en version gauche et droite, et qui a été remodelé pour entrer dans l’espace qu’il occupe actuellement au Castel Béranger, peut-être à la place d’un autre décor initialement prévu.
[12] Cf. le livre La Céramique et la lave émaillée de Guimard ou notre article sur la lave émaillée.
[13] La rosace GE est également répertoriée en tant que rosace GO sur la planche des ornements divers. De même que les ornements de linteau GA, GB et GC, elle sera intégrée lors d’une augmentation du catalogue à des compositions de balcons et de balustrades fondues en une seule pièce.
[14] C’est cette solution qui a été adoptée pour le seul exemple d’utilisation des ornements de linteaux GD en dehors de Guimard sur un immeuble non daté et d’architecte inconnu au 13 avenue de Metz à Châlons-en-Champagne.
[15] Sur la façade de l’immeuble du 142 avenue de Versailles à Paris donnant dans la rue Lancret, le fer supérieur arqué des décors de linteaux est manquant sur toute la 2e travée (petites fenêtres d’un escalier), ainsi que sur toutes les façades sur rue de l’immeuble du 1 rue Lancret. Cette systématisation des manques écarterait l’hypothèse de destructions aléatoires de ce fer supérieur. Cependant on note que même lorsque le fer supérieur est manquant, les coins supérieurs et intérieurs des ornements de linteaux GD ont été sciés, comme dans les cas où un fer supérieur arqué y était inséré. Faute de pouvoir examiner de près un ornement de linteau GD, nous ne connaissons pas la raison précise de cette amputation, mais il est probable qu’elle est due à un impératif technique puisqu’elle n’existe pas sur le linteau de la villa d’Eaubonne où un fer supérieur arqué n’a pas été mis en place.
[16] Sur l’immeuble Franck, 10 rue de Bretagne, réalisé de façon très économique de 1914 à 1919, les linteaux métalliques ont réapparu, sans aucun décor. La maquette de maison standardisée, vers 1921, conservée au musée des Arts Décoratifs, montre également des linteaux apparents qui pourraient avoir été prévus en ciment armé.
Addenda le 25 mars 2023
Un décor de linteau en grès émaillé par Bigot, semblable à celui que nous présentons en début d’article, a été brièvement mis en vente le 25/3/2023 sur le site LeBonCoin. L’existence de ce nouvel exemplaire (le troisième) plaide en faveur de l’existence d’une série de ces décors de linteaux provenant du Castel Val.

Les multiples Auteuils d’Hector Guimard
Les dates de la double exposition américaine consacrée à Guimard ont été fixées comme suit :
* New York – Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum : How Paris Got Its Curves.
Du 17 novembre 2022 au 21 mai 2023.
* Chicago – The Richard H. Driehaus Museum : Hector Guimard: Art Nouveau to Modernism
Du 22 juin 2023 à début janvier 2024.
En attendant, le catalogue, édité par Yale University Press, New Haven and London en association avec le Richard H. Driehaus Museum, est disponible sur commande, chez les libraires ou par internet. Il s’agit d’un beau livre de 222 pages, très illustré, contenant des articles de premier plan, réunis par David A. Hanks.
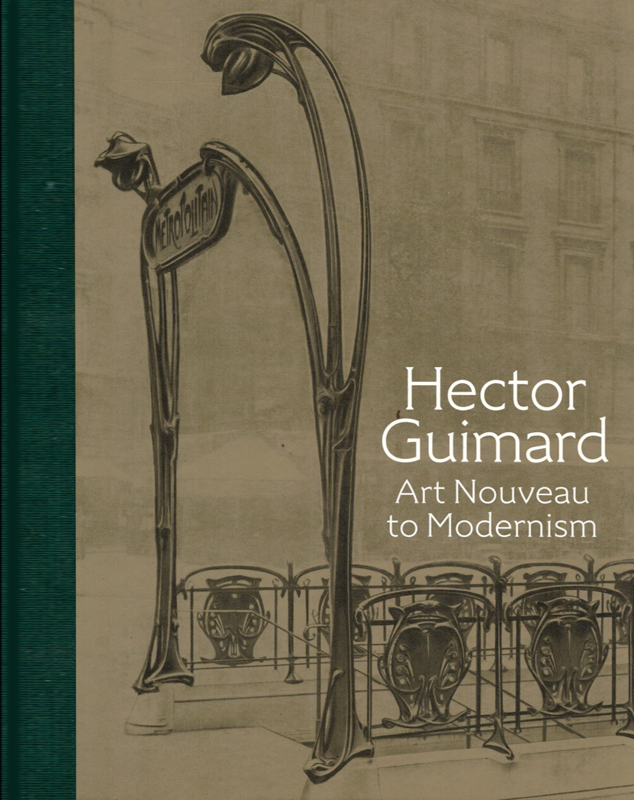
Parmi ces articles, nous avons choisi de traduire celui de Mme Isabelle Gournay (pp. 42-53) que nous avions eu le plaisir d’accueillir au Castel Béranger lors de son passage à Paris avant le premier confinement. De nationalité française et vivant aux États-Unis, elle est diplômée en architecture par l’École nationale des Beaux-Arts de Paris et docteure en histoire de l’Art de l’Université de Yale.
Cet article, consacré aux multiples facettes du quartier d’Auteuil, berceau de l’œuvre de Guimard, complète de façon très heureuse la série d’articles que nous avons publiés ces dernières années concernant l’entourage familial, relationnel et professionnel de Guimard :
Protéger le patrimoine Art nouveau parisien : initiatives et réseaux dans l’entre-deux-guerres
Hector Guimard et la famille Nozal, première partie
Hector Guimard et la famille Nozal, seconde partie
Albert Adès, un écrivain égyptien juif francophone dans l’entourage d’Hector et d’Adeline Guimard.
Les relations amicales du couple Guimard-Oppenheim en 1908-1909
De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients
Les architectes Guimard réunis par la famille Oppenheim
De nouvelles informations sur la sépulture Grunwaldt
Pour cette traduction française, réalisée par notre ami Alan Bryden, nous avons pu apporter quelques petits éléments complémentaires au texte de Mme Gournay qui les a acceptés avec libéralité. Pour les illustrations, nous avons remplacé certaines images du catalogue par des vues en cartes postales et nous avons refait le plan du quartier d’Auteuil en respectant l’idée de l’auteure de plusieurs regroupements de constructions de Guimard, tout en introduisant pour la première fois la localisation de ses domiciles successifs.
F. D.
Les multiples Auteuils d’Hector Guimard
La carrière d’Hector Guimard (1867-1942) s’est déroulée à Auteuil, et c’est dans ce quartier le plus méridional du XVIe arrondissement que se trouvent la majorité de ses bâtiments encore existants. À dix-huit ans, il décida de ne plus habiter chez ses parents dans le XVIIe arrondissement ou près de ses écoles (des Arts Décoratifs et des Beaux-Arts) sur la rive gauche. Il s’installa chez sa marraine, Appolonie Grivellé[1], au 147, avenue de Versailles, et demeura à Auteuil jusqu’à son émigration en Amérique en 1938. Cet enracinement fut un facteur décisif dans une double carrière de praticien local et d’« architecte d’art » aux ambitions internationales, apôtre incontournable de l’« art total » [2]. La bourgeoisie catholique possédant des terrains à Auteuil fit localement appel à Guimard, pour ses résidences privées et des immeubles de rapport, mais aussi pour des monuments funéraires et des villas de banlieue ou de bord de mer. Comme le prouvent les débuts de Frank Lloyd Wright (1867-1959) à Oak Park, près de Chicago, à la même époque, recruter ses clients parmi des voisins partageant les mêmes idées, ou y étant simplement ouverts, n’était pas une démarche inhabituelle pour un architecte progressiste établissant sa propre agence.
Au-delà de sa réputation actuelle de traditionalisme huppé, Auteuil est un palimpseste fascinant, une superposition de « lieux de mémoire » datant de l’ancien régime aux Années Folles, de l’hôtel particulier où Abigail et John Adams[3], fuyant l’agitation de Paris, choisirent de vivre avec leurs deux fils, à la maison conçue par Le Corbusier (187-1965) pour le collectionneur Raoul La Roche. Cet héritage architectural et urbanistique aux multiples facettes nous permet également de contextualiser le travail de Guimard, dont les secteurs d’activité forment différents périmètres.[4]
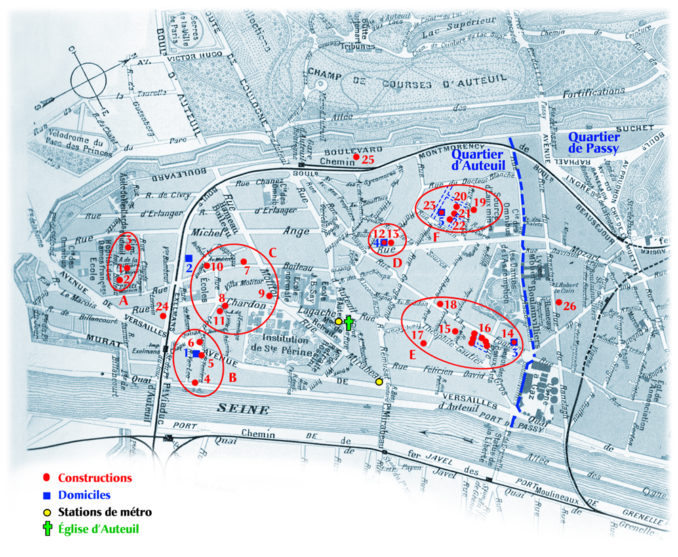
Les constructions de Guimard au sein du quartier d’Auteuil :
A) 1- École du Sacré-Cœur, 1895 ; 2- Usine Déjardin, 1901 ; 3- Tombe Deron-Levent, 1912.
B) 4- Au Grand Neptune, 1888 ; 5- Pavillons Hannequin, 1891 ; 6- Immeuble Jassedé, 1903-1905.
C) 7- Hôtel Roszé, 1891 ; 8- Hôtel Jassedé, 1893 ; 9- Hôtel Delfau, 1894 ; 10- Villa Roucher, 1898 ; 11- Hôtel Deron-Levent, 1907.
D) 12- Hôtel Guimard, 1909-1912 ; 13- Immeuble Houyvet, 1926-1927.
E) 14- Castel Béranger, 1895-1898 ; 15- Immeuble Trémois, 1909-1910 ; 16- Immeubles rue Gros, La Fontaine, Agar, 1909-1911 ; 17- Ateliers Guimard, 1903 ; 18- Hôtel Mezzara, 1910-1912.
F) 19- École des Maronniers, aménagement intérieur, c. 1898 ; 20- Hôtel Nicolle de Monjoye, 1914 ; 21- Garage Bastien, 1922 ; 22- Hôtel particulier, standard construction, 1922 ; 23- Hôtel Guimard, 1926-1927.
Autres constructions de Guimard à proximité :
24- Galerie Carpeaux, 1894-1895 ; 25- Hôtel Roy, 1898 ; 26- Hôtel Nozal, 1902-1903.
Domiciles de Guimard :
1- 147 av. de Versailles (1882-1893) ; 2- 64 bd Exelmans (1893-1898) ; 3- Castel Béranger, 14 rue La Fontaine (1898-1913) ; 4- Hôtel Guimard, 122 av. Mozart (1913-1930) ; 5 – Immeuble Guimard, 18 rue Henri Heine (1930-1938).
Stations de métro Guimard, ligne 10, 1913 : Mirabeau ; Église d’Auteuil.
Malheureusement certaines de ses œuvres n’existent plus ou ont été irrémédiablement altérées : son premier édifice, un café-concert sur le quai d’Auteuil a disparu à la suite de la grande crue de 1910 qui entraîna une restructuration complète des berges de la Seine, et le charmant Hôtel Roy, quasi-banlieusard, niché entre les fortifications et la voie de chemin de fer en contrebas, a été démoli (sans que personne ne le remarque) vers 1960.

L’hôtel Roy, carte postale n° 20 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.
Toutefois, les plaisirs de la découverte ne manquent pas pour le flâneur, telle la juxtaposition près de la rue La Fontaine (rebaptisée Jean-de-La-Fontaine en 2004) de l’immeuble Trémois de Guimard datant de 1910 et d’une crèche des années 1890.[5]
Surnommé « Le Far West de Paris » par le journaliste et homme de lettre Léo Claretie, Auteuil a connu une croissance aussi spectaculaire que celle des villes de la « frontière » américaine : elle comptait 1 077 habitants en 1800, 6 270 en 1856, cinq ans avant son annexion par Paris, et 29 134 en 1901[6]. En 1912, lorsqu’Hector et Adeline Guimard s’installèrent dans leur nouvel hôtel particulier de l’avenue Mozart, la population d’Auteuil atteignait 40 000 habitants ; elle doubla encore lorsqu’ils quittèrent la rue Henri-Heine en 1938. Des fortifications bastionnées datant des années 1840 (qui ne furent démolies qu’après 1910) séparaient le quartier du Bois de Boulogne, tandis qu’un imposant viaduc ferroviaire datant des années 1860 s’étendait le long du boulevard Exelmans — où Guimard avait son domicile et son agence jusqu’au milieu des années 1890, au numéro 64 — jusqu’à la gare d’Auteuil.

Vue du quai d’Auteuil depuis la berge du XVe arrondissement. À gauche, le viaduc d’Auteuil ; tout à droite sur le quai, le café Au grand Neptune, première construction de Guimard. Carte postale ancienne. Coll. part.
Le rythme des chantiers s’accentua vers 1892, entrainant l’élargissement et l’alignement de plusieurs chemins d’origine rurale. Il n’est pas difficile d’imaginer Hector Guimard, âgé de vingt-cinq ans et coiffé d’un chapeau haut de forme, s’enquérir des possibilités de construire le long d’une rue ainsi modernisée.[7]

Dessin par Jules-Adolphe Chauvet, Percement du côté droit de la rue des Perchamps au coin de la rue d’Auteuil. Mention manuscrite : « Les rues de l’avenir ». Daté au recto, 7 avril 1892. Hauteur : 26,2 cm, largeur : 18,3 cm. CCØ Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris.
En chantier pendant quinze ans, l’église paroissiale fut reconstruite en style romano-byzantin et consacrée en 1892.

L’église d’Auteuil, construite par l’architecte Émile Vaudremer. Carte postale ancienne. Coll. part.
Il est fort probable que Guimard ait rencontré son auteur, Émile Vaudremer (1829-1914). En effet, le « patron d’atelier » de son propre professeur, Gustave Raulin (1837-1910), vécut jusqu’à la fin des années 1890 dans une maison de sa conception au 93 boulevard Exelmans.[8] Lorsqu’il est intervenu en 1894-1895 sur la galerie Carpeaux, au 39 boulevard Exelmans, Guimard a d’ailleurs pris soin d’utiliser un modèle d’épi de faîtage créé par Vaudremer et proposé sur le catalogue de la tuilerie Muller & Cie[9].
Auteuil offrit à plusieurs générations d’architectes de belles opportunités professionnelles, tant artistiques que pécuniaires.[10] Léon Nozal fut le plus important commanditaire de Guimard, lui confiant aussi bien son hôtel particulier de la rue du Ranelagh (officiellement situé dans le quartier adjacent de la Muette, mais à trois minutes de marche du Castel Béranger, et malheureusement détruit) que ses entrepôts de banlieue ; il fut également son associé en matière de promotion immobilière. Toutefois, Charles Blanche (1863-1937), architecte diplômé habitant le quartier et lui-même ancien élève de Raulin, édifia la maison-atelier du frère de Léon Nozal, toujours existante mais quelque peu « anéantie » dans son contexte actuel.[11] Sur l’étroit terrain en angle aigu en bordure de Seine, à proximité du Pont de Grenelle, Blanche adopta la version élégante et plus retenue de l’Art nouveau promue par Charles Plumet.

Hôtel d’Alexandre Nozal par Charles Blanche, quai d’Auteuil, (act. quai Louis Blériot), Paris XVIe, façade sur Seine. Photo parue dans L’Architecte, 1913. Coll. part.
Parmi les architectes dépourvus de formation académique mais très présents à Auteuil, citons Ernest Toutain (1845-1923), originaire et résident du quartier, dont les commandes évoluèrent, comme celles de Guimard, de la maison individuelle à l’immeuble collectif.[12] L’architecte Henri Tassu (1853-1937) construisit abondamment dans les quartiers élégants des XVIe et XVIIe arrondissements ainsi qu’à proximité du jardin du Luxembourg, où il s’installa dans un petit hôtel particulier de sa conception. En 1893, il finança et conçut à Auteuil des immeubles d’habitation pour la petite bourgeoisie de part et d’autre de la nouvelle rue Chapu (entre l’avenue de Versailles et le boulevard Exelmans.[13]

Henri Tassu, immeuble de rapport à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Chapu. Photo F. D.
C’est autour du vieux village d’Auteuil, relativement inchangé au début du XXe siècle, que gravitèrent les édifices de Guimard, ainsi que ses lieux de résidence.[14] Ses maisons individuelles se trouvent pour la plupart dans ce que l’on peut nommer le « secteur des villas » (secteur C sur le plan) dont le rustique Hameau Boileau et la très chic villa Montmorency, tous deux conçus par l’architecte Théodore Charpentier (1797-1867), étaient les premiers lotissements. Des maisons pittoresques, qui à l’origine avaient souvent servi de résidences secondaires et d’échappatoires à la congestion du centre de Paris, bordaient des rues privées, closes de grilles et portails et se terminant souvent en impasse. Les règlements de lotissement excluaient le commerce de détail, ainsi que les activités industrielles qui s’étaient développées dans les quartiers voisins de Javel et Billancourt. De grandes parcelles non-loties accueillaient des maisons de retraite et de convalescence ainsi que des établissements d’enseignement, dont beaucoup ont survécu. La verdure était abondante, mais, comme partout ailleurs à Auteuil, on ne trouvait aucun jardin public. Dans ce secteur, Toutain et d’autres architectes construisirent des maisons mansardées. Certaines d’entre elles étaient revêtues de pierre meulière et protégées par des clôtures basses en pierre ornées de ferronneries artistiques : ces éléments décoratifs furent réinterprétées par Guimard dans les maisons individuelles qu’il insèrera dans ce tissu urbain : les Hôtels Roszé, Jassedé, Delfau, Deron-Levent et les Villas Roucher. Conçue par l’architecte Paul Sédille (1836-1900), la villa Weber était d’un niveau artistique plus élevé que la normale et la composition de sa façade (malheureusement altérée) semble avoir inspiré Guimard à l’Hôtel Jassedé.[15] À l’instar de Sédille, dont il devait admirer l’énergie à défendre le prestige de la commande privée, souvent mise au second plan par rapport aux édifices publics, Guimard s’intéressa à l’architecture anglaise et s’attacha à promouvoir la polychromie et les matériaux céramiques.
Au-delà du viaduc ferroviaire, le quartier du Point-du-Jour où se trouve une autre « grappe » d’édifices de Guimard, offrait un contraste physique et sociologique frappant.[16]

Le marché sur l’Avenue de Versailles au Point-du-Jour. Carte postale ancienne. The Richard H. Driehaus Museum Archives, Chicago.
Marqué par le siège de l’armée prussienne et par la Commune de Paris de 1870-1871, cet ancien hameau juxtaposait habitat populaire et petites usines, comme celle d’extraction de malt où Guimard était intervenu pour le pharmacien Déjardin en 1901.[17] Autre commande soumise à un contexte physique et sociologique très particulier, l’École du Sacré-Cœur, d’allure industrielle par raison d’économie, n’était pas un établissement scolaire mais un patronage qui enseignait le catéchisme et proposait des activités extracurriculaires aux garçons du quartier. Il est possible que ces jeunes aient vécu dans les petites maisons de la villa Mulhouse voisine, un exemple, exceptionnel à Auteuil, d’habitat ouvrier bien conçu et de faible densité.[18] Résidant de l’autre côté du viaduc, la bourgeoisie locale s’aventurait dans ce quartier plus plébéien pour se rendre au petit cimetière cerné de hauts murs. Situé à l’origine devant l’église paroissiale du vieux village, ce cimetière abrite la tombe de Charles Deron-Levent, client de Guimard, fruit d’une collaboration entre l’architecte et sa voisine de l’avenue Perrichont, la sculptrice Jeanne Itasse.[19]
La contribution de Guimard au développement d’Auteuil est particulièrement significative le long et autour de la rue La Fontaine à proximité du Pont de Grenelle, où il édifia huit immeubles de rapport et un petit hôtel particulier (tous existants), ainsi que ses propres ateliers (aujourd’hui disparus).

La rue La Fontaine, à l’angle de la rue de Boulainvillers, vers 1900. Le Castel Béranger est construit sur le côté droit de la rue bordée d’arbres. Carte postale ancienne, The Richard H. Driehaus Museum Archives, Chicago.
Cette voie ancienne au tracé fort irrégulier était arborée aux alentours du Castel Béranger, où Guimard osa reprendre le mélange brique-pierre meulière pour un immeuble de rapport. Guillaume Apollinaire (qui s’était installé rue Gros pour être proche de sa bien-aimée, la peintre Marie Laurencin, qui habitait elle-même aux numéros 10 et 32 de la rue La Fontaine)[20] décrit l’emplacement actuel de la Maison de la Radio dans son ouvrage Le flâneur des deux rives de 1918 : « une usine à gaz occupe, avec ses gazomètres, ses différentes constructions, ses montagnes de charbon, ses crassiers, ses petits jardins potagers, un terrain qui s’étend jusqu’à la rue du Ranelagh, à l’endroit où elle est une des plus désertes de l’univers. » Et de poursuivre en évoquant le Dépôt municipal des Beaux-Arts, en face du Castel Béranger :
« Dans la rue La Fontaine, du côté gauche il y a un long mur gris sombre. Une porte qu’on ne franchit pas sans difficultés donne accès dans une cour où quelques poules se promènent gravement. À gauche en entrant, on a entassé de singulières choses qui sont, je crois, les cerceaux des anciennes crinolines. Cette cour est encombrée de statues. Il y en a de toutes formes et de toutes grandeurs, en marbre ou en bronze. […] Le bâtiment de droite est une sorte de musée inconnu où l’on voit un grand tableau de Philippe de Champaigne, un Le Nain : Saint Jacques, beau tableau qui serait bien au Louvre, et un grand nombre de tableaux modernes. Quelques salles sont pleines des christs que l’on a enlevés au Palais de Justice. […] Ce musée fait partie d’une grande cité mystérieuse composée de l’ancien Hôtel des Haricots, derrière lequel se trouve la forêt de réverbères. Il y a aussi la Salle des tirages de la Ville de Paris, et, plus loin, dans une plaine immense, s’élèvent des pyramides de pavés. On les défait sans cesse et on les refait et parfois une de ces pyramides s’écroule, avec le bruit des galets quand la vague se retire. »[21]
Plus loin sur la rue La Fontaine, se trouvait un grand ensemble de bâtiments occupé par une œuvre de charité catholique qui hébergeait et formait des orphelins de la classe ouvrière tout en organisant de grandes fêtes « gymnastiques et militaires.[22] La rue Ribéra adjacente, qui monte vers l’avenue Mozart, était le fief de l’architecte Jean-Marie Boussard (1844-1923), un maître de l’éclectisme grandiose et aguicheur.[23] En face des ateliers de l’avenue Perrichont, l’architecte Joachim Richard (1869-1960) [24] édifia et s’installa dans un immeuble d’habitation revêtu de grés émaillés de style art nouveau par Gentil & Bourdet.[25] Sans doute en raison de cette proximité avec les ateliers de Guimard et probablement de liens amicaux, l’immeuble de Richard a reçu une plaque de numéro de maison (un 15), modèle édité par Guimard à la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908[26]. En 1923, Richard rejoindra Guimard au sein du Groupe des Architectes Modernes. Présent dans la même rue (au n° 14, c’est à dire sur la parcelle mitoyenne des ateliers Guimard) un architecte plus traditionaliste, Deneu de Montbrun, a été l’un des rares confrères à utiliser les fontes ornementales de Guimard sur ses propres immeubles.[27]
Auteuil, malgré ses nombreuses rues portant le nom de peintres et de sculpteurs, n’était pas un haut lieu de l’avant-garde comme Montmartre ou Montparnasse, et les artistes établis préféraient construire des maisons-ateliers dans le XVIIe arrondissement. C’est la modicité des loyers et le confort du Castel Béranger, et non pas son architecture, qui incitèrent Paul Signac à s’y installer.[28] Toutefois un autre occupant de la première heure, l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim (1869-1941), fut sensible à l’œuvre de Guimard et s’en inspira.[29] Parmi les voisins appartenant au monde des lettres, se trouvaient Pierre Louÿs et Xavier Privas, le « prince des chansonniers. » En 1896, Fernand Mazade s’installa au 17, rue de Boulainvilliers. Il est probable que de simples relations de voisinage expliquent pourquoi ce poète, sans lien connu avec les architectes ou l’Amérique, écrivit des articles sur le travail de Guimard pour la revue new-yorkaise The Architectural Record.[30]
L’avenue Mozart[31] était la seule artère que le baron Haussmann ait tracé à Auteuil, mais c’était une entreprise modeste comparée au boulevard Malesherbes, où Adeline Oppenheim Guimard vivait avant son mariage. Dans le petit regroupement de la Villa Flore formé par son propre hôtel particulier et l’Immeuble Houyvet, Guimard tira le meilleur parti de parcelles étroites et contorsionnées, et célébra en façade leur angularité. Son installation à l’extrémité sud de l’avenue Mozart coïncida avec celle du métro, et d’activités de loisirs, sous la forme du Mozart Palace, un cinéma de 1 300 places situé à côté de la station Michel Ange-Auteuil.[32] Entre l’hôtel particulier de Guimard et ce carrefour commercial, l’architecte Ernest Herscher (1870-1939) réalisa au 85-87 rue La Fontaine un élégant immeuble d’habitation dont la loggia métallique demeure un très bel exemple d’Art Nouveau.[33] Les deux architectes appartenaient à la Société du Nouveau-Paris, un groupe qui accordait une grande importance à l’insertion de balcons à la fois artistiques et fonctionnels dans les façades d’immeuble.[34]
Alors que l’avenue Mozart incarnait, avec ses commerces et sa ligne de tramway, l’effervescence de la Belle Époque, la rue Henri-Heine, nouvellement rallongée jusqu’à la rue du Docteur Blanche, où Guimard conçut son immeuble le plus luxueux, n’offrait aucune frondaison ou boutiques. La circulation y était purement locale. Guimard ne fut pas le seul architecte à vouloir bousculer l’élégance timorée, voire compassée, qui caractérisait petits hôtels particuliers et immeubles d’appartement à proximité de son ultime résidence parisienne. Au croisement des rues Henri-Heine et Jasmin, donc au cœur de la dernière « enclave Guimard » à Auteuil, Paul Guadet (1873-1931), lui-même résident du quartier, acheva en 1913 un central téléphonique à la fois rationaliste et décoratif, puis Pol Abraham (1891-1966), membre du Groupe des Architectes Modernes tout comme Guimard, édifia une résidence d’étudiantes américaines caractérisée par l’audacieuse courbe de sa salle de lecture.[35] Cette partie d’Auteuil est surtout connue des amateurs d’architecture pour la Fondation Le Corbusier (dont la terrasse offre une belle vue sur l’appartement des Guimard) et la Rue Mallet-Stevens. Relevons ici un paradoxe qui incite à réfléchir sur la place de Guimard dans l’histoire de l’architecture. Alors qu’il testait son système de préfabrication économique au square Jasmin[36], les résidences des deux ténors du modernisme français reflétaient le snobisme et l’exclusivité de cette partie d’Auteuil !
Imaginatifs et dynamiques, mais solidaires de leur environnement, les édifices de Guimard se lovent donc dans de multiples Auteuils. Chacun des cinq groupements décrits ici reflète des identités visuelles et sociales spécifiques, auxquelles il s’est plié et qu’il a façonné en retour. Guimard a été influencé — tant en matière de stratégie professionnelle, de typologie résidentielle, et de parti décoratif — par le travail d’ architectes qui l’ont précédé sur le même territoire; en même temps, son œuvre a inspiré et encouragé d’autres concepteurs. Mais laissons le dernier mot à Guillaume Apollinaire, en paraphrasant son célèbre poème de 1912, Le pont Mirabeau. Dans ses chers et multiples Auteuils,
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont, Guimard demeure.
Isabelle Gournay
Traduction initiale : Alan Bryden
[1]– Cf. Marie-Claude Paris, De Lyon à Paris, Hector Guimard et des proches : famille voisins et clients, article paru sur le site du Cercle Guimard, 15 juillet 2020.
[2]– Il est sans doute exagéré d’affirmer, comme l’a fait Claude Frontisi (dans « Hector Guimard entre deux siècles, » Vingtième siècle, revue d’histoire, janvier-mars 1988, p. 61) que Guimard était « prisonnier d’une aire géographique ». Il est certain, en revanche, qu’il a bénéficié de peu d’opportunités pour les commandes commerciales et religieuses et d’aucune pour les bâtiments publics.
[3]– John Adams a été le second président des États-Unis de 1797 à 1801.Voir The Adams Family in Auteuil, 1784-1785, As Told in the Letters of Abigail Adams, sous la direction de Howard C. Rice Jr., Boston, Massachusetts Historical Society, 1956 https://archive.org/details/adamsfamilyinaut00adam
[4]– Desservi tardivement en 1913 par la ligne 10 du métro, le quartier d’Auteuil a reçu des accès découverts Guimard plus simples que l’édicule de la Porte Dauphine. Emblématique du style Guimard, celui-ci se trouvait au bout de l’ultrachic avenue du Bois de Boulogne (actuellement avenue Foch). De là, on parvenait à la plus majestueuse entrée du Bois de Boulogne. À Auteuil, cette relative simplicité des accès convenait mieux à l’esprit bourgeois du quartier. Rappelons qu’avant même le premier chantier du métro en 1900 (et donc sans qu’il soit alors question du style qui allait être adopté), les conseillers municipaux des « beaux quartiers » étaient parvenus à faire remplacer les édicules prévus sur les grandes avenues du nord du XVIe arrondissement par des accès découverts.
[5]– Conçue par Charles Dupuy (1848-1925), qui habitait près du Trocadéro, cette garderie est évoquée dans L’Architecture, n° 40, 20 octobre 1897, p. 362-63.
[6]– Léo Claretie, Le Far West de Paris, Société historique d’Auteuil et de Passy : Première exposition d’histoire et d’archéologie du XVIe arrondissement au Musée Guimet (du 1er au 27 juin 1904), Paris, à la bibliothèque de la société, 1905. Auguste Doniol, Histoire du XVIe arrondissement de Paris, Paris, Hachette, 1902, p. 167. De 1878 à 1888, le conseiller municipal élu d’Auteuil, Léopold Cernesson (1831-1889), était un architecte.
[7]– Pour une photographie de Guimard coiffé d’un haut-de-forme et à l’allure élancée devant le Castel Béranger, cf. Philippe Thiébaut et al., catalogue de l’exposition Guimard, Paris, Gallimard, Réunion des musées nationaux, 1992, p. 166.
[8]– Cf. Alice Thomine, Émile Vaudremer 1829-1914, Paris, Picard, 2004, p. 156-57. Vaudremer s’est ensuite installé près du Palais du Trocadéro dans un immeubles de rapport de sa conception. Charles Girault, architecte du Petit Palais, et Auguste Perret habitaient à proximité, également dans des immeubles dont ils étaient les auteurs.
[9]– Cf. à paraître, F. Descouturelle et O. Pons, La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2021.
[10]– Pour une étude systématique des architectes travaillant dans la banlieue ouest de Paris, dont Guimard, cf. C. Jubelin-Boulmer, F. Hamon, D. Hervier et P. Ayrault, Hommes et métiers du bâtiment, 1860-1940 : L’exemple des Hauts-de-Seine, Cahiers du patrimoine 59, Paris, Éditions du patrimoine, 2001.
[11]– Charles Blanche habita au 21 et 46 avenue Mozart et au 10 Avenue Ingres.
[12]– Pour une liste des œuvres d’Ernest Toutain, cf. Anne Dugast et Isabelle Parizet, Dictionnaire par noms d’architectes des constructions élevées à Paris aux XIXe et XXe siècles, Première série, période 1876–1899, 5 vols, Paris, Service des travaux historiques de la Ville de Paris, t. IV, 1996, p. 108–9. Collectionneur de cartes et documents anciens sur Auteuil, Toutain habita au 32 rue Molitor et au 4 rue Erlanger. Plusieurs de ses maisons et écuries d’Auteuil furent illustrées dans J. Lacroux et C. Détain, Constructions en briques : La brique ordinaire au point de vue décoratif, Paris, Ducher et Cie, 1878. Le bel immeuble de rapport de 1913 conçu avec son fils Edmond au 133, boulevard Exelmans (donnant également sur le boulevard Murat) est illustré dans Gaston Lefol, Immeubles modernes de Paris : Façades-plans-sculptures, Paris, Ch. Massin, 1928, pl. 56-58.
[13]– Sur la rue Chapu, cf. Doniol, Histoire du XVIe arrondissement, p. 224. On se souvient de Tassu (voir la liste dans Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 4, p. 100) pour son opulent immeuble de 1906 situé sur les rues Spontini, Benjamin Godard et Mony dans le quartier de la Porte Dauphine du XVIe arrondissement. Maxime Decommer illustre l’hôtel particulier de Tassu, rue le Verrier, dans son exposé sur les résidences conjuguées aux lieux de travail de Guimard et de ses pairs ; Decommer, Les architectes au travail : L’institutionnalisation d’une profession, 1795-1940, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, 234.
[14]– Dans le cadre de la Société historique d’Auteuil et de Passy, à laquelle il a adhéré en 1892, Guimard a rassemblé des vestiges de l’ancienne église dans le presbytère de la paroisse, comme l’illustre Georges Vigne, Hector Guimard, Éditions Charles Moreau & Felipe Ferré, 2003, p. 52.
[15]– Charles Naudet, qui habitait au 71 rue d’Auteuil, fut également actif rue Erlanger. Cf. Lacroux et Détain, Constructions en briques, pl. 31, et Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 4, p. 7.
[16]– L’architecte Charles Devinant habitait rue Claude Lorrain. Associé au Boulonnais Henri Désiré Poigin, il fut actif dans tout Auteuil de 1880 à 1900 environ. Cf. Philippe Thiébaut et al., catalogue de l’exposition Guimard, Paris, Gallimard, Réunion des musées nationaux, 1992, p. 57 pour un détail Art nouveau par l’agence de Devinant au 77 rue Boileau. Cf. aussi Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 2, p. 28-29.
[17]– De 1873 à 1882, Haviland a opéré un atelier de céramique au 116 rue Michel Ange, et Maximilien Luce (qui a également peint le Viaduc d’Auteuil) habitait au 102, rue Boileau vers 1900. En 1914, Auguste Perret a réalisé une maison-atelier pour Théo Van Rysselberghe, au 14 rue Claude Lorrain (voir dessins, Cité de l’Architecture, Objet PERAU-063) qui a été beaucoup modifiée.
[18]– Cf. les essais de Françoise Hamon, Maisons ouvrières, et Pauline Prévost-Marcilhacy, Villa Mulhouse, dans Isabelle Montserrat Farguell et Virginie Grandval, dir. Hameaux, villas et cités de Paris, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 1998, p. 166-170 et p. 182-185. Marie-Jeanne Dumont (Le logement social à Paris 1850-1930, Les habitations à bon marché, Liège, Mardaga, 1991, p. 179) ne mentionne que deux exemples de logements sociaux dans le XVIe arrondissement (53, rue Chardon Lagache et 87, rue Boileau), tous deux de 1911.
[19]– Cf. Vigne, Hector Guimard, p. 328. Itasse est née la même année que Guimard et est morte un an plus tôt. En 1893, ses œuvres ont été exposées au Women’s Building de l’Exposition universelle de Chicago. Guimard possédait l’une de ses œuvres, un buste féminin en céramique, exposé sur la cheminée de son cabinet de travail au Castel Béranger.
[20]– Le poète qui avait donc quotidiennement sous les yeux des architectures de Guimard ne semblait pas les apprécier outre mesure. Cf. F. Descouturelle et O. Pons « National », « Style Nouveau », « Architecte d’Art », Style Guimard » et « Style Moderne », les qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre et leur postérité, article paru sur le site du Cercle Guimard.
[21] Guillaume Apollinaire, “Le Flâneur des Deux Rives” Éditions de la Sirene, Paris, 1918 consulté sur
https://www.gutenberg.org/files/55533/55533-h/55533-h.html
[22]– Cf. Maxime Du Camp, « La Charité privée à Paris, L’orphelinat des apprentis, » Revue des deux mondes, n° 3, 1er août 1883, p. 578-612, où cet écrivain réputé, comme de nombreux observateurs extérieurs, prédit la disparition complète de l’Auteuil historique. Sur cette organisation toujours implantée rue Jean-de-la-Fontaine, cf. https://www.apprentis-auteuil.org/
[23]– Boussard (voir Dugast et Parizet, Dictionnaire par Noms, vol. 1, p. 64-65), dont le bureau est enregistré au 26 rue Ribéra en 1888 et au 38 rue Ribéra en 1891, travaillait également pour l’administration des Postes et collaborait régulièrement au Moniteur des architectes. Ses immeubles d’habitation « protégés », rue Ribéra, 5 rue Dangeau, 76-78 avenue Mozart et 1 rue de l’Yvette, tous situés à proximité des deux dernières résidences de Guimard, font l’objet d’une évaluation concise mais compétente dans Protections patrimoniales, 16ème arrondissement (téléchargeable sur http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site _statique_37/pages/page_783.html ). Les immeubles d’habitation du 8 ter rue La Fontaine, près du Castel Béranger, et du 64 rue La Fontaine, à côté de l’hôtel Mezzara de Guimard, sont des exemples étonnamment sobres de l’œuvre de Gustave Rives. Un architecte employé par le Département de la Seine, François-Albert Allain, résidait depuis longtemps au 6 rue La Fontaine. Il effectuait des petits travaux et concevait de petites structures à Auteuil, tâches auxquelles Guimard a également eu recours lorsque les autres sources de travail étaient limitées.
[24]– Élève de Victor Laloux et d’Anatole de Baudot, Richard habitait rue du Ranelagh depuis la fin des années 1890. L’hôtel particulier de 1906 qu’il a conçu avec Eugène Audiger au 40 rue Boileau pour le peintre Lucien Simon a subi des modifications importantes. Cf. Joachim Richard, notice biographique (Mathilde Dion), notice sur le fonds et sur l’architecte (Éric Furlan), Cité de l’Architecture, consulté le 22 novembre 2019, https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/pdf/asso/FRAPN02_RICJO_BIO.pdf
[25]– Alphonse Gentil et Eugène Bourdet, eux aussi élèves de Laloux à l’École des Beaux-Arts, ont fondé en 1901 à Boulogne (dans une ancienne villa construite par Guimard), une entreprise de grès émaillé proposant des produits similaires à ceux de Bigot, dans une palette de couleurs plus restreinte.
[26]– Cette plaque a été volée puis, quelques années plus tard, donnée au musée d’Orsay.
[27]– Évoluant d’un style éclectique vers un Art nouveau mesuré, Deneu de Montbrun est l’auteur de plusieurs immeubles dans le quartier, notamment 32 rue La Fontaine (1905), 77 rue Boileau, 21 et 23 avenue Théophile-Gautier. Cf. F. Descouturelle, Les fontes ornementales de l’architecte Hector Guimard produites à la fonderie de Saint-Dizier, mémoire de Master II, sous la direction de J.-F. Belhoste, EPHE, 2015.
[28] Cf. Philippe Thiébaut, « Art nouveau et néo-impressionnisme, Les ateliers de Signac, » Revue d’art, n° 92, 1991, p. 72-78.
[29]. L’influence de Guimard sur Pierre Selmersheim, inscrit à l’École des Beaux-Arts dans les mêmes années et dont le frère cadet Tony était architecte d’intérieur et collaborateur de Charles Plumet, est visible dans les dessins de cheminée et de porche de maison de Selmersheim, publiés dans Victor Champier, Documents d’atelier : Art décoratif moderne, Paris, Librairie de la revue des arts décoratifs et industriels, 1898 ; et Champier, Modèles nouveaux pour les industries d’art, Paris, Librairie de la revue des arts décoratifs et industriels, 1899, dossier Selmersheim, Documentation, musée d’Orsay. La femme de Pierre Selmersheim, Jeanne, peintre, l’a quitté pour Signac.
[30]-Dans The Architectural Record, Mazade signa “A French Dining Room of the Upper Middle-Class Type,” juillet-septembre 1895, p. 33-34 ; “Sculpture as Applied to the External Decorations of Paris Houses,” octobre 1896, p. 134-43 ; “An ‘Art nouveau’ Edifice in Paris, L’immeuble Humbert de Romans, Hector Guimard, Architect,” mai 1902, p. 53-66 ; “Les Mairies de Paris,” avril 1898, p. 401-25 ; “Living in Paris on an Income of $3000 a Year,” part 1, avril 1903, p. 349-57, part 2, mai 1903, p. 423-32, part 3, juin 1903, p. 548-5424 .
[31]– Parce qu’elle est bordée d’arbres sur toute sa longueur, la « rue » Mozart fut renommée « avenue » Mozart en 1911.
[32]– Le Mozart Palace a été transformé en Monoprix.
[33] Voir Henri Sauvage 1873-1932. A.A.M. Bruxelles et S.A.D.G Paris, 1976, p.218.
[34]– Diplômé de l’École des Beaux-Arts en 1898, Herscher habitait près du Trocadéro, où se trouve son immeuble Art nouveau le plus connu et le plus orné, au 39 rue Scheffer.
[35]– Voir par exemple l’hôtel particulier de 1925 situé juste à côté de l’immeuble de Guimard, où les architectes Félix Dumail et Jean Hébrard, auteurs de belles cités-jardins contemporaines, ne semblent ne pas avoir été du tout inspirés par le style « néo-Gabriel » sur lequel leur client a dû insister.
[36]– Voir Barry Bergdoll « Signature vs. Standardization : Guimard and Prefabrication » Hector Guimard. Art Nouveau to Modernism, sous la direction de David A. Hanks, New Haven : Yale University Press, 2021, pp. 164-176

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021
En visio-conférence (Zoom), le Bureau étant réuni au Castel Béranger, à Paris dans le 16ème arrondissement, le 27 mai 2021 à 18 h. Lors de cette assemblée, 43 adhérents étaient présents en ligne.

Ordre du jour
- Communication du rapport moral et d’activités du Président.
- Approbation des comptes et du budget.
- Renouvellement des membres du Conseil d’administration.
- Participation du Cercle Guimard à l’appel d’offres public portant sur l’Hôtel Mezzara et à la création du musée Guimard.
- Projets en cours.
- Questions diverses.

L’univers d’Alfred Jarry dans l’entourage d’Horta, de Van de Velde et de Guimard — Première partie, les Ubus bruxellois —
À la surprise, peut-être, de quelques-uns de nos contemporains, nous allons faire état dans ces articles d’une connivence qui a existé entre des milieux artistiques qui, de prime abord, avaient peu à voir entre eux. C’est pourtant ce que nous permettent deux petites études parallèles. La première relate l’existence de la société des Ubus bruxellois dont ont fait partie, vers 1900, Henry Van de Velde et certains des commanditaires de Victor Horta. La seconde nous sera fournie par le dépouillement de la revue La Critique où tant les productions guimardiennes que les productions jarryques ont été régulièrement chroniquées. Sachant que nous sommes tous des pataphysiciens inconscients[1], nous nous garderons bien cependant de présenter Henry Van de Velde ou Hector Guimard comme des pataphysiciens conscients. Nous voulons simplement mettre en lumière l’une des facettes du milieu intellectuel et artistique dans lequel ils évoluent alors.
Dans les années 1890 et 1900 l’Art nouveau est certes l’une des expressions de la modernité, mais il puise également à la source du symbolisme littéraire et pictural qui l’a précédé à partir des années 1880 et s’est parfois confondu avec lui. En témoignent les productions de nombre de figures marquantes de l’Art nouveau comme Carlos Schwabe, Alfons Mucha, Georges De Feure ou Émile Gallé qui sont largement empreintes de symbolisme. Celui-ci, dans sa réaction contre le naturalisme et le réalisme, invente un langage, notamment pictural, conçu hors du cadre spatial et temporel habituel, élaboré dans un refus du « progrès » (scientifique et même social) et plus largement du monde immédiatement accessible à nos sens. De la transmission partielle de cette esthétique découle l’une des ambiguïtés de l’Art nouveau qui met volontiers en scène la nostalgie d’une société préindustrielle exprimée par la transformation de motifs médiévaux, orientaux ou issus d’une nature non encore domestiquée, tout en revendiquant chez une bonne part de ses promoteurs, une alliance de l’art et de l’industrie.
Quant à l’œuvre d’Alfred Jarry (1873-1907), elle-même liée au symbolisme, elle a donné naissance à un univers littéraire et graphique tout à fait percutant dont le retentissement fut à la fois limité dans son audience immédiate et très puissant dans sa postérité. Sa pièce Ubu roi a tout d’abord été une geste collégienne collective, que Jarry a remaniée à de nombreuses reprises pour un théâtre de marionnettes, puis publiée en avril 1896 et mise en scène au théâtre de l’Œuvre, dirigé par Lugné-Poe, en décembre de la même année. Son personnage titre, le Père Ubu, est caractérisé tout autant par son sadisme, sa rapacité, sa goinfrerie et son absence totale de sens moral que par son imbécillité et sa veulerie. Cependant, il ne faut pas y voir la caricature d’un personnage ou d’un type social, ni la personnification de la bêtise ou des vices humains, ni même l’extériorisation du refoulement des pulsions[2], mais une figure ambivalente qui atteint une sorte de perfection dans sa monstruosité. Dans d’autres publications de Jarry, en effet, la polysémie d’Ubu se renforcera, notamment lorsqu’il se présentera comme « Docteur en ’Pataphysique », « une science que nous avons inventée et dont le besoin se faisait généralement sentir »[3] avant que Jarry ne la théorise dans la navigation de Faustroll.[4] Parallèlement à sa production littéraire et théâtrale, Jarry aura une activité de création graphique, essentiellement sous forme de dessins et de gravures sur bois. D’un style absolument original, ces œuvres fixent notamment l’aspect d’Ubu au graphisme révolutionnaire[5] avec sa tête pyriforme[6], sa bedaine qui se confond avec sa « gidouille », sa poche, son bâton et son « croc à phynance ».
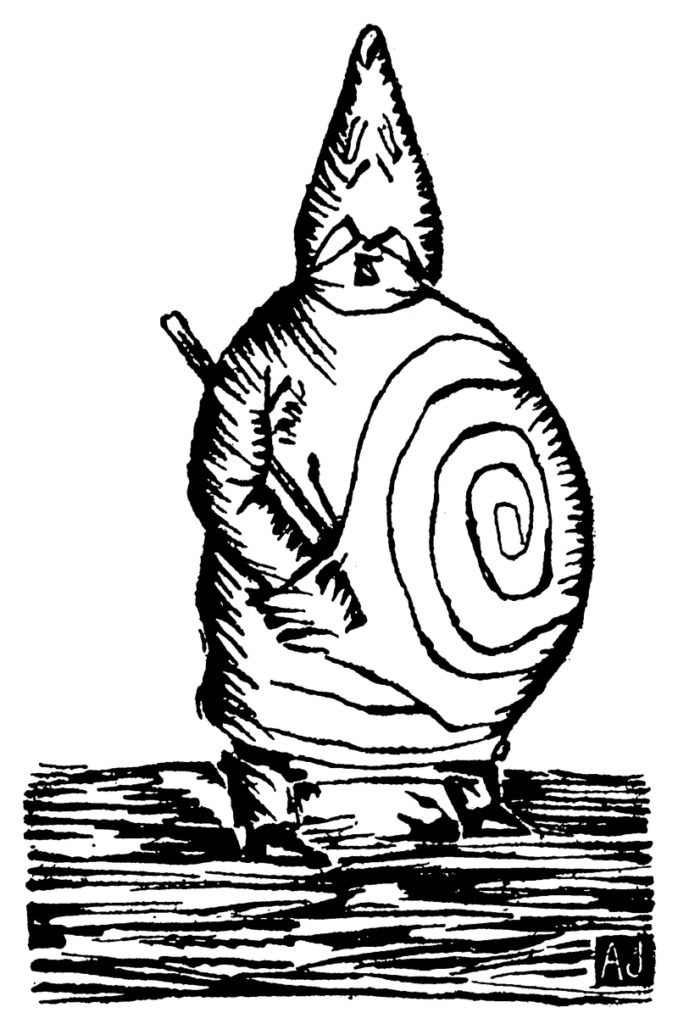
Alfred Jarry. Véritable portait de Monsieur Ubu, 1896. Gravure sur bois, 12 x 7,3 cm. Paru dans Le livre d’Art, n° 2, 25 avril-25 mai 1896, puis dans l’original d’Ubu roi, 11 juin 1896, p. 7 (in Arrivé, Michel, Peintures, gravures et dessins d’Alfred Jarry, Collège de ’Pataphysique, 1968, p. 53).
Le groupe des Ubus bruxellois
C’est grâce à notre amie bruxelloise Christine van Schoonbeek (Ubustine pour les pataphysiciens) que nous est parvenue la connaissance de l’une de ces sociétés engendrées par la zwanze[7] locale. Nous nous contentons donc (et avec sa permission) de la citer, parfois de commenter son texte, et de reproduire les illustrations parues dans son remarquable ouvrage Les portraits d’Ubu[8] :
« Au-delà des frontières, et resté inconnu jusqu’à ce jour, un groupe d’industriels et d’artistes[9] se réunit régulièrement à Bruxelles dès 1900, sous le nom générique “les Ubus”. Ils se “dénomment” individuellement : Ubutrique (Eugène Autrique), Ubugène Monseur ou Monseubur (Eugène Monseur), Petrubucci (Raphaël Petrucci), Ubu Tassel (Émile Tassel), La Mère Ubu, (la femme de ce dernier[10]), Henry van Ubuveldre (Henry Van de Velde), Ububerti (Alphonse Huberti), Lefébubure (Charles Lefébure). »[11]
Nous étoffons ci-dessous les notes de Christine van Schoonbeek se rapportant aux personnages évoqués :
Eugène Autrique (1860-1912), ingénieur, professeur à l’École Polytechnique de l’Université Libre de Bruxelles, était l’ami et le commanditaire de Victor Horta pour sa maison chaussée de Haecht en 1892. Il était aussi membre comme Victor Horta, Émile Tassel et Charles Lefébure de la loge maçonnique Les Amis philanthropes.

Eugène Autrique, photo internet.
Eugène Monseur (1860-1912) écrivain et philologue, enseignait à l’Université Libre de Bruxelles (sanskrit, histoire comparée des littératures modernes, puis grammaire comparée du grec et du latin) et était aussi spécialiste du folklore wallon. En 1901, il créa la Ligue Belge des Droits de l’Homme.

Eugène Monseur, photo internet.
Émile Tassel (1862-1922), professeur de géométrie descriptive à l’Université Libre de Bruxelles, était attaché depuis 1886 au bureau d’étude de la firme Solvay au sein duquel il avait Charles Lefébure pour collègue, lequel l’engageait à se constituer un capital en investissant dans la construction d’un hôtel particulier. Également membre de la loge maçonnique des Amis philanthropes, il chargea Victor Horta de la construction de sa maison, rue de Turin (actuellement rue Paul-Émile Janson) en 1893.

Émile Tassel, photo internet.

Vue de la cage d’escalier de l’hôtel Tassel par Victor Horta (1893-1895) après les restaurations effectuées par Jean Delhaye en 1984-1985. Photo extraite du livre Victor Horta, Hôtel Tassel, 1893-1895 par François Loyer et Jean Delhaye, éditions Archives d’Architecture Moderne, 1986.
Henry Van de Velde (1863-1967), peintre, créateur de papiers peints, de meubles et d’objets, puis architecte, était plutôt le rival que l’ami de Victor Horta. Il a joué un rôle clef dans l’éclosion et la diffusion internationale de l’Art nouveau puis du style fonctionnaliste. Menant une carrière itinérante entre Bruxelles, Paris, Berlin, Weimar (où il a créé en 1908 l’École des Arts décoratifs, ancêtre du Bauhaus), les Pays-Bas et la Suisse. Ses convictions sociales, héritées des lectures de William Morris l’ont mené à s’inscrire au Parti Ouvrier Belge et à prôner un art pour le peuple, même s’il travaillera surtout pour la haute bourgeoisie. Plus de quarante ans après ses débuts professionnels, Victor Horta, pourtant alors comblé d’honneurs, exprimera dans ses mémoires un ressentiment encore vif à son encontre, ne voulant le considérer que comme un « tapissier ».

Henry Van de Velde dans la salle à manger de sa villa Bloemenwerf, à Uccle, dans la banlieue de Bruxelles. Photo internet.
Alphonse Huberti (1841-1918) était professeur à l’Université Libre de Bruxelles, chargé du cours d’exploitation des chemins de fer à l’École Polytechnique de l’ULB. Il publiera, seul ou en collaboration, plusieurs traités sur les chemins de fer. Résident dans la commune de Schaerbeek, nous savons qu’il a participé à la vie artistique locale, notamment par le prêt d’œuvres du peintre Édouard Huberti (1818-1880).
Charles Lefébure (1862-1943) était le secrétaire personnel et l’ami de l’industriel Ernest Solvay. Également membre de la loge maçonnique des Amis philanthropes, c’est à son instigation qu’Horta reçut plusieurs commandes : celle de l’ingénieur Camille Wissinger pour son hôtel particulier, rue de l’Hôtel des Monnaies (1894-1897) et celle d’Armand Solvay, fils aîné d’Ernest Solvay, pour son fastueux hôtel particulier avenue Louise (1895-1903). En outre, Alfred Solvay (frère d’Ernest Solvay) garantira le prêt consenti par les banques auprès du Parti Ouvrier Belge et de la Société Coopérative Ouvrière pour la construction de la Maison du Peuple, commandée à Horta en 1896.
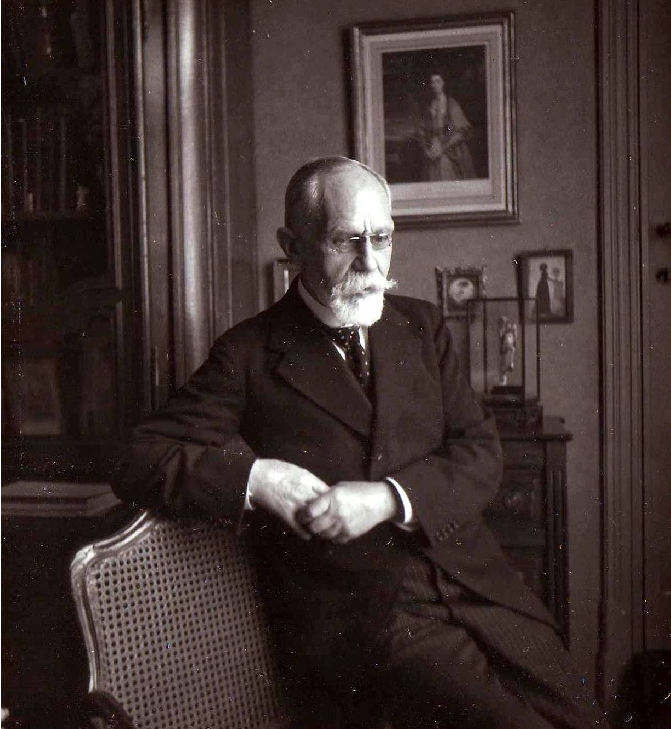
Charles Lefébure, photo internet.
Ami intime d’Henry Van de Velde et très bon photographe, Lefébure réalisera plusieurs clichés de l’intérieur et de l’extérieur du Bloemenwerf, villa construite par Van de Velde à Uccle en 1895, ainsi que des portraits de son épouse Maria Sèthe, portant des robes créées par son mari.

Maria Sèthe dans le hall du Bloemenwerf. Cliché de Charles Lefébure. Source internet. Sur le mur de gauche, on voit le portrait de Maria Sèthe (1891) par le peintre néo-pointilliste Théo Van Rysselberghe, ami d’Henri Van de Velde et de Paul Signac.
Raphael Petrucci (Naples, 1872 – Paris, 1917) sociologue-orientaliste français, travailla en Belgique de 1896 à 1914, en particulier à l’Institut de sociologie Solvay qui intègrera par la suite l’Université Libre de Bruxelles. Précédemment, vers 1889, alors à Paris, il fréquentait les artistes du cabaret du Chat Noir. Il fut également négociant d’art, mais aussi l’illustrateur d’un Candide de Voltaire[12]. Ajoutons qu’à travers son épouse Claire Verwée, Petrucci fréquenta notamment à Knokke, Rops et Demolder, amis de Jarry[13]. C’est à l’occasion de la naissance de Clairette Petrucci en 1899 qu’Henry Van de Velde a dessiné une bague destinée à Claire Verwée.

Bague créée en 1899 par Henry Van de Velde pour Claire Verwée, épouse de Raphaël Petrucci. Acquisition 2008 par les Musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles.
Notre hypothèse est que cet engouement ubuesque du groupe bruxellois est initialement introduit par Raphaël Petrucci. Les autres Ubus ont certes tous fréquenté Paris car à tous les niveaux scientifiques et industriels les échanges entre les capitales française et belge sont alors intenses et réciproques. Cependant, Petrucci est sans doute celui qui a été le plus en contact avec le milieu littéraire et culturel parisien et en particulier (pour faire simple) « montmartrois ». Reprenons le cours de l’exposé de Christine van Schoonbeek :
« […] Raphaël Petrucci a illustré par une série d’aquarelles réalisées pour ses amis, des exemplaires de l’Ubu enchaîné, précédé d’Ubu roi paru en 1900 [qui] débute par une véritable poire aux traits d’Ubu […] Dessinée en regard de la dédicace imprimée par Jarry à Marcel Schwob, la déformation piriforme d’Ubu, peu accentuée sur les autres dessins de Petrucci, devient une caricature de Shakespeare (la dédicace, on s’en souvient énonçait : “le Père Ubu hoscha la poire, dont fut depuis nommé par les Anglois Shakespeare”). »[14]

Raphaël Petrucci. Aquarelle d’un exemplaire d’Ubu roi et Ubu enchaîné. Club Ubu, c. 1900. Reproduit dans Les Portraits d’Ubu, p. 75.
D’après Christine van Schoonbeek,
« Les reliures et gardes “au couteau à phynance” […] ont probablement été réalisées d’après les dessins [… d’] Henry Van de Velde[15]. Le terrible attribut du héros se retrouve ainsi décliné avec raffinement comme un pur motif décoratif. »[16]

Reliure d’Ubu enchaîné précédé d’Ubu Roi, Paris, La Revue Blanche, 1900, relié vers 1900 pour le « Club Ubu ». Reproduit dans Les Portraits d’Ubu, p. 75. Deux exemplaires (celui de Raphaël Petrucci et celui de Charles Lefébure) ainsi que des « discours manuscrits, lettres et cartons nominatifs de table du Club Ubu » étaient présents à Bruxelles, lors de la double exposition Jarry Ymagier / Ecce Ubu organisée par Christine van Schoonbeek à Bruxelles et à Namur en 1997.
Dans une des aquarelles de Petrucci illustrant Ubu enchaîné (1900), le Père Ubu se fait volontairement fouetter par Pissedoux. Nous n’hésitons pas à y voir une amusante analogie avec le style d’Horta, dont la ligne est souvent décrite comme étant « en coup de fouet ».

Raphaël Petrucci. « Eh ! Quelle gloire, cette lanière obéit à toutes les courbes de ma gidouille. » Aquarelle, c. 1900. Reproduite dans Les Portraits d’Ubu, p. 74.
Mais que font exactement ces Ubus bruxellois ? Ils semblent avoir tout d’abord retenu que le Père Ubu aimait avant tout « manger fort souvent de l’andouille »[17] :
« De nombreux discours ou décrets insistent sur le rôle essentiel de Tassel. Ce dernier recevait les “Ubus” à sa table chaque jeudi. Hospitalité tellement appréciée qu’il était consigné à résidence : “sa manne hebdomadaire, apanage de ses devoirs royaux est devenu une nécessité de tout premier ordre pour la noblesse polonaise […]. Que la suspension du déjeuner Ubuesque ce jeudi 10 mai de l’an 1900 pouvait amener les plus graves conséquences [description d’une litanie de troubles]. Quand, à la rigueur, l’un des membres de la Noblesse Polonaise peut être admis à s’absenter, cette tolérance ne saurait s’étendre au cy-dessus nommé Roi-Esclave Ubu Tassel dont la présence est nécessaire à la sustentation et perpétuation de la vie des nobles. Attendu qu’il ne saurait être excusé par l’ordre reçu du Sénateur – Docteur en Pataphysique, Alpiniste[18] – Comptabiliste, Son Maître, puisqu’il a librement choisi sa fonction d’Esclave afin de mieux garantir Sa propre indépendance” ».[19]
« […] Une des aquarelles de Petrucci, représentant la scène où “Père et Mère Ubu reçoivent à dîner Capitaine Bordure et ses partisans” — citation d’Ubu Roi (Acte I, scène 3) — est en réalité une mise en scène du groupe lui-même dont les réunions étaient “sauciales[20]” avant tout. L’identification va même plus loin dans la mesure où la “chambre de la maison du Père Ubu” dans laquelle “une table splendide est dressée”, représente la salle à manger de la maison de Tassel où avaient lieu les réunions des “Ubus” avec son papier peint, ses chaises et son lustre majestueux dessiné par Horta. »[21]
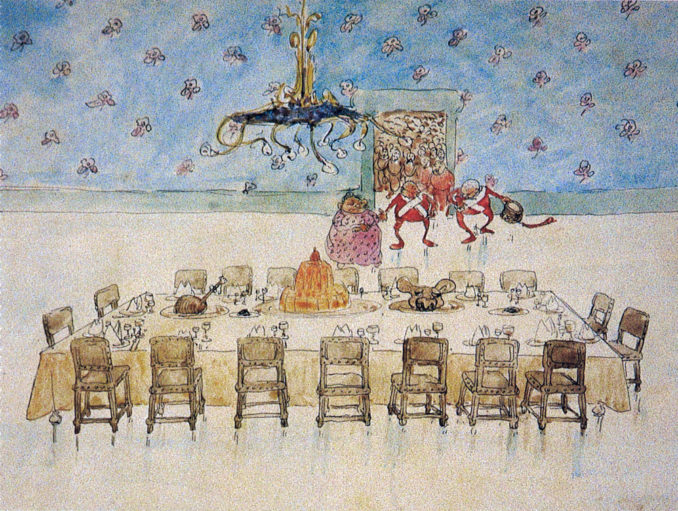
Raphaël Petrucci. « Bonjour Messieurs, nous vous attendions avec impatience. Asseyez-vous. » Aquarelle, c. 1900. Reproduite dans Les Portraits d’Ubu, p. 76.
Cette aquarelle mérite une large digression. Tout d’abord, il faut admettre qu’elle représente une vue très déformée de ce qu’était réellement la salle à manger de l’hôtel Tassel. Celle-ci était placée au fond du bâtiment, dans son axe médian, éclairée à l’arrière par un bow-window donnant sur le (très petit) jardin mais aussi à l’avant par le puits de lumière central au niveau du jardin d’hiver et de la cage d’escalier. Elle était accessible par le salon et desservie par la cuisine en sous-sol. Les invités se présentaient donc par l’avant et non latéralement comme on le voit sur l’illustration de Petrucci.
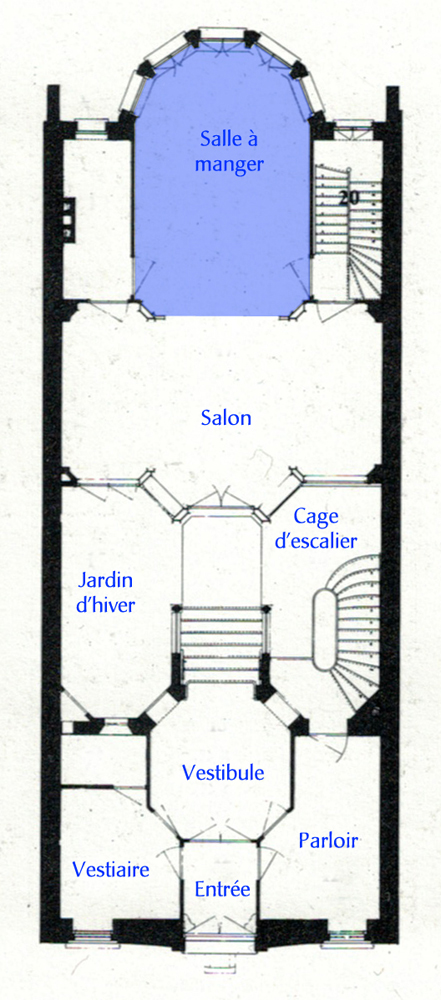
Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel Tassel. D’après un plan de Jean Delhaye.
À la différence des autres pièces du rez-de-chaussée, la salle à manger n’a pas fait l’objet d’un cliché d’époque la représentant dans son ensemble, sans doute parce que son ameublement n’a pas été réalisé d’emblée par Horta. En effet, dans un premier temps, Tassel n’a pas fait la dépense d’un tel mobilier. Mais il devait quand même être désireux d’équiper sa nouvelle demeure en style moderne puisque nous savons qu’il s’est rendu en compagnie de Horta à Paris, en juillet 1895, à la galerie L’Art Nouveau Bing pour y acheter des meubles[22]. La photographie dont on dispose, prise cette même année, montre seulement une vue partielle de la salle à manger vers le salon. Une portion de chaise peut néanmoins y être aperçue. Elle est de style néo-Renaissance, comme celles qui sont dessinées sur l’aquarelle de Petrucci.

Vue partielle de la salle à manger vers le salon de l’hôtel Tassel. Cliché pris en 1895, paru dans L’Émulation, reproduit dans le livre Victor Horta, Hôtel Tassel, 1893-1895 par François Loyer et Jean Delhaye, éditions Archives d’Architecture Moderne, 1986.
On sait qu’un peu plus tard, en 1898, Tassel a commandé à Horta un salon et une salle à manger[23]. Sans doute les chaises que l’on peut voir sur une seconde vue partielle de la salle à manger correspondent-elles à cette commande ultérieure.

Vue partielle du fond de la salle à manger de l’hôtel Tassel. On remarque la présence de chaises de Victor Horta. Date de la prise de vue inconnue. Photo internet.
Le lustre de la salle à manger représenté sur l’aquarelle de Petrucci est clairement une création d’Horta. Il s’apparente à celui qu’il a présenté au sein d’une salle à manger complète à l’exposition de La Libre Esthétique en 1897 ou au lustre de la salle à manger de la maison Frison ou encore à l’un des lustres du château de La Hulpe des Solvay en 1895, alors que la petite portion visible sur la photo de l’hôtel Tassel de 1895 appartient à un lustre de style néo-Renaissance[24]. Il est bien possible qu’après 1895, Horta ait fourni à Tassel un lustre de style moderne ou que tout simplement, là aussi, il ne faille pas prendre l’aquarelle de Petrucci pour un document descriptif historique.
Enfin, les papiers peint floraux hâtivement figurés sur l’aquarelle de Petrucci posent moins de problème. En effet, au contraire de Guimard qui s’est attelé semble-t-il dès 1895 à la création de modèles de papier peints, Horta a préféré la réalisation de motifs muraux originaux peints sur les murs ou la pose de papiers peints anglais. À une époque où son antagonisme avec Van de Velde n’est pas encore consommé, ce dernier est intervenu dans l’hôtel Tassel pour le choix des papiers peints[25]. À partir des photos anciennes, on peut identifier aux murs de la salle à manger de l’hôtel Tassel le papier peint de Charles F. A. Voysey, Elaine, édité par Essex & Co[26].
Les Ubus bruxellois s’amusent donc avec les personnages de Jarry et tout particulièrement le Père Ubu. Celui-ci est en quelque sorte leur exact opposé, car il est bien évident que ce cercle amical est composé de personnalités progressistes. Il comprend une majorité de professeurs de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) qui a été fondée en 1834 en réaction à la création la même année de l’université catholique de Malines[26], avec la volonté de diffuser la philosophie des Lumières. L’ULB recevra ultérieurement plusieurs dotations des frères Ernest et Alfred Solvay lui permettant de créer une école de commerce renommée. Comme nous l’avons vu plus haut, c’est encore dans l’entourage de ces deux industriels de la chimie que gravitaient plusieurs membres des Ubus bruxellois. Dans ses commencements, L’ULB a été fortement liée à la loge maçonnique la plus influente de Bruxelles, celle des Amis philanthropes. On y retrouvait, outre Victor Horta, nombre de ses clients. Avant-gardiste, cette loge a également œuvré à la création en 1864 de la première école de filles d’enseignement non-confessionnel de Bruxelles. Elle a aussi favorisé la fondation en 1885 du Parti Ouvrier belge, ancêtre du Parti Socialiste belge. Au sein de ce dernier, une Section d’Art a été créée en 1891. Enfin la loge des Amis philanthropes et le POB ont lutté pour l’établissement du suffrage universel en Belgique, partiellement obtenu en 1893.
Curieusement, on trouve dans ce groupe des Ubus bruxellois une personnalité qui n’est ni professeur à l’ULB, ni membre de la loge des Amis philanthropes, ni généralement associé à l’entourage des frères Solvay. Il s’agit d’Henry Van de Velde[27] dont la présence est sans doute due à son amitié avec Charles Lefébure. Son départ de Bruxelles en 1901 pour s’installer à Berlin
« […] nécessitera l’approbation de ses camarades, les Ubus : “Nommons le cy-devant Noble Polonais, […] le récidiviste Henry Vanubuveldre Ambassadeur Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, dans les pays barbares et lointains de nos féaux amys Barubusses, Franckx, Allemands, Germains, Bavarois, Saxons, Poméraniens, Baltes et Moscovites […] afin qu’il […] représente avec éclat notre puissance d’ailleurs universellement reconnue.” »[28]
Mais il n’est pas impossible que cette présence de Van de Velde ait justement engendré l’absence dans le groupe de Victor Horta dont le profil (professeur à l’ULB, membre de la loge des Amis philanthropes et architecte de l’hôtel particulier d’Armand Solvay) était pourtant plus proche de celui des autres Ubus. Peut-être faut-il ajouter à cela qu’Horta n’était sans doute pas ce que la Zazie de Raymond Queneau aurait qualifié de « ptit marant ». Sans réelle connaissance de la jovialité de son caractère ni de sa vis comica aux alentours de 1900, on peut tout de même noter qu’Horta rapporte lui-même dans ses mémoires que ses compagnons de loge le surnommaient « l’Archisec », ne semblant pas soupçonner que ce qui est sec est bien souvent cassant. Le ton même de ces mémoires, rédigées bien plus tard, laisse tout de même transparaître beaucoup d’aigreur vis-à-vis de nombre de ses confrères et d’artistes bruxellois.
Commodément installés dans la vie matérielle, fortement insérés dans la vie sociale, confiants dans le progrès de l’humanité et dans l’avenir, les Ubus bruxellois pouvaient sembler bien éloignés de l’existence famélique et de l’absence d’engagement politique d’Alfred Jarry. Mais, animés par un vif désir de bousculer les choses, ils avaient, qui plus est, suffisamment de recul sur leur propre mode de pensée pour s’identifier par dérision ou par ambivalence à celui qui proclame :
« Avec ce système, j’aurai vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m’en irai. » (Ubu roi, Acte III, scène 4).
Frédéric Descouturelle (Q. O. S. S. de l’A. des Q.)
avec l’aimable et vigilante participation d’Ubustine (portraitiste du Père, Grand officieux O. G. G., dataire détachée à Bruxelles)
Bibliographie :
Caradec, François et Arnaud, Noël, sous la direction de, Encyclopédie des farces et attrapes et des mystifications, Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1964.
Dulière, Cécile, Victor Horta, Mémoires, édité par le Ministère de la Communauté française de Belgique, 1985.
Loyer, François et Delhaye, Jean, Victor Horta, hôtel Tassel, 1893-1895, éditions Archives d’Architecture Moderne, 1986.
Aubry, Françoise et Vandenbreeden, Jos, Horta, Naissance et dépassement de l’Art nouveau, catalogue de l’exposition, éditions Ludion/Flammarion, 1996.
van Schoonbeek, Christine, Les Portraits d’Ubu, éditions Séguier, 1997.
Jarry Ymagier / Ecce Ubu, Musée Félicien Rops — Maison du spectacle la Bellone, Namur — Bruxelles, 1997 : brochure-inventaire de l’exposition Jarry-Ubu (Christine van Schoonbeek, commissaire de l’exposition).
Aubry, Françoise, Horta ou la passion de l’architecture, éditions Ludion, 2005.
Motifs d’Horta, étoffes et papiers peints dans les maisons bruxelloises, catalogue de l’exposition à la maison Autrique à Bruxelles du 18/04/2018 au 27/01/2019.
Notes :
[1] Parmi la population passée, présente et à venir, le pataphysicien fait la distinction entre les pataphysiciens inconscients (tout le monde) et les pataphysiciens conscients, c’est à dire éveillés à la ’Pataphysique. Comme l’a fort bien montré Boris Vian, un pataphysicien conscient qui chercherait à « faire » de la ’Pataphysique agirait dès lors nécessairement en pataphysicien inconscient.
[2] Breton, André, Anthologie de l’humour noir, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 273.
[3] Jarry, Alfred, Ubu intime, pièce en un acte, 1894.
[4] Jarry, Alfred, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, achevé en 1898, publication posthume en 1911.
[5] van Schoonbeek, Christine, Alfred Jarry, un oublié de l’histoire de l’art, in Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles, 1995, Vol. XVII.
[6] Christine van Schoonbeek dans ses Portraits d’Ubu (cf. note infra) a montré qu’il s’agissait d’une évocation de la fameuse caricature du roi Louis-Philippe par Charles Philipon en 1834.
[7] Blague, mystification, la zwanze s’est épanouie à Bruxelles entre le XIXe et le XXe siècle, avant que la bruxellisation ne change l’aspect et la mentalité de la capitale brabançonne. C’est bien à Bruxelles au mitan du XIXe siècle qu’est née l’une de ces sociétés parodiques parmi les plus complexes qui fut, mais aux préoccupations en bonne partie « sauciales », celle des Agathopèdes.
[8] van Schoonbeek, Christine, les Portraits d’Ubu, éditions Séguier, 1997.
[9] Nous dirions qu’il s’agit plutôt d’intellectuels et d’artistes dont plusieurs sont en contact avec le monde de l’industrie.
[10] En réalité, Émile Tassel était célibataire et vivait avec sa grand-mère.
[11] Cf. note 8, p. 72.
[12] Biographie nationale (Émile Bruylant), Académie Royale des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. T. 33, fasc. 2, 1966, p. 585-590.
[13] Communication à Christine van Schoonbeek de Claire Wolfers, petite fille de Raphaël Petrucci et petite-fille du grand joailler, sculpteur et artiste décorateur bruxellois Philippe Wolfers, lui-même ami de Victor Horta.
[14] Cf. note 8, p. 72.
[15] En nous plaçant d’un point de vue strictement stylistique, nous sommes plus hésitant quant à cette attribution à Van de Velde qui provient de la tradition familiale Petrucci-Wolfers.
[16] Cf. note 8, p. 72.
[17] Ubu roi, Acte I, scène 1.
[18] Cette qualité permet d’identifier Charles Lefébure qui pratiquait l’alpinisme.
[19] Cf. note 8, p. 76.
[20] Cf. note 7.
[21] Cf. note 8, p. 76.
[22] Agenda de Victor Horta en date du 20 juillet 1895.
[23] Françoise Aubry, Horta ou la passion de l’architecture, éditions Ludion, 2005.
[24] La lustrerie d’origine ayant disparu lors du rachat de l’hôtel Tassel par Jean Delhaye en 1976, ce dernier a repris, pour la restauration des divers lustres de la maison, la silhouette de celui qui était au niveau de la cage d’escalier.
[25] Agenda de Victor Horta en date du 8 décembre 1894 : « visite chez Tassel avec Van de Velde ». Van de Velde est alors le représentant de plusieurs maisons anglaises de papiers peints.
[26] En plus du papier peint Elaine posé dans la salle à manger, on est certain de la présence d’une autre création de Charles F. A. Voysey : The Astolat, posé aux murs du bureau du premier étage de l’hôtel Tassel. Tous deux sont imprimés à la planche par Essex & Co et sont des créations très récentes puisqu’on les date vers 1893.
[27] Fondée à Malines, cette université déménagera un an plus tard à Louvain et se fera appeler Université Catholique de Louvain.
[28] Christine van Schoonbeek nous signale cependant l’existence d’une reliure et d’un travail graphique demandés par Ernest Solvay à Henry Van de Velde publié à Bruxelles en 1900 : Alexandre Solvay, Pensées et maximes glanées.
[29] Cf. note 8, p. 72.

Ceci n’est pas un Guimard : une paire de chenets en fonte
Notre correspondant allemand Michael Schrader a récemment attiré notre attention sur une paire de chenets qui a été mise en vente le 12 novembre 2020 pendant quelques heures sur le site Proantic. Ce site sert d’intermédiaire à des antiquaires, en l’occurrence une galerie du marché Paul Bert aux Puces de Saint-Ouen.
Les chenets étaient alors attribués à Hector Guimard avec un prix de vente fixé à 2800 €. L’annonce faisait état du matériau (de la fonte), de la présence d’une patine verte usée et de traces de rouille. Elle donnait aussi les dimensions : largeur 27 cm, hauteur 39,5 cm, profondeur 41,5 cm.

Paire de chenets art nouveau aux visages féminins, en vente sur le site Proantic le 12 novembre 2020. Coll. part.
Comme sur tous les chenets de ce type, une barre en fer forgé horizontale est vissée à l’arrière de la façade frontale pour recevoir les bûches.

Paire de chenets art nouveau aux visages féminins, en vente sur le site Proantic le 12 novembre 2020. Coll. part.

Paire de chenets art nouveau aux visages féminins, en vente sur le site Proantic le 12 novembre 2020. Coll. part.
L’élément frontal possède à la fois une forme et une assise triangulaire qui assurent une bonne stabilité au chenet. On peut y distinguer quatre décors différents. À la base, un motif abstrait ajouré semble étiré vers l’avant à partir du centre et des extrémités latérales pour venir reposer au sol. Au milieu, un motif naturaliste est constitué de deux profils féminins dont les cheveux s’entremêlent au centre. Au-dessus, naissant entre les deux visages, une feuille stylisée et ajourée s’insère sous le dernier décor qui termine le chenet par une pointe, à nouveau constituée de lignes abstraites mais faisant songer à un gâble médiéval.

Paire de chenets art nouveau aux visages féminins, en vente sur le site Proantic le 12 novembre 2020. Coll. part.
En si peu d’espace on retrouve donc les principaux types de décor rencontrés sur beaucoup d’œuvres de style Art nouveau : les arrangements harmoniques de lignes abstraites et fluides, l’évocation de la nature avec la feuille, la référence au Moyen-Âge et surtout ces profils féminins qui assurent la plus grande partie de l’effet visuel. Le thème de la figure féminine est alors des plus fréquemment utilisés, d’autant plus que la souplesse du corps et de la chevelure s’allient particulièrement bien aux lignes sinueuses abondamment employées. Que ce soit sur le continent européen ou aux États-Unis, on compte un nombre infini de motifs féminins aux cheveux démesurément longs qui semblent animés d’une vie propre. Si ces coiffures sont le plus souvent apprêtées, mises en valeur par un chapeau, des fleurs ou des bijoux, il n’est pas rare de les trouver à l’état naturel, comme sur de nombreux objets en étain ou en métal argenté manufacturés par la firme allemande WMF.

Détail d’un plat en étain WMF. Photo internet.
Mais les figures de ce chenet sont encore plus proches d’une illustration de Paul Berthon pour la revue L’Image.

Paul Berton, Illustration pour L’Image, n° 8, juillet 1897. Coll. part.
Ces chenets à figures féminines sont en fait la version « riche » d’un modèle plus souvent rencontré et qui est presque toujours attribué à Guimard. Également de forme générale triangulaire, mais plus petit et plus simple, il ne comprend que des volumes et des lignes abstraites. L’idée d’étirement de la matière que nous avons signalée au niveau de la base du modèle riche, est à nouveau utilisée à mi-hauteur, de part et d’autre des bords latéraux. À la pointe supérieure, le motif a été transformé en une sorte de volute qui pourrait évoquer une flammèche ou la fumée du feu.

Paire de chenets en fonte, en vente chez Westland Antiques Londres, n° 10047. Photo internet.
C’est bien entendu l’emploi d’un décor abstrait qui rapproche ce modèle des créations de Guimard sans qu’on puisse pourtant y retrouver son modelage caractéristique. Parmi les différentes ventes effectuées, nous avons choisi un exemplaire qui se trouve actuellement proposé à Londres au prix de 2700 £ chez un prestigieux antiquaire spécialisé dans les cheminées et leurs accessoires : Westland Antiques. Son site en montre de bonne photos, en donne les dimensions (largeur : 20 cm, hauteur : 26,7 cm, profondeur : 41 cm) et l’attribue bien sûr à Hector Guimard « designer of the Parisian Metro decorative ironwork ». Mais il révèle aussi l’existence d’une marque de fonderie « a GF Anchor » (un GF dans une ancre). Ce code à double lettre commençant par un G rappelle étrangement celui des fontes Guimard éditées à Saint-Dizier qui commencent toutes par un G (GA, GB, GC, etc.). Mais, à notre connaissance, la fonderie de Saint-Dizier n’a jamais utilisé une ancre comme marque[1].

Paire de chenets en fonte, en vente chez Westland Antiques Londres, n° 10047. Photo internet.
Or, dans le même temps, le propriétaire des chenets aux visages féminins nous a contacté pour s’informer plus avant et nous a adressé des photographies plus complètes qui nous ont permis de mieux visualiser la marque de fonderie, laquelle s’est révélée être un « CF » et non un « GF ». Elle était accompagnée du n° 17 (alors que le modèle simple porte le n° 12), ainsi que de la mention « déposé »[2].

Détail de la face postérieure d’un chenet aux visages féminins, avec la marque de fonderie et le numéro de série.
Nous avons alors sollicité notre réseau de correspondants de l’ASPM (Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Métallurgique Haut-Marnais) qui en un temps record nous a répondu en identifiant formellement la fonderie Camion Frères à Vivier-au-Court dans les Ardennes, une commune rurale de la vallée de la Vrigne au passé métallurgique très important. Les Camion qui se sont établis à Vivier-au-Court en 1820 descendaient d’un maître de forges très connu dans les Ardennes au XIXe siècle, Nicolas Gendarme, qui était propriétaire du haut-fourneau de Vendresse.

Jeton publicitaire de Camion Frères en aluminium. Vente CGB.FR numismatique Paris, 5 octobre 2015.
Leur production de fer, cuivre, fonte, nickel et aluminium a essentiellement été celle d’objets domestiques et de quincaillerie : fers à repasser, instruments de cuisine, boîtes aux lettres, heurtoirs, poulies, articles pour voitures, etc.

Couverture du catalogue Camion Frères, 1895. Portail du Patrimoine Culturel, Site de Champagne Ardennes.
La fonderie Camion Frères a encore produit d’autres modèles de chenets, eux aussi pourvus d’une partie frontale vaguement triangulaire.

Paire de chenets en fonte Camion Frères. Vente Tessier Serrou à l’hôtel Drouot, 21 mars 2016, lot n° 38, non identifiés et annoncés « dans le goût des créations d’Hector Guimard », estimation 300-400 €. Dimensions : haut. 28 cm, long. 40 cm.
De même que pour les chenets Camion Frères n° 12, ils ont connu une version plus riche qui portent cette fois le n° 18. Ils sont enjolivés de profils féminins plus sages que sur les n° 17.

Paire de chenets en fonte Camion Frères n° 18, en vente sur Catawiki.de. Photo internet.

Détail de la face postérieure d’une paire de chenets en fonte Camion Frères n° 18, en vente sur Catawiki.de. Photo internet.
La fonderie Camion frères a également produit d’autres accessoires de cheminée dans la même veine comme ce serviteur ornée lui aussi d’une figure féminine à longs cheveux.

Serviteur de cheminée en fonte produit par la fonderie Camion Frères. Photo Marie-lise Weingartner. le Grenier du passé présent à Soissons (avec son aimable autorisation).
Aucun des modèles de chenets Camion Frères n’ayant été conçu par Guimard, la question de leur attribution se pose toujours. Cette question revient en fait pour la quasi-totalité des produits manufacturés pour lesquels une intention artistique, ou au moins décorative, a été recherchée. Les archives des entreprises, aujourd’hui lacunaires, sont très discrètes à ce sujet. Pour la fonte d’art, il est fréquent que les catalogues mentionnent le nom des sculpteurs qui ont vendu le droit de reproduction de leur modèle car leurs noms, quand ils bénéficient d’une certaine notoriété, sont valorisant à la fois pour le fabricant et pour le client. Mais dans le domaine de l’art décoratif, à part quelques modèles achetés à des artistes décorateurs connus, la chose est plus rare. Tous ces modèles n’ont pas été créés au sein de l’entreprise (la fonderie en l’occurrence) mais ont été achetés à prix ferme à une cohorte d’artistes industriels restés anonymes et dont on soupçonne qu’ils étaient en majorité parisiens. Les grandes fonderies avaient d’ailleurs des magasins d’exposition et des bureaux dans la capitale où pouvaient se traiter ce genre d’affaire. Pour le style moderne d’alors, la plus grande partie de l’élaboration des modèles s’est faite à Paris où les créateurs pouvaient s’imprégner plus facilement des évolutions stylistiques en cours.
De très nombreux autres modèles de chenets ont été créés dans le style Art nouveau, qu’ils aient été produits en série par une fonderie comme les précédents ou qu’ils soient le fait d’un travail artisanal, souvent de très haute qualité comme celui des ferronniers d’art Edgar Brandt ou Edouard Schenck. Citons également à titre d’exemple une paire de chenets particulièrement élégante et intéressante qui a été attribuée en vente à Tony Selmersheim, mais sans notion bibliographique.

Paire de chenets attribués à Tony Selmersheim. Vente Millon à Drouot, 7 décembre 2017, lot n° 108. Dimensions : haut. 28 cm, larg. 13,5 cm, prof. 48 cm. Vendus 4420 € avec les frais.
Enfin, n’oublions pas le foyer créatif indépendant et presqu’autonome de Nancy qui compte quelques beaux modèles de chenets.

Paire de chenets et pare-feu au motif d’épis de blé en bronze par Louis Majorelle. Photo internet.
Pour sa part, Guimard, qui a conçu de nombreuses cheminées, n’a pas manqué de s’intéresser à leurs accessoires. Dès 1903, il a présenté une grille à houille en fonte dans son pavillon de l’Exposition de l’Habitation .
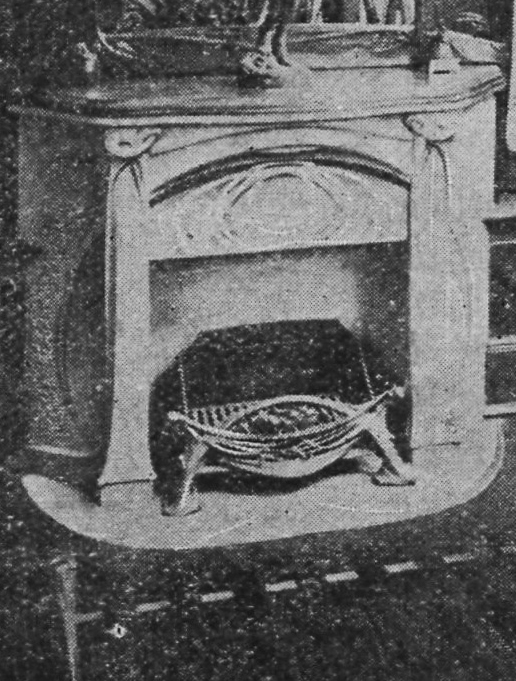
Grille à houille présentée devant une cheminée en lave émaillée dans le pavillon de Guimard à l’Exposition de l’Habitation de 1903. Détail d’une photo parue dans le Gil Blas, octobre 1903.
Cette grille reparaîtra un peu plus tard au sein des catalogues des fontes Guimard qui seront éditées à Saint-Dizier à partir de 1908.
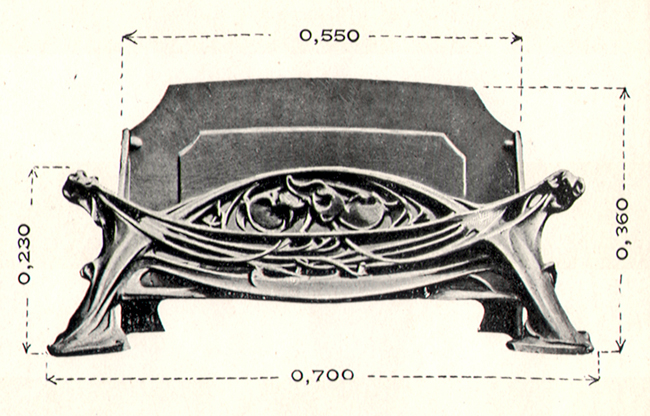
Grille à houille par Guimard, catalogue des fontes Guimard à Saint-Dizier, à partir de 1908, pl. 60. Hauteur de la façade 23 cm, largeur de la façade 70 cm, hauteur du fond 36 cm, largeur du fond 55 cm, poids 36 kg.
Toujours dans ces catalogues de la Fonderie de Saint-Dizier dédiés aux seules créations de Guimard, on trouve, outre plusieurs modèles d’intérieurs de cheminées,

Intérieur de cheminée GB par Guimard, catalogue des fontes Guimard à Saint-Dizier, à partir de 1908, pl. 61.
une poignée de rideau métallique de foyer,

Poignée de rideau GA par Guimard, catalogue des fontes Guimard à Saint-Dizier, à partir de 1908, pl. 60.
et enfin une paire de chenets qui semble être le seul modèle qu’il ait dessiné. Il a concentré le décor à la moitié supérieure, alors que la base est sobrement évasée.
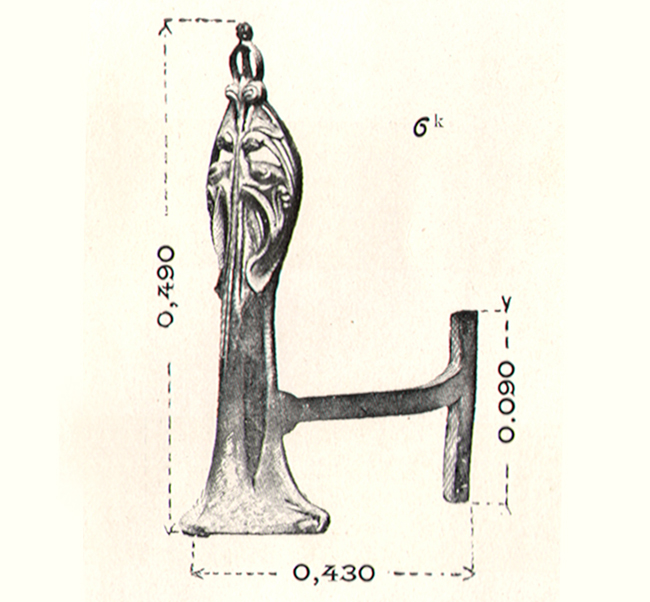
Chenet GA par Guimard, catalogue des fontes Guimard à Saint-Dizier, à partir de 1908, pl. 60.
D’une hauteur de 49 cm, ils sont vendus en quatre profondeurs différentes : 33, 36, 39 et 43 cm obtenues par le vissage à l’arrière de barres de fer de différentes longueurs.

Chenets GA par Guimard. Coll. part.
Guimard en possédait lui-même une paire, initialement dorés, au sein de son propre hôtel particulier, 122 avenue Mozart à Paris.

Paire de chenets GA par Guimard, provenant de l’hôtel Guimard, traces de dorure. Coll. du musée de l’École de Nancy.
Cette finition dorée ne devait pas être si rare puisque nous en connaissons une autre paire qui conserve également des traces de dorure.

Chenet GA par Guimard, traces de dorure. Coll. part.
Frédéric Descouturelle, avec la collaboration de Michael Schrader
Remerciements
Nous remercions vivement nos amis de l’ASPM, Sylvain Roze, Dominique Perchet et Élisabeth Robert-Dehault pour l’identification de la marque Camion Frères et l’historique de la fonderie.
Notes
[1] Même si le journal de la métallurgie locale s’appelait L’Ancre. Ce motif de l’ancre est alors très populaire pour les marques d’entreprises. On se souvient qu’il était aussi utilisé pour les horloges Farcot et les faïences de l’entreprise Fives-Lille, dont certaines productions ont bien souvent été attribués à Guimard.
[2] Cette mention signifie qu’un dépôt a été effectué auprès du greffe du tribunal de Commerce.

Les relations amicales du couple Guimard-Oppenheim en 1908-1909
À partir de la liste des convives du repas de fiançailles offert par le couple Guimard-Oppenheim le 30 janvier 1909 ainsi que celle des témoins présents lors des cérémonies civile et religieuse lors de leur mariage le 17 février 1909, j’ai cherché à tracer les relations amicales que le couple entretenait.
I. Les fiançailles d’Adeline et d’Hector
I.1 Les annonces dans la presse
Les fiançailles d’Adeline Oppenheim et d’Hector Guimard sont annoncées le 18 décembre 1908 dans le journal Gil Blas comme suit :
« Mademoiselle Adeline Oppenheim, jeune artiste peintre américaine vient de se fiancer avec Monsieur Hector Guimard, architecte. »
Quelques semaines plus tard, le samedi 30 janvier 1909, une seconde annonce paraît simultanément dans deux autres journaux Le 19ème siècle : journal quotidien ainsi que Le Rappel :
« Cette semaine ont été fêtées les fiançailles de l’architecte d’art Hector Guimard avec Mademoiselle Adeline Oppenheim, l’une des artistes peintres les plus appréciées de la haute société américaine de Paris. »[1]
Outre la fantaisie des dates, on peut déceler un parti-pris différent dans la rédaction des annonces précédentes : dans la première, celle de la mi-décembre 1908, le couple Guimard-Oppenheim souhaite une certaine intimité en ne déclarant pas la date précise de leur engagement réciproque. De plus, le statut social des deux fiancés est purement informatif. D’Adeline il est dit qu’elle est jeune et peintre et d’Hector qu’il est architecte.

Portrait photographique (par Nadar) du peintre Henri-Léopold Lévy, professeur d’Adeline Oppenheim. Photo Wikipédia.
En revanche, dans les annonces subséquentes, celles de fin janvier 1909, le statut professionnel et social du couple est mis en avant avec force. Hector, tout comme Adeline, sont de grands artistes. Cette fois-ci, le message met plus en avant Hector en le plaçant en premier. Ces deux annonces ont pour mérite d’être plus informatives que la première, car les noms de certains invités du dîner de fiançailles y sont mentionnés. Les voici dans l’ordre utilisé dans les deux annonces :
« Le Dr et Mme Coyon, M. Evain, Conseiller municipal, l’artiste décorateur Gaston Couty, le poète et Mme Alcanter de Brahm, MM. Georges Bans, Lionel Nastorg, notre confrère et Mme, Fernand Hauser, MM. Girard, Chiza,[2] Renault … »

Les signalisations d’entrée et de sortie des accès de métro de Guimard
Le sujet de cet article qui concerne un aspect infime de l’œuvre de Guimard, avait déjà été abordé dans le livre consacré au métro[1]. Mais le besoin de l’approfondir s’est imposé à nous par la découverte d’une image ancienne inédite au sein d’un article de la presse étrangère d’époque[2]. L’étude de ces panneaux d’entrée et de sortie apporte une nouvelle preuve de l’attachement extrême qu’avait Guimard pour le traitement de chaque détail de ses œuvres. Elle touche aussi à un sujet beaucoup plus vaste que nous ne ferons ici qu’effleurer et qui est celui des dessins de lettrages. Cet exercice dans lequel Guimard s’est complu tout au long de sa carrière, a entrainé la création d’un très grand nombre de titres, d’en-têtes et de mentions sans que jamais il ne veuille fixer ses lettrages par le dépôt d’une ou de plusieurs polices de caractères. Au contraire, la liberté virtuose de son dessin, avec ses infinies variations, lui a permis d’individualiser presque chaque mention qui devenait ainsi un véritable logotype.
1- Les dédoublements d’accès
Rappelons que Guimard n’est réellement intervenu que sur les deux premiers chantiers du métro de 1900 à 1902. Par la suite, la CMP ayant récupéré les droits de ses modèles en 1903[3], elle continuera à installer des accès Guimard en les adaptant à des largeurs de trémies très diverses.
Sur le premier chantier en 1900, la plupart des stations n’avaient qu’un seul accès qui servait à la fois à l’entrée et à la sortie[4]. Le choix de la mise en place d’un accès unique était tout simplement motivée, pour la Ville comme pour la CMP, par une recherche d’économie, au mépris de la sécurité[5]. De même, toutes les stations des deux tronçons souterrains de la ligne 2 n’avaient qu’un seul accès lors de leur construction.
Cependant, certaines stations du premier chantier ont vu leur accès dédoublé en un accès d’entrée et un autre de sortie, pour plusieurs raisons. La plus évidente était la conformation particulière des lignes aux terminus. Les motrices des rames, après avoir débarqué leurs passagers sur un quai d’une première salle souterraine, poursuivaient leur route le long d’une boucle de retournement et allaient ensuite s’arrêter devant le quai d’une autre salle souterraine de la même station, afin d’y embarquer de nouveaux passagers pour le voyage de retour[6]. Cette configuration, avec deux édicules B, l’un pour l’entrée, l’autre pour la sortie, se rencontrait à la station Porte Dauphine[7], à la station Porte Maillot[8] et la station Porte de Vincennes[9].
D’autres stations du premier chantier ont également eu deux accès car une affluence importante y était attendue. C’était le cas à la station Nation en raison d’une correspondance à venir avec la future ligne circulaire B (scindée en lignes 2 et 6). Un édicule B servait ordinairement[10] à l’entrée et à la sortie et un second édicule B[11] était mis en service les jours d’affluence. Il servait uniquement à la sortie, le premier édicule ne servant plus alors qu’à l’entrée.
 Édicule B d’entrée sur la place de la Nation, entre l’avenue Dorian et la rue Jaucourt. Photo parue dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque en septembre 1901. Coll. auteur.
Édicule B d’entrée sur la place de la Nation, entre l’avenue Dorian et la rue Jaucourt. Photo parue dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque en septembre 1901. Coll. auteur.

« National », « Style Nouveau », « Architecte d’Art », « Style Guimard » et « Style Moderne », les qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre et leur postérité
En tout architecte n’y a-t-il pas un petit démiurge qui sommeille ? Rares sont les professions dans lesquelles, sous l’impulsion et les plans d’une seule personnalité s’élève ex nihilo une œuvre concrète qui généralement lui survivra. Si la plupart d’entre eux en sont conscients, peu nombreux sont ceux qui déclarent avoir pour ambition, non de révolutionner leur profession, mais de créer un style si personnel qu’il est digne de porter leur nom. Hector Guimard a osé le faire.
Tous les historiens d’art qui ont étudié l’œuvre de Guimard n’ont pas manqué de relever l’usage immodéré des divers qualificatifs qu’il a utilisés pour son œuvre. Secrètement navrés ou implicitement admiratifs devant son audace à employer le terme de « Style Guimard », ils ont constaté que cette démonstration d’orgueil n’avait pas manqué de lui attirer des moqueries, et supputé — sans doute à raison — qu’elle avait engendré des inimitiés, lesquelles avaient à coup sûr contribué à l’isoler du monde artistique contemporain. S’il est parfaitement exact que les grands médias français traitant d’art décoratif, après s’être brièvement intéressé à lui à l’époque du Castel Béranger, l’ont ensuite boudé, nous savons à présent que Guimard a de tout temps déployé une intense sociabilité qui a partiellement compensé cette absence de reconnaissance. Nous tenterons dans cet article de mieux cerner ces différents qualificatifs et les époques auxquelles Guimard a pu les employer. Nous verrons qu’ils ne se succèdent pas de façon linéaire dans le temps comme on avait pu le croire mais qu’ils sont plutôt usités en fonction de ses besoins ou de ses envies.
- « National »
Acteur des débuts en France de ce que nous appelons actuellement le style Art nouveau, Guimard a sans doute très vite perçu l’intérêt qu’il avait à trouver par lui-même une dénomination à sa création avant que l’opinion ou plutôt les médias ne le fassent à sa place. Il était également opportun que cette dénomination le distingue des autres rénovateurs de l’architecture et de l’art décoratif. Le nom de « style Art nouveau » avait déjà précédemment été employé en Belgique. De plus, en 1895, date clé qui marque les débuts de la création du Castel Béranger, ce nom était également devenu une raison commerciale parisienne avec l’ouverture de la galerie L’Art Nouveau Bing par le marchand d’origine allemande Siegfried Bing[1] qui présentait et vendait un vaste choix de la production française, européenne et américaine dans ce style. On comprend qu’il était dès lors difficile pour Guimard d’accepter ce patronage pour son œuvre personnel. La conscience aigüe qu’il avait de la valeur et de l’originalité de ses créations l’ont certainement poussé à trouver un qualificatif qui ne les assimilait pas à ce qui a été très vite perçu par la presse comme un art d’importation étrangère — tour à tour vu comme belge ou anglais — et qui a fait l’objet d’un rejet xénophobe (et antisémite) dès l’ouverture de la galerie L’Art Nouveau Bing[2]. Ce dernier épisode est à replacer dans un contexte d’agitation nationaliste qui n’a fait que croître pendant une décennie avant l’acmé de l’affaire Dreyfus en 1898 et qui a ensuite vu la nette victoire de la droite nationaliste aux élections municipales de Paris en 1900. De façon logique, ce rejet xénophobe a entraîné dans les médias une exhortation à créer un style moderne qui soit véritablement français, un leitmotiv qui a semblé pour beaucoup de critiques trouver son accomplissement dans les constructions élégantes et calmes de l’architecte Charles Plumet. Son œuvre, unanimement salué, a été vu comme un ultime avatar de la Renaissance Française. Mais Guimard, dont la conversion au style moderne était intimement liée à sa découverte en 1895 des travaux des architectes belges Hankar et Horta, s’est trouvé dans une position plus ambigüe. Plusieurs indices nous prouvent qu’il a tenté d’échapper à l’anathème du cosmopolitisme qui pouvait lui être jeté à tout instant.
Dès le premier de ses trois articles consacrés au Castel Béranger[3]en 1896, l’architecte Louis-Charles Boileau avait allumé un contre-feu à cette accusation d’inspiration venue de l’étranger en signalant à son lectorat que les papiers peints de Guimard n’étaient « pas anglais »[4]. Cette précision, sans doute apportée à l’instigation de Guimard, est à deux niveaux de lecture. Elle peut tout d’abord, par antithèse, aider le lecteur à mieux situer le style de Guimard en l’opposant au style anglais en matière de papiers peints, style alors bien connu et bien reconnaissable. Mais elle veut aussi se placer sur un plan politique et nationaliste.
Peu après l’article de Boileau, en janvier 1897, Charles Genuys, ancien professeur de Guimard à l’École nationale des arts décoratifs, a publié dans La Revue des Arts Décoratifs un article vigoureusement intitulé « Soyons Français ! » dans lequel il mettait en garde contre la tentation que pourraient avoir les artistes décorateurs modernes de se mettre à la remorque des artistes étrangers et en particulier des belges. Genuys visait ici ce qu’on appelle « la ligne Belge », c’est-à-dire la tendance emmenée par Henry Van de Velde qui, contrairement à Horta, réfutait toute idée d’inspiration de la nature pour construire un décor et une structure purement linéaire et abstraite. Ce texte de Genuys qui venait en réalité soutenir les efforts de Guimard, a toutefois pu aussi résonner comme un avertissement à l’endroit de celui qui, s’il disait vouloir toujours se référer à l’inépuisable spectacle de la nature, n’en privilégiait pas moins les arrangements de lignes abstraites.

Henry Van de Velde, affiche publicitaire pour la marque Tropon, 1898. Photo MoMA. Cette lithographie est insérée dans la revue L’Art Décoratif en 1898.
On comprend mieux ainsi le libellé de l’enseigne du stand conçu par Guimard pour l’entreprise Gilardoni & Brault à l’Exposition de la Céramique au Palais des Beaux-Arts en 1897[5]. On peut y lire que le porche d’une grande habitation parisienne qui y est exposé est en « Style Moderne National ». Quoique éphémère, l’utilisation de ce terme n’a alors pas échappé au décorateur Eugène Belville[6]. Dans la revue Notes d’art et d’archéologie de 1897, il ironisait sur son emploi par Guimard qui, écrivait-il, « épigraphie ses constructions madréporiques du titre de Style National Moderne ». Il le mettait alors en garde contre la prétention qu’ont certains de « faire un style » qui pourrait « soulever la méfiance du public » au contraire de ceux qui « se contenteraient de chercher du style ».
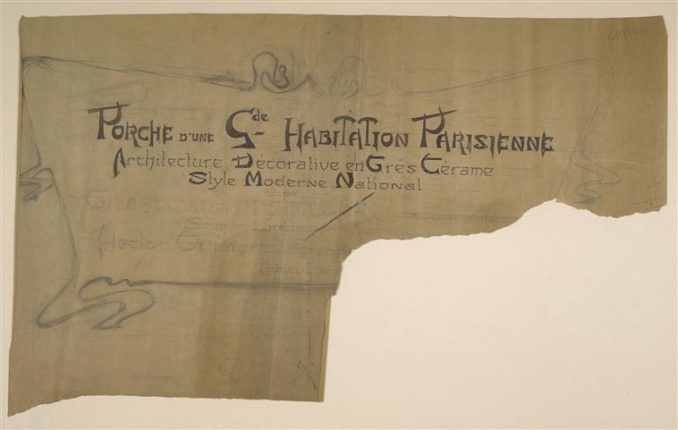
Projet pour une enseigne pour le stand Gilardoni & Brault à l’Exposition de la Céramique en 1897. « Porche d’une Gde Habitation Parisienne/Architecture Décorative en Grès Cérame/ Style Moderne National/par/ Gilardoni Fils A. Brault et Cie à Choisy le Roi/sous la direction artistique de/Hector Guimard Raph…/Castel Bér… ». Encre et mine de plomb sur papier calque, musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 1840.
On va voir que le débat sur la question de savoir si le style de Guimard était bien un style français a ressurgi en 1898 et 1899, à chaque évènement organisé par l’architecte autour du Castel Béranger. Ainsi, en rendant compte avec enthousiasme de la publication du portfolio du Castel Béranger dans Le Moniteur des Arts du 28 janvier 1899, son directeur Maurice Méry, ne voulait pas admettre qu’il ait pu s’inspirer de l’exemple belge :
« Tout cela, pour une fois, j’ai la joie de le constater, est l’œuvre d’un Français, d’un des nôtres et qui n’a pas été chercher son inspiration à l’étranger […] »
Alors qu’un auteur à l’esprit plus large et plus perspicace, l’écrivain Octave Uzanne, admetait qu’une influence étrangère, belge en l’occurrence, puisse revivifier l’architecture moderne française. Ainsi, dans un texte daté du 29 novembre 1898, mais publié en 1899 dans son ouvrage Visions de Notre Heure. Choses et gens qui passent, il pensait avoir trouvé en la personne de Guimard l’architecte providentiel qui semblait faire cruellement défaut à Paris. Au hasard de ses balades dans la capitale, dénonçant « l’inquiétante torpeur imaginative de ses architectes », « la niaise ordonnance de ses bâtisses » ou encore son « architectonique imbécile », il s’émerveilleait au contraire devant l’originalité du Castel Béranger et son « architecture quelque peu révolutionnaire », fruit selon lui d’« une pensée murie […] tendant à la rénovation de l’art architectural ». Heureux, presque étonné d’avoir « déniché cette œuvre bâtie et réalisée à Paris », il s’appuyait sur l’exemple de la Belgique et sa révolution architecturale en cours pour émettre le vœu que Guimard s’impose de la même manière en France en tant que chef de file des architectes modernes :
« Puisse M. Hector Guimard devenir bientôt notre Horta de France ! ».
Mais d’autres auteurs, plus étroitement cocardiers, ont rejetté cette idée. C’est le cas d’Édouard Molinier dans son article paru dans Art et Décoration en mars 1899 et qui écrivait à propos du Castel Béranger :
« Sans nier le mérite de Horta, il y avait peut-être mieux à faire, pour un artiste français, que d’aller chercher ses inspirations en Belgique. Nous eussions préféré assister à une tentative, fût-elle incomplète de résurrection du vieux style français ».
Peu après, le 15 avril 1899, dans son article consacré aux résultats du premier concours de façades de la ville de Paris pour lequel le Castel Béranger a été primé, un journaliste de L’Illustration était du même avis que Molinier :
« Il serait aisé de chicaner M. Guimard sur bien des détails ; on pourrait lui demander malicieusement s’il n’a pas trouvé en Belgique l’inspiration créatrice. »
Même si la seule occurrence d’utilisation de l’adjectif « national » par Guimard que nous connaissons est celle de l’enseigne du stand Gilardoni en 1897, nous soupçonnons qu’il a continué à l’utiliser au moins oralement jusqu’au début de l’année 1899. Nous en voulons pour preuve le texte d’un article paru dans Le Monde Illustré du 8 avril 1899, lui aussi consacré au concours de façades la ville de Paris, mais bien opposé au persiflage de l’article de L’Illustration qui paraîtra une semaine plus tard. Ce premier article est signé « G. B. ». Pourrait-il s’agir de Georges Bans, l’un des publicistes proches de Guimard, également rédacteur de la revue La Critique ? En tous cas, son auteur, subjugué par l’architecture du Castel Béranger, au vu des formules et de l’argumentaire employés, a sans doute rencontré Guimard sur place. Il terminait son article par une vibrante affirmation du caractère national de son œuvre :
« […] car le “Castel Béranger” est une œuvre bien française, et en dépit de son apparence spontanée et révolutionnaire, elle se rattache directement aux traditions de notre art et de notre vie nationale moderne. »
Cette phrase est étonnamment proche de la conclusion d’un des deux textes figurant dans l’opuscule titré Études sur le Castel Béranger, signé « PN », initiales sous lesquelles on s’accorde à reconnaître Paul Nozal, ami proche de Guimard et fils de son futur client et associé, Léon Nozal. Cette étude est parue au moment de l’exposition du Castel Béranger dans les salons du Figaro, du 5 avril au 5 mai, prolongée jusqu’au 20 mai, sans qu’on en connaisse la date précise de publication[7], si bien que nous ne savons pas si G. B. a réduit la phrase de PN ou si au contraire c’est PN qui a amplifié celle de G. B. :
« Pourtant il est une chose que je tiens à répéter en terminant : c’est que le Castel Béranger est une œuvre bien française, c’est qu’en dépit de son apparence spontanée elle se rattache directement et profondément aux traditions de notre art et de notre vie nationale, et que sous une expression nouvelle elle est bien un produit des générations lentement écloses et muries sous le même climat, un produit de notre sol et de notre race. »
- « Style Nouveau »
Pour sa part, Guimard semble avoir dès lors abandonné sans retour cette rhétorique que l’on qualifierait aujourd’hui d’identitaire mais qui restera très répandue dans la presse encore pendant quelques décennies. En effet, sur les invitations à l’exposition consacrée au Castel Béranger dans les locaux du Figaro qui débute en avril 1899, il mentionnait qu’il s’agit de « compositions dans un style nouveau ».

Carte d’invitation à l’exposition du Castel Béranger dans les salons du Figaro (détail) en 1899. Coll. part.
Cette nouvelle expression, sans doute trop proche d’« Art nouveau », n’a ensuite plus été utilisée, à une exception. En 1911, la maison de quincaillerie Paquet à Grenoble s’est en effet engagée, à la demande de l’architecte, à utiliser la formule « Modèle Style Nouveau H.G. » [8] pour désigner le bouton de porte en porcelaine qu’elle fabriquait pour Guimard. Mais en réalité, la formulation retenue sur le catalogue publié a conservé les initiales de l’architecte tout en supprimant le « Style Nouveau ».
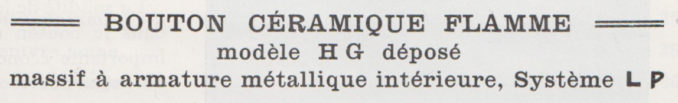
Catalogue Paquet (détail), sans date. Coll. part. Le nom « Flamme » qui est donné au bouton en porcelaine de Guimard ne semble pas avoir été employé précédemment.
- « Architecte d’Art »
Sur les plans de la villa Canivet[9] datés des 13 et 20 avril 1899 apparaît, marquée au tampon, la mention « Architecte d’Art ». S’il est possible que le coup de tampon ait été ajouté ultérieurement sur ce plan, dès l’année suivante, au moment de l’Exposition Universelle, Guimard a utilisé ce terme. Il lui est resté fidèle pendant au moins une décennie puisqu’il figurait encore en 1909 sur son faire part-de mariage.
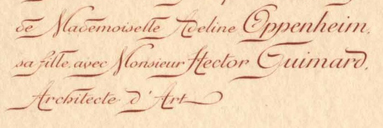
Faire-part du mariage d’Hector Guimard et d’Adeline Oppenheim en 1909 (détail). Coll. part.
Guimard a voulu très simplement signifier par là qu’il désirait donner à toute sa production un caractère artistique qui la distinguerait de la production architecturale et décorative banale. Quelques années plus tard, en 1908, le titre « Fontes artistiques » de ses catalogues édités par la fonderie de Saint-Dizier participait de la même inflation qualitative en voulant signaler une production possédant un véritable caractère artistique, à la différence de la quasi-totalité des autres fontes d’ornement du commerce. Mais vouloir se distinguer des autres en signalant sa qualité éminemment artistique ne revenait-il pas aussi à rabaisser la leur ? On connaît le caractère artisanal et manuel de l’exercice usuel d’un ferronnier ou d’un menuisier. Et l’on admet alors volontiers qu’il se signale en tant que « ferronnier d’art » et « menuisier d’art » quand sa production le mérite. Mais on admet beaucoup moins bien qu’un architecte dont on suppose qu’il a suivi l’enseignement de l’École Nationale des Beaux-Arts, se pare du titre « d’Architecte d’Art » (surtout en y ajoutant des majuscules).

En-tête d’une lettre de Guimard au directeur des travaux de la CMP, datée du 27 janvier 1903. Guimard s’est servi du même graphisme sur des cartes de correspondance, également utilisées en 1903. Coll. RATP.
Le premier article de presse faisant référence à ce qualificatif a sans doute été celui de Pascal Forthuny[10] décrivant le mobilier à l’Exposition Universelle, paru dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque de décembre 1900 :
« […] M. Guimard — par quel concept aveuglé ? — prétend être un architecte d’art (!) et avoir créé un style ! […] Et puis, qu’est-ce que cela signifie ? Et enfin un individu crée-t-il un style ? Et M. Guimard a-t-il le droit de renier ses origines ? »[11]
- « Style Guimard »
Ces derniers mots de l’article de Forthuny « et avoir créé un style » laissent d’ailleurs entendre que Guimard a également commencé à utiliser dès cette époque la mention « Style Guimard ». Ce qui est confirmé par la commande par Eugène Déjardin pour son stand de « l’Extrait de malt français Déjardin » à l’Exposition Universelle d’une série de « meubles vitrine en Vikado[12] style Guimard[13] ».
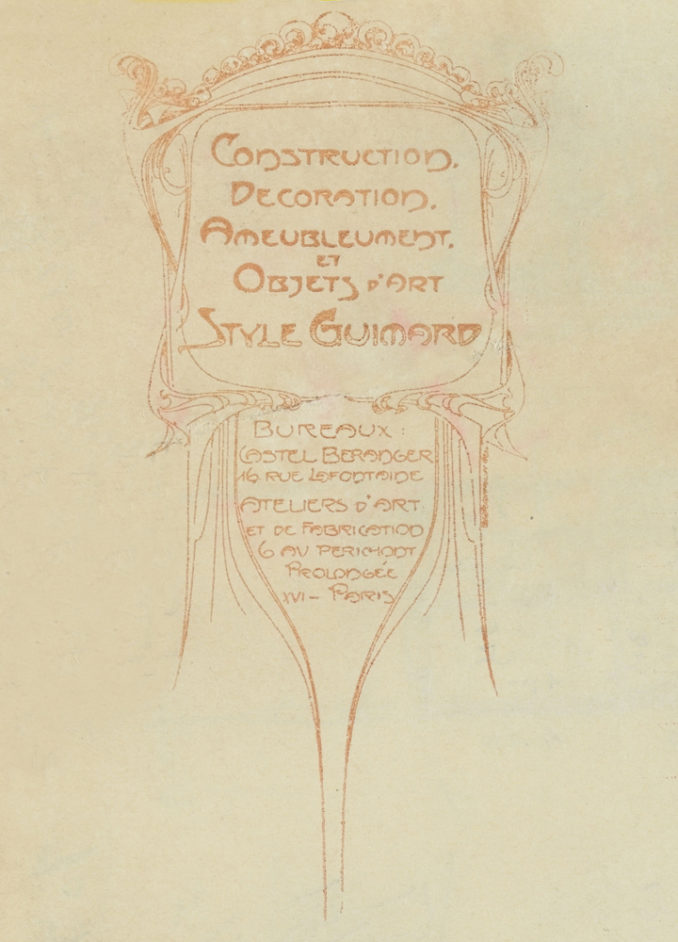
En-tête d’une facture des Ateliers Guimard datée du 14 novembre 1905. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 128.
En 1901, à peine quelques mois après la parution du texte de Forthuny, la revue La Vie Moderne a publié un article anonyme mais passionnant, intitulé « Le Style Guimard ». Il s’agit probablement d’un des textes d’époque les plus aboutis sur le sujet. S’appuyant sur ses travaux les plus récents comme le Castel Béranger ou les accès du métropolitain — dont il fait une critique favorable — puis sur le parcours et la personnalité de l’architecte, l’auteur ne se montre à aucun moment choqué par l’emploi de cette expression. Il en propose au contraire une explication détaillée en justifiant son utilisation par la logique qui anime ses constructions, l’harmonie d’un style naturaliste habilement puisé dans les répertoires historiques tout en étant débarrassé de ses ornements superflus et la beauté d’une ligne dont il souligne la finesse et la simplicité :
« …les courbes, les inflexions de ces lignes obéissent à une idée générale ; à une théorie préconçue dont la réalisation confère à l’objet une marque distinctive, une originalité propre, un style personnel qui est, pourquoi ne pas le dire ? le Style Guimard.»[14]
À partir de l’Exposition universelle, un débat s’est donc engagé par articles interposés sur la légitimité de l’architecte à donner son nom à un style. Guimard n’a jamais autant dérangé, suscité de sentiments contraires, de positions irréconciliables qu’à cette époque considérée comme une des périodes clés de sa carrière. La controverse a atteint son paroxysme trois ans plus tard à l’occasion de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903, où la mention « Pavillon Style Guimard » était clairement affichée sur l’enseigne en lave émaillée du porche du pavillon de Guimard.
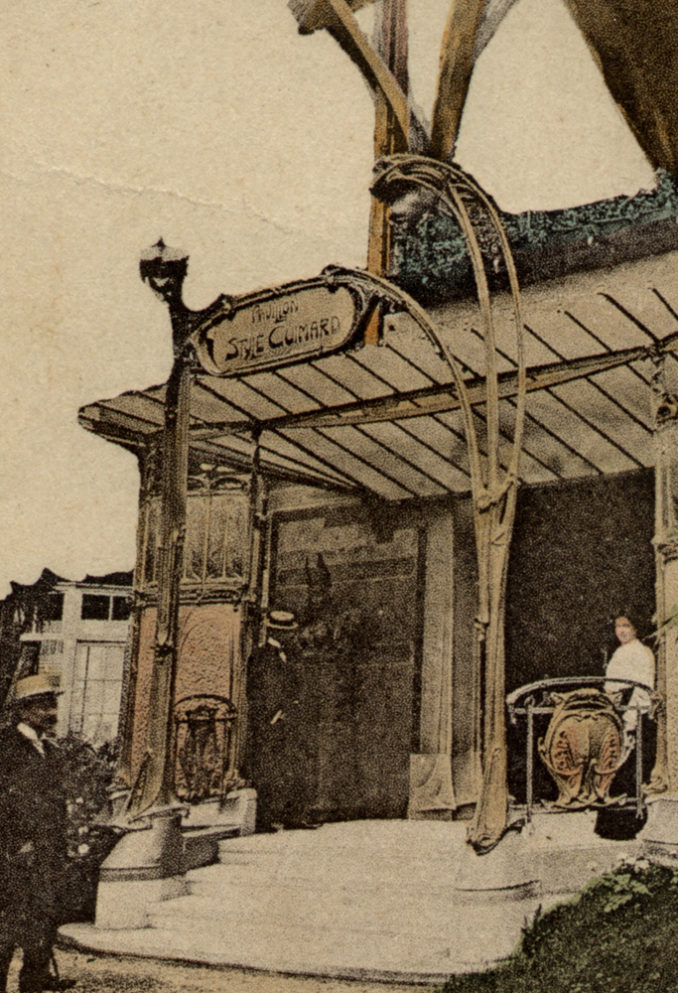
Le porche du pavillon de Guimard à l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Carte postale n° 1 de la série Le Style Guimard (détail). Coll. part.
Elle accompagnait celle d’« Architecte d’art » sur la série de cartes postales vendue à cette occasion. Elle faisait également l’objet d’un texte explicatif intitulé « Le Style Guimard » qui figurait sur le dépliant servant d’emballage aux cartes ainsi qu’au verso du dépliant accompagnant la conférence qu’il a prononcé le 27 octobre au Grand Palais. Guimard y exposait ses principes architecturaux en s’appuyant sur la trilogie « Logique, Harmonie et Sentiment » qu’il avait développée depuis sa conférence de 1899 dans les salons du Figaro[15].

Invitation à l’inauguration du Pavillon Le Style Guimard à l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais, 1903. Coll. part.
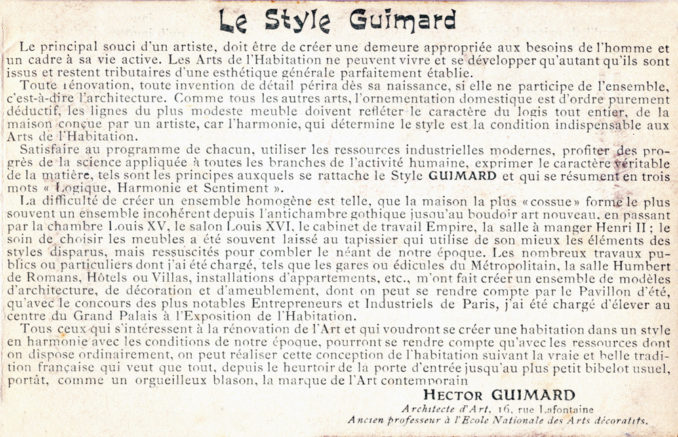
Texte de Guimard imprimé sur le dépliant tiré à l’occasion de la conférence qu’il prononce le 27 octobre 1903 au Grand Palais. Coll. part. Il est accompagné par le même texte de Stanislas Ferrand (préalablement publié dans la revue Le Bâtiment du 9 août 1903) qui figure aussi sur l’emballage des paquets de cartes Le Style Guimard.
Vue par beaucoup comme un insupportable manque de modestie, cette mention « Style Guimard », a bien entendu été tout aussi mal reçue que le qualificatif d’« Architecte d’Art ». Outre la singularité de ce terme, singulier puisqu’aucun autre artiste, décorateur ou architecte contemporain ne s’est risqué à l’imiter, son emploi sous-entend aussi une rupture d’avec le passé et le processus d’enchaînement des styles les uns aux autres. C’est ce que voulait dénoncer Forthuny en 1900 en écrivant : « M. Guimard a-t-il le droit de renier ses origines ? » C’est à dire, Guimard ne veut-il pas nier ce qu’il doit à l’art médiéval, à l’art Baroque, à l’art oriental et plus récemment à Horta, Hankar ou Van de Velde ? Une partie des critiques n’a donc pas admis qu’un artiste contemporain puisse vouloir donner son nom à un style quand les grands décorateurs du passé n’avaient pas cette prétention. Cette opinion a prévalu dans les grandes revues d’art décoratif, comme Art et Décoration dans laquelle est paru en octobre 1903 un article anonyme commentant l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais :
« M. Guimard dans son pavillon, nous offre un mélange peu équilibré de bonnes et de mauvaises choses. L’artiste a encore besoin de s’assagir un peu. Mais quelle étrange prétention le pousse à orner son œuvre d’écriteaux informant les visiteurs qu’ils sont admis à admirer le Style Guimard ! Je ne crois pas que nos grands décorateurs, Du Cerceau, Meissonnier, aient jamais ainsi baptisé leur manière, et pourtant… »
Au contraire, le journal La Fronde est venu à son secours. Ce premier quotidien féministe, engagé dans de nombreux combats progressistes, au premier plan desquels figurait la revendication de la place des femmes dans la société, n’était pas spécialisé dans l’art décoratif. Mais son article du 16 août 1903, intitulé « Le Style Guimard » et signé La Dame D. Voilée[16]…, juge excessives les critiques dont fait l’objet Guimard :
« [les méprisants du Style Guimard] ont-ils remarqué dans la nuit, tout là-bas à la Porte Dauphine, deux grandes lucioles qui brillent à travers arbres et arbustes, avec un charme mystérieux, ce sont là pourtant deux kiosques du Métropolitain. Quelle enseigne, quelle rampe de gaz ou réclame électrique serait à la fois plus significative et plus élégante que ces deux cages phosphorescentes qui indiquent si gentiment l’emplacement des stations du Métro ».
À la fin de cette même année 1903, de la même façon que dans Art et Décoration, Guimard a sévèrement été attaqué par le critique d’art et spécialiste de l’histoire du mobilier français Roger De Félice dans son compte-rendu du Salon d’Automne paru dans la revue L’Art Décoratif. Son commentaire de l’envoi de Guimard (consistant en des dessins aquarellés) s’attache tout d’abord à ironiser sur les qualificatifs « Architecte d’Art » et « Style Guimard » avant de prétendre que ces mentions orgueilleuses ne sont finalement là que pour valoriser une œuvre inutilement compliquée :
« M. Hector Guimard nous présente, lui aussi, des projets d’ensembles décoratifs, mais à l’état de simples croquis aquarellés. M. Guimard plonge le public dans une grande perplexité. Sa carte est là, qui porte ces mots gravés en caractères singuliers : Hector Guimard, Architecte d’Art. Et le public se demande : Qu’est-ce que cela peut bien être, qu’un architecte d’Art ? Et surtout un architecte qui n’est pas un architecte d’Art ? On n’a jamais vu M. Plumet, par exemple, qui est bien un artiste authentique, et un grand artiste, se déclarer architecte d’Art. Le public approche et cherche. Il apprend d’abord, de M. Guimard lui-même, car il la proclame sur maintes étiquettes, l’existence d’un Style Guimard. […]. L’architecture d’Art consiste évidement dans l’horreur de la simplicité et de la ligne droite qui, incurvant, bossuant tout, va jusqu’à donner à de simples oreillers, une forme savamment contournée… Et aussi dans des raffinements comme ces plans inclinés remplaçant la marche vulgaire par où on accède ailleurs à une alcôve surélevée… Enfin dans l’air inutile, sinon inutilisable, que prend ici toute chose, ce qui est sans aucun doute le suprême degré du luxe… »[17]
Ne pouvant laisser passer un article aussi hostile, Guimard a fait publier une réponse dans le supplément de la revue en février 1904. Tout en reprochant à De Félice de ne pas faire son travail de critique d’art, il justifiait le terme « Architecte d’art » par son étymologie grecque (archos, chef et tecton, ouvrier), se réservant le droit d’y accoler la mention « d’Art » qu’il estimait justifiée au regard des constructions banales et dépourvues de caractère artistique qui sont produites par des professionnel s’intitulant « Architectes ». Toujours dans sa réponse à De Félice, pour définir le « Style Guimard », il réitèrait les formules qu’il avait déjà placées dans son petit manifeste imprimé sur l’emballage de ses cartes postales et au verso de l’invitation à sa conférence au Grand Palais : « satisfaire au programme de chacun, utiliser les ressources modernes, profiter des progrès de la science appliquée à toutes les branches de l’activité humaine, exprimer le caractère de la matière » et qu’il résume à nouveau par sa trilogie « logique, harmonie et sentiment ». Dans ce programme qui rend compte du versant rationaliste de sa création, manque pourtant le fait d’assumer cette inventivité décorative débridée qui rebute la majorité des critiques et du public à l’époque et qui nous séduit aussi fort à présent. En fait, il ne voudra jamais s’expliquer sur ce côté onirique et fantastique du « Style Guimard », considérant sans doute qu’il est à prendre ou à laisser.
Curieusement, une relation aussi mal partie entre les deux hommes a trouvé une issue plutôt heureuse dans l’article que De Félice a consacré à nouveau au Salon d’Automne de 1904. Avec une ironie beaucoup plus ténue, il commentait alors favorablement l’envoi de Guimard consistant en trois ensembles d’ameublement :
« […] car M. Guimard lui-même, l’architecte d’art, semble cette fois sacrifier timidement à la simplicité et à la raison. […] »[18]
Quelques années plus tard, en 1907, Guimard a présenté à l’exposition de la Société des Artistes Décorateurs un stand très fourni et comprenant un grand nombre de ses fontes d’ornement coulées à Saint-Dizier. Dans son compte-rendu paru dans la revue Art et Décoration, Paul Cornu a alors formulé les mêmes reproches qu’en 1903 sur l’expression « Style Guimard » qui accompagnait certainement le stand :
« M. Guimard pense avoir créé un style. Il lui donne même son nom. En réalité, il n’a créé qu’une formule, mais lui soumet toutes les matières. Fer, fonte, bronze, bois, staff, grès, vitraux, étoffes, traduisent tour à tour son inextinguible soif de décor. »[19]
Heureusement, au sein de revues plus confidentielles ou de type professionnel, certains auteurs ont été beaucoup plus indulgents quant à la légitimité de l’expression « Style Guimard ». C’est le cas de Royaumont[20] dans son compte-rendu du même salon de la Société des Artistes Décorateurs en 1907, paru dans la Revue Illustrée. Tout en notant que Guimard avait infléchi son style en revisitant ceux des siècles passés, il admettait que cette création bien reconnaissable, s’étendant à tous les domaines ne pouvait être qualifiée autrement :
« […] mais la partie la plus complète est le fragment de salle à manger dont l’ensemble prouve que l’art moderne a su profiter des œuvres du passé et qu’il peut, entre des mains savantes, en continuer la tradition. Et tout cela cependant avec une telle personnalité de toucher, qu’on n’a pu trouver pour définir ces formes d’autre dénomination que celle de style Guimard ! »[21]
Commentant encore la même exposition, le Journal de la Marbrerie et de l’Art décoratif, a donné sur trois livraisons l’un des rares articles[22] réellement enthousiastes sur l’œuvre de Guimard en général et sur son exposition en particulier ; si enthousiaste que l’on peut d’ailleurs se demander si l’architecte n’aurait pas tenu le porte-plume du journaliste anonyme. Il justifie au passage la légitimité de l’expression « Style Guimard » :
« Les qualités de cette œuvre, où la logique la plus exacte s’unit à la distinction la plus sensible, montre jusqu’à quel point est justifiée l’appellation Style Guimard donnée aux œuvres de cet artiste. »
Inflexible, Guimard a persisté à employer la mention « Style Guimard » au cours des années suivantes. Elle est apparue, comme il en a été question plus haut sur des panonceaux disposés sur les stands des expositions et salons auxquels il participait, mais aussi de façon plus concrète sur certaines œuvres elles-mêmes, comme les tirages commerciaux de certaines de ses fontes ornementales. Ainsi, vers 1912, de nouveaux modèles de pieds de bancs en fonte (GO et GN) ont été conçus avec la mention « Style Guimard » inscrite en creux de façon très visible. Quant à la poignée de cercueil Gb, elle aussi marquée « Style Guimard », elle pourrait avoir été conçue après la Première Guerre mondiale, tout comme ses projets de tombes à éditer en série dont l’un portait bien la mention « Tombeau d’Art/Style Guimard ».

Pied de banc GN avec l’inscription « Style Guimard » en creux. Réserves de la fonderie de Saint-Dizier (actuellement versé dans les collections du musée de Saint-Dizier). Photo auteur.
L’édition en série d’objets du décor architectural a mobilisé énormément d’énergie créatrice de la part de Guimard. Réalisées en collaboration avec des industriels ou des ateliers, ces éditions ont été l’occasion de publier des catalogues spécifiques sur lesquels était, le plus possible, mentionnée l’existence du « Style Guimard ». Nous examinerons plus loin le cas particulier des catalogues de fontes ornementales, mais chaque planche du catalogue de ses Lustres Lumière, édité avant 1914, a reçu la mention « Style Guimard ». Il en est de même pour les dessins gouachés de lustres que nous connaissons.

Projet de plafonnier électrique Style Guimard. Gouache sur papier fort. Coll. part. Ancienne coll. Yves Plantin. Photo Art Auction, 2015.
Le projet de convention établi en novembre 1908 par le fabricant de moquette Aubert prévoyait aussi le dépôt des dessins fournis au Tribunal de Commerce sous la rubrique « Style Guimard ». Nous n’avons pas d’information sur les autres projets de catalogue dont Guimard semble avoir caressé l’idée (miroirs, vases, couverts et sans doute tombes) mais pour les meubles, le contrat qu’il a passé en 1913 avec les fabricants du Faubourg Saint-Antoine Olivier et Desbordes stipulait bien que les modèles seraient déposés sous le nom de « Style Guimard » et qu’un catalogue spécial portant la mention « Style Guimard » serait tiré à 3000 exemplaires aux frais de la maison Olivier-Desbordes.
La dernière occurrence que nous connaissons de la participation de l’architecte à un catalogue commercial est le « Lambris Guimard » qui figurait dans le catalogue Elo de 1926. Cette entreprise s’était spécialisée dans l’édition de décors muraux en fibrociment, un matériau auquel Guimard s’est intéressé tardivement, notamment pour la mairie du Village Français à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925.
Il semble que cette persévérance de Guimard ait finit par avoir quelques résultats et à faire passer un peu, au moins à Paris, l’expression « Style Guimard » dans le langage de l’époque. Mais pour qu’il y ait vulgarisation d’une expression qui concerne le domaine artistique, il était nécessaire qu’elle soit reprise et propagée par la presse non spécialisée. Un tel exemple nous est offert par l’article d’un auteur anonyme s’exprimant sur les grands travaux à Paris dans La Politique Coloniale du 7 septembre 1903 et qui donne son avis sur l’un des débats récurrents de l’époque : le maintien ou non de la Tour Eiffel. Il se prononce contre sa destruction mais, poursuit-il, s’il devait se produire quelque chose à son sujet, il souhaiterait « qu’elle soit reconstruite ailleurs, en style Guimard, le seul architecte qui ait su jusqu’à ce moment tirer un réel parti de l’ornementation avec le fer » …
Dans cette quête de reconnaissance, Guimard a sans aucun doute été aidé par un cercle amical et littéraire où l’on peut compter des fidèles de la première heure comme Georges Bans, Fernand Hauser, Émile Straus ou Stanislas Ferrand. Autre fervent défenseur de l’architecte, le poète et critique d’art Alcanter de Brahm[23] a été un grand admirateur des idées de Guimard. Il a fréquemment utilisé l’expression « Style Guimard » lorsqu’il écrivait sur l’architecture et les arts décoratifs, notamment dans la revue La Critique dont il a été l’un des principaux rédacteurs, mais aussi dans des quotidiens à plus fort tirage comme le XIXe siècle ou Le Rappel, contribuant à sa manière à en populariser l’expression. Toujours en rapport avec ce cercle amical, La Critique a livré ainsi une anecdote qui prend place lors de la soirée offerte par Guimard début 1909 à l’occasion de ses fiançailles. Le journaliste et poète Fernand Hauser y prennait la parole en évoquant la « popularité grandissante » des « formes d’art innovées » défendues par Guimard et relatait une anecdote personnelle en ces mots :
« C’est la gloire prochaine qui s’annonce. J’en fus témoin l’autre jour dans un de nos grands magasins tandis qu’une cliente, à l’occasion des étrennes, marchandait un objet d’art, et que le commis en lui vendant cet article ajoutait : C’est ce que nous faisons de mieux maintenant, c’est du style Guimard. »[24]
Dans ce cas précis, l’article en question n’était sans doute pas un objet créé par Guimard et il s’agirait donc déjà d’un glissement de sens qui globalisait la production d’art décoratif de style Art nouveau sous le nom de Guimard.
Un autre poète, lui largement passé à la postérité, a montré moins de discernement concernant Guimard que les précédents, restés plus obscurs. Guillaume Apollinaire, puisqu’il s’agit de lui, a eu une carrière assez fournie de critique d’art dans la presse. Côtoyant quotidiennement les artistes — peintres surtout — les plus modernes, il a été beaucoup moins sensible à l’art décoratif et à l’architecture. Il a pourtant habité à Auteuil, rue Gros, et donc à proximité immédiate de plusieurs immeubles de Guimard. Dans L’Intransigeant il a utilisé l’expression « style Guimard » pour commenter les envois de l’architecte aux salons de la Société des Artistes Décorateurs. Mais avec une écriture froide et un ton presque blasé, il a laissé entendre que ses œuvres le laissaient de marbre, même si la citation de ses travaux semblait être un passage obligé. En 1911 tout d’abord, faisant fi de l’évolution stylistique de l’architecte, il évoquait sans la nuancer la parenté stylistique avec le métro :
« M. Guimard expose des photographies de maison dont il est l’architecte, des meubles, des bijoux et d’autres menus objets. Rien à en dire. C’est le style Guimard et vous connaissez le Métro. »[25]
Puis à nouveau en 1913, avec la même ambiguïté mais cette fois-ci au passé :
« M. Guimard a tellement marqué de ce que l’on a appelé le style Guimard qu’on ne saurait passer sous silence ses plans et ses photographies d’immeubles. »[26]
- « Style Moderne »
L’apparition de la mention « Style Moderne » est plus difficile à repérer. Étant moins sujette à polémique, elle n’a pas fait l’objet de lignes acrimonieuses envers Guimard dans la presse. Ce mot « moderne » se retrouve aussi dans pratiquement tous les écrits théoriques de Guimard et ce dès le début de sa conversion à l’Art nouveau, puisque le portfolio qu’il a consacré au Castel Béranger s’intitulait : L’Art dans l’Habitation Moderne et que nous l’avons vu employé en 1897 accolé à « national ».
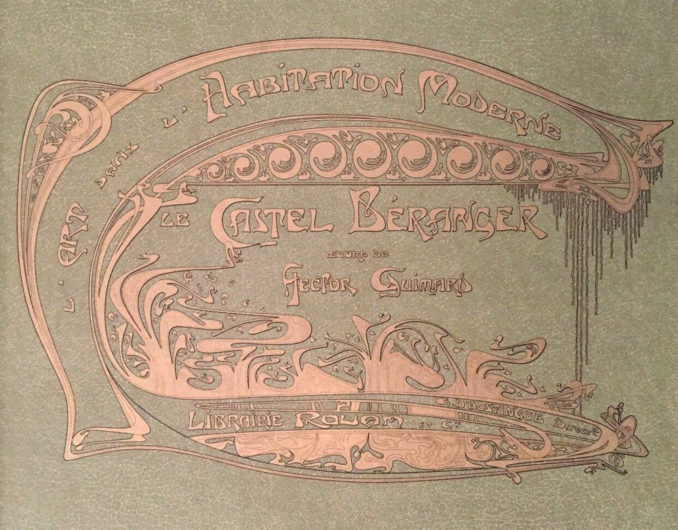
Couverture d’un fac-similé du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.
Au sein de l’Exposition universelle de 1900, Guimard a créé un stand remarqué pour le parfumeur Millot. Dans l’optique d’une présentation homogène, en plus du décor et du mobilier, il a également été chargé de la création de modèles de flacons et de boîtes destinés au lancement de plusieurs nouveaux parfums et de leurs dérivés. Ces modèles se sont retrouvés dans le catalogue commercial du parfumeur, sous forme de dessins colorisés avec les noms des parfums et celui de la raison sociale « F. Millot » calligraphiés par Guimard, sans que son nom apparaisse. L’en-tête de ces trois pages est « PARFUMERIES STYLE MODERNE », mention qui n’est pas reprise sur les autres pages du catalogue.

Catalogue commercial Millot, pl. 10 (détail), sans date, c. 1905. Coll.
Le mot « moderne » fait immédiatement penser à « Modern Style »[27], l’une des expressions employées pour désigner le style Art nouveau. Autant que la nôtre, l’époque 1900 a raffolé des anglicismes. Cependant, ils pouvaient aussi être employés avec un sens un peu péjoratif. C’est parfois le cas de « Modern Style » qui n’était pas un terme d’importation anglaise, mais qui a pu être utilisé dans l’intention de dénoncer à nouveau les origines étrangères réelles ou supposées de l’Art nouveau. Ce vocable est pourtant rapidement passé dans le langage courant et on le retrouve, sous la forme francisée « Moderne Style », dans un autre catalogue commercial édité en 1902, où figure des modèles de Guimard. Il s’agit de celui du fondeur Bigot-Renaux, spécialisé dans les chéneaux auquel Guimard a fréquemment eu recours à partir du Castel Béranger. Cette société meusienne a édité plusieurs de ses modèles destinés à l’équipement de ses bâtiments, ainsi que des pavillons et édicules du métro. Notons tout de même que, pour ce catalogue, Guimard n’a sans doute pas eu la maîtrise des mentions employées en en-tête de la planche.
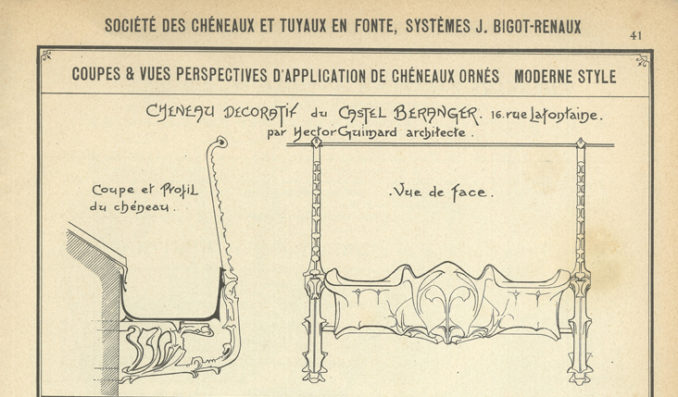
Catalogue commercial Bigot-Renaux, 1902 (détail). Coll. part.
C’est vers 1906-1910 que l’adjectif « moderne » est revenu de façon plus insistante. Guimard projetait alors de construire une série d’immeubles de rapport financée par la « Société Générale de Constructions Modernes » (constituée en juillet 1910) dont il était partie prenante, ainsi que son beau-père et son client Léon Nozal. Ce projet comprenait une rue nouvelle à lotir qu’il comptait faire baptiser « rue Moderne »[28]. Effectivement ouverte sous ce nom en 1911, elle est devenue la rue Agar l’année suivante[29], ce qui n’a pas empêché Guimard de conserver la dénomination de « Rue Moderne » dans les plans reproduits dans l’article du supplément de la revue La Construction Moderne du 9 février 1913.
Après la Première Guerre mondiale, l’adjectif « moderne » a été partagé par de plus en plus de créateurs qui préparaient l’exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925. C’est aussi dans cette optique que s’est fondé le « Groupe des Architectes Modernes »[30] dont Guimard est devenu le vice-président en 1923.
- « Style Guimard » ou « Style Moderne », l’exemple des catalogues de fontes édités à Saint-Dizier
Les catalogues de modèles de fontes créés par Guimard et édités à la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908 nous offrent un exemple éclairant des utilisations des mentions « Style Guimard » et « Style Moderne ». Avant nos recherches en 2015 sur ce sujet[31], il n’avait pas été remarqué qu’en réalité, deux types de catalogues avaient été édités.
L’un des deux types de catalogue porte sur sa couverture la mention en lettrages dessinés par Guimard « Fontes artistiques/pour/Constructions/Fumisterie/Articles de jardin/Sépultures » et dans un cartouche à la partie inférieure, la mention « Style Guimard ». Il n’y a donc pas sur la couverture de mention du nom de la fonderie qui édite ces fontes. À l’intérieur, sur chaque planche est apposée à la partie supérieure la mention « Style H. Guimard », placée en dessous du nom de la catégorie de modèles présentés. Ce n’est qu’à la partie inférieure des planches que l’on peut trouver la discrète mention « Modèle de la Société F. S. D » qui désigne, de façon peu claire pour le non-initié, la Fonderie de Saint-Dizier. En raison de la multiplicité de mentions du nom de Guimard, nous désignons ce type de catalogue sous le nom de « Style Guimard ».

Couverture d’un catalogue « Style Guimard ». Coll. part.
L’autre type de catalogue porte sur sa couverture la mention en lettrages dessinés par Guimard : « Fontes artistiques pour/Constructions/Fumisterie/Jardins et/Sépultures/Style moderne ». Les inscriptions y ont été dessinées d’une manière entièrement différente de celles de la couverture du premier type de catalogue. Les lettres sont plus petites et plus fines car il a fallu faire place à un sur-titre « Fonderies de Saint-Dizier / — Haute-Marne — » séparé du titre principal par le dessin d’une fonte jouant le rôle d’un filet. Dans le cartouche à la partie inférieure figure cette fois la mention « Leclerc et Cie » du nom commercial que porte alors la fonderie.
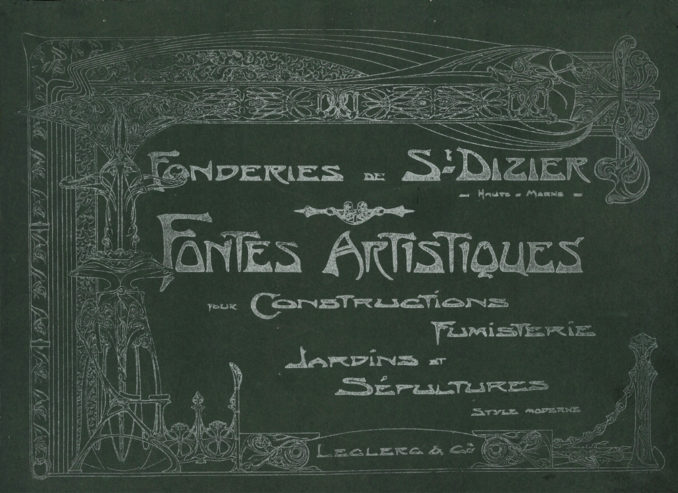
Couverture d’un catalogue « Style Moderne ». Coll. part.
Sur chaque planche est apposée à la partie supérieure la mention « Société des fonderies de St-Dizier (Haute-Marne) /Leclerc & Cie ».

En-tête des planches des catalogues « Style Moderne ». La police de caractères utilisée pour la ligne supérieure fait partie de la famille de polices créées par Georges Auriol. Coll. part.
Chaque planche reçoit également la mention « Style Moderne », placée en dessous du nom de la catégorie de modèles présentés, mais on y chercherait en vain le nom de l’architecte. Pour donner un pendant au catalogue « Style Guimard » nous désignons donc ce type de catalogue sous le nom de « Style Moderne ».
Mis à part les différences signalées, ces deux types de catalogues de fontes ont les mêmes contenus et auront les mêmes augmentations de pagination de 1908 à 1920 environ. Nous en concluons qu’il s’agit d’éditions parallèles et non successives. Le catalogue « Style Guimard » serait l’un des multiples catalogues « Style Guimard » envisagés et serait donc destiné à l’usage personnel de l’architecte. L’autre édition, le catalogue « Style Moderne », plus conforme aux impératifs commerciaux, serait destinée à l’usage de la fonderie.
Même s’il a plus souvent été utilisé dans la décennie qui précède la Première Guerre mondiale « Style Moderne » n’a donc pas supplanté « Style Guimard » comme on a pu le croire antérieurement. Il a simplement été utilisé lorsqu’une plus grande discrétion était recherchée. Il constituait sans doute aussi une tentative de rattraper un concept de modernité qui de plus en plus échappait à Guimard pour éclore ailleurs et avec d’autres.
- Postérité
Des deux expressions c’est pourtant bien « Style Guimard » qui a perduré après la Première Guerre mondiale. L’énumération des articles qui l’ont utilisée après cette césure serait ici trop fastidieuse mais nous avons constaté son emploi régulier jusqu’à la Seconde Guerre mondiale aux côtés d’autres expressions comme « Style 1900 » ou « Style Métro ».
En 1921, alors que la campagne des marbriers pour équiper les communes françaises en monuments aux morts de 14-18 ne faiblissait pas, les Marbreries générales dirigées par Urbain Gourdon, ont fait parvenir aux municipalités intéressées un échantillon de leur catalogue. À cet envoi étaient jointes deux recommandations d’architectes : une de Jean Boussard (1844-1923), l’autre de Guimard présenté comme « le célèbre architecte créateur du style qui porte son nom ».[32]
Au cours des années suivantes, en pleine éclosion du style bientôt appelé « Art Déco » (en référence à l’Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925) le ton a souvent été moqueur pour évoquer l’art décoratif du début de siècle. Pourtant certains journalistes plus clairvoyants que d’autres constataient dès 1925 que le « Style Guimard » avait tant marqué les esprits que l’expression était sur le point de passer à la postérité. Ainsi le journal L’œuvre féminine du 8 juillet 1925 dans un article sur l’exposition des rénovateurs de l’art appliqué au Musée Galliera observait que certains de ces artistes « toujours vivants, plus heureux que tous les autres, assistent aujourd’hui au triomphe de leur cause commune : celle par exemple de l’architecte Hector Guimard, qui, fortune appréciable, laissera son nom à un style ».
L’utilisation de l’expression a évolué enfin dans les années 1930 lorsque certaines autorités ont pris conscience de la nécessité de protéger quelques échantillons représentatifs d’œuvres du début du siècle. « Style Guimard » est alors devenu une des formules « officielles » pour désigner cette période.
Quelques années plus tard, l’expression connaissait un début de reconnaissance outre atlantique. Alfred Barr lui-même, brillant premier directeur du MOMA de New-York, conscient de la spécificité du langage plastique de Guimard a échangé avec la veuve de l’architecte, décédé quelques temps auparavant, certainement en vue d’une donation. Dans une lettre adressée à Adeline Oppenheim Guimard, il écrit : « ces pièces devraient être particulièrement significatives du Style Guimard » puis, citant en exemple une poignée d’ombrelle, il la décrit comme : « an excellent example of the Guimard’s Style at his best and purest »[33] résumant en quelques mots toute la force du style inventé par Guimard.
La période d’après la Seconde Guerre mondiale a été impitoyable pour l’Art nouveau. Dans un contexte de certitudes bien établies et de quasi-intolérance moutonnière, un pan entier du génie artistique humain a été englouti pendant deux à trois décennies. Même si l’histoire de sa redécouverte excède très largement le sujet de notre article, notons que l’expression « Style Guimard » ne s’est pas réimposée aussi facilement. Elle est entrée en concurrence avec les appellations que nous avons mentionnées plus haut (« Style 1900 » ou « Style Métro »), d’autres méprisantes comme « Style nouille » et même une appellation aussi saugrenue que « Style Jules Verne » qu’a proposée le commissaire-priseur Maurice Rheims, sans grand succès. On a aussi volontiers utilisé pour le caractériser les noms d’autres artistes emblématiques de ce style comme les nancéiens Gallé ou Majorelle dont les volumes de production les plaçaient aux premiers rangs du marché de l’art.
- Conclusion
Cette étude consacrée aux qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre peut paraître d’emblée anecdotique, mais elle est révélatrice de plusieurs traits de caractères de Guimard et de la façon dont ils ont interagi avec son environnement et le développement de sa carrière. La souplesse avec laquelle il a adopté telle ou telle qualification montre qu’il a réfléchi en permanence sur la perception et l’acceptation que le public pouvait avoir de son œuvre. Mais l’élection réitérée du terme « Style Guimard » montre à quel point l’architecte a désiré « sortir du lot » et obtenir la reconnaissance et l’ascension sociale que ne lui avaient pas procurés les canaux habituels du cursus académique. En faisant fi des conventions de l’époque, il n’a pas hésité à être aussi dérangeant par le coté formel de sa création que par sa façon de la qualifier.
Ces expressions ont cependant offert un angle d’attaque commode à tous ceux qui ne voulaient voir que l’étrangeté formelle ou la virtuosité de cette création et qui, sans chercher à comprendre la démarche créatrice de Guimard, davantage basée sur les propriétés des matériaux et la traduction de forces concourant à la structure des objets et des architectures, ont voulu faire croire qu’un même aspect tourmenté pouvait revêtir toutes sortes de produits quelles que soit leurs tailles, leurs matières ou leurs fonctions.
Frédéric Descouturelle et Olivier Pons
Notes :
[1] Siegfried Bing (Hambourg, 1838 – Vaucresson 1905) est un marchand d’art initialement spécialisé dans les arts de l’Extrême-Orient, collectionneur, critique d’art et éditeur de la revue Le Japon artistique.
[2] « Tout cela sent l’anglais vicieux, la juive morphinomane ou le belge roublard, ou une agréable salade de ces trois poisons ! » Alexandre, Arsène, Le Figaro, 28 décembre 1895.
[3] Boileau, Louis-Charles, L’Architecture, 19 décembre 1896.
[4] Contrairement à ceux qu’Horta utilise fréquemment pour habiller certains de ses décors intérieurs.
[5] L’Exposition Nationale de la Céramique et de tous les Arts du Feu se tient au Palais des Beaux-Arts sur le Champ-de-Mars du 15 mai au 31 juillet 1897 et sera prolongée jusqu’au 5 septembre.
[6] Eugène-Auguste Chevassus (1863-1931) dit Eugène Belville, peintre, décorateur et critique d’art. Il devient directeur de la revue l’Art Décoratif en 1907.
[7] Son existence est signalée par un court paragraphe paru dans Le Moniteur des Arts du 12 mai 1899.
[8] Papiers Adeline Oppenheim, The Public Library of New-York.
[9] Dessin GP 552 et GP 559, fonds Guimard, Musée d’Orsay.
[10] Georges Léopold Cochet (1872-1962) dit Pascal Forthuny, écrivain, critique d’art et musicien.
[11] Forthuny, Pascal, « Le Meuble à l’Exposition », Le Mois littéraire et pittoresque, décembre 1900, p. 701-704.
[12] Le vikado est un bois sombre importé d’Amérique du Sud qui a été utilisé par de nombreux ébénistes français entre 1900 et 1914.
[13] Vigne, Georges, Hector Guimard, éditions Charles Moreau, 2003, p. 111.
[14] La Vie Moderne, 1er semestre 1901.
[15] Guimard, Hector, « La Renaissance de l’art dans l’architecture moderne », Le Moniteur des Arts, 7 juillet 1899.
[16] Même si La Fronde est connu pour être entièrement administré et rédigé par des femmes, La Dame D. Voilée est l’un des noms de plume de Charles-Antoine Fournier (1835-1909), écrivain, critique d’art et collectionneur qui signe plus habituellement Jean Dolent. Pour l’anecdote, ce pseudonyme est une allusion (à peine voilée) à un épisode de l’Affaire Dreyfus, fin 1897, au cours duquel une mystérieuse dame voilée aurait remis à Esterhazy (le véritable espion au service de l’Allemagne) un document accablant pour Alfred Dreyfus. Les caricaturistes dreyfusards s’en donnèrent alors à cœur joie en représentant la dame voilée en question avec un pantalon et des éperons d’officier de cavalerie.
[17] De Felice, Roger, L’Art appliqué au Salon d’Automne, L’Art Décoratif, décembre 1903, p. 234.
[18] De Felice, Roger, L’Art appliqué au Salon d’Automne, L’Art Décoratif, décembre 1904, p. 134.
[19] Cornu, Paul, « L’Exposition des Artistes Décorateurs », Art et Décoration, 1907, p. 200.
[20] Louis-Étienne Baudier dit Baudier de Royaumont (1854-1918) est journaliste, directeur de publication, romancier et historien. Il sera le premier conservateur de la Maison de Balzac.
[21] Royaumont, « Art et Décoration », Revue Illustrée, 1907, p. 775.
[22] « Le Salon des Artistes Décorateurs au Musée des arts décoratifs/L’Art moderne », Journal de la Marbrerie et de l’Art décoratif, supplément au n° 101 du 5 janvier 1908 de la Revue Générale de la Construction.
[23] Marcel Bernhardt dit Alcanter de Brahm (1868-1942) a été un écrivain, un poète, et un critique d’art et deviendra conservateur adjoint du musée Carnavalet. Il est notamment connu pour avoir remis au goût du jour le point d’ironie (il n’en a pas été l’inventeur, comme on a pu le lire ici et là, ce mérite revenant à Marcellin Jobard, propriétaire du Courrier Belge qui l’a utilisé pour la première fois au début des années 1840). Nous publierons prochainement un article sur La Critique et Guimard, sujet sur lequel on a pu lire de charmantes inepties à tonalité mystico-ésotérique.
[24] La Critique, février 1909.
[25] L’Intransigeant du 25/02/1911.
[26] L’Intransigeant du 28/02/1913.
[27] On écrit aussi dans la presse : « le style Modern ».
[28] Plans des projets conservés au Cooper-Hewity museum, New-York. Sur le plan du premier projet de 1906, la rue est simplement désignée sous le nom de « rue nouvelle ». En novembre 1909, le nom du promoteur est la « Société Immobilière de la rue Moderne » et, sur les plans, la rue à créer est effectivement dénommée « Rue Moderne ». En avril 1911, alors que les immeubles sont construits, les plans font toujours référence à une « Rue Moderne ». À noter qu’il existe alors déjà une « avenue Moderne » dans le XIXe arrondissement qui est en fait une petite rue privée d’une vingtaine de mètres de long, ouverte depuis 1903, ainsi qu’une « villa Moderne » dans le XIVe arrondissement.
[29] La Construction Moderne, 10 novembre 1912 ; Dictionnaire historique des rues de Paris, p. 68. La rue prend le nom de scène de la comédienne Léonide Charvin qui habitait la maison mitoyenne à droite de l’hôtel Mezzara.
[30] Composé pour une bonne part d’anciens élèves de Charles Genuys, professeur d’Hector Guimard à l’École nationale des arts décoratifs, le Groupe des Architectes Modernes avait pour projet la construction d’un grand hôtel de voyageurs pour l’exposition de 1925, avant de se voir confier la réalisation du Village Français. Guimard en a construit la mairie ainsi qu’une tombe et une petite chapelle dans le cimetière jouxtant le village.
[31] Descouturelle, Frédéric, Les Fontes ornementales de l’architecte Hector Guimard produites à la fonderie de Saint-Dizier, mémoire de Master II, EPHE, sous la direction de Jean-François Belhoste, 2015.
[32] Le marbrier était installé 33, rue Poussin, dans le quartier d’Auteuil à Paris, soit à proximité des deux architectes, eux-mêmes à un jet de pierre l’un de l’autre (41 rue Ribéra et 122 avenue Mozart).
[33] Papiers Adeline Oppenheim, The Public Library of New-York.
Archives
- mars 2025
- février 2025
- janvier 2025
- décembre 2024
- novembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024
- août 2024
- juillet 2024
- juin 2024
- mai 2024
- avril 2024
- mars 2024
- février 2024
- janvier 2024
- décembre 2023
- novembre 2023
- octobre 2023
- septembre 2023
- juin 2023
- mai 2023
- avril 2023
- mars 2023
- février 2023
- janvier 2023
- décembre 2022
- novembre 2022
- octobre 2022
- septembre 2022
- août 2022
- juillet 2022
- juin 2022
- mai 2022
- avril 2022
- mars 2022
- février 2022
- décembre 2021
- novembre 2021
- octobre 2021
- septembre 2021
- août 2021
- juin 2021
- mai 2021
- avril 2021
- mars 2021
- février 2021
- janvier 2021
- décembre 2020
- novembre 2020
- octobre 2020
- septembre 2020
- juillet 2020
- juin 2020
- mai 2020
- avril 2020
- mars 2020
- février 2020
- janvier 2020
- décembre 2019
- novembre 2019
- octobre 2019
- septembre 2019
- août 2019
- juillet 2019
- juin 2019
- mai 2019
- avril 2019
- mars 2019
- février 2019
- janvier 2019
- novembre 2018
- octobre 2018
- septembre 2018
- juin 2018
- mai 2018
- mars 2018
- janvier 2018
- décembre 2017
- novembre 2017
- octobre 2017
- septembre 2017
- juin 2017
- mai 2017
- avril 2017
- mars 2017
- février 2017
- janvier 2017
- novembre 2016
- octobre 2016
- septembre 2016
- août 2016
- juin 2016
- mai 2016
- avril 2016
- février 2016
- janvier 2016
- novembre 2015
- octobre 2015
- septembre 2015
- août 2015
- juillet 2015
- juin 2015
- mars 2015
- février 2015
- décembre 2014
- novembre 2014
- août 2014
- juillet 2014
- juin 2014
- janvier 2014
- décembre 2013
- août 2013
- juillet 2013
- février 2013
- novembre 2012
- avril 2012
- août 2011
- février 2011
- octobre 2010
- août 2010
- juin 2010
- mai 2010
- novembre 2009
- juillet 2009
- avril 2009
- mars 2009
- janvier 2009
- novembre 2008
- mai 2008
- avril 2008
- février 2008
- octobre 2007
- août 2007
- juin 2007
- mai 2007
- février 2007
- décembre 2006
- octobre 2006
- avril 2006
- octobre 2005
- septembre 2005
- mai 2005
- mai 2004
- avril 2004
- mars 2004
