
De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients
La biographie d’Hector Guimard est lacunaire et, même en présence de documents, parfois non fiable. Les auteurs qui se sont intéressés à l’architecte ont tous souligné combien les relations entre le jeune Hector et ses parents étaient difficiles. Grâce à Mme Grivellé, le jeune Guimard a trouvé non seulement une famille d’accueil, mais aussi plus tard des clients : ce sera tout d’abord Mme Grivellé elle-même, puis Prosper, son fils et les amis et/ou voisins de ceux-ci.
Je souhaiterais apporter ici deux types d’informations factuelles qui, à ma connaissance, n’ont pas encore été mentionnées dans les travaux sur Hector Guimard. Tout d’abord, quelques données biographiques sur Mme Grivellé et ses proches et, ensuite, sur une possible parenté d’Hector Guimard avec Jules F. Guimard. Je proposerai aussi de reconsidérer la relation entre Hector et son frère René et apporterai quelques informations à propos de la sœur aînée d’Hector.
Lorsqu’en 1882 Hector Guimard est admis à quinze ans à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs, c’est Mme Grivellé qui lui sert de garant. Ceci est confirmé par une lettre d’Hector Guimard à Auguste Louvrier de Lajolais, Directeur de l’ENAD — École nationale des Arts Décoratifs — où il écrit : « J’étais entré dans votre école abandonné par mes parents, condamné à accepter la protection d’une parente avec celle d’amis».[1]
La relation de parenté précise entre Mme Grivellé et Hector reste floue. Si, pour certains auteurs d’articles ou de sites internet, Mme Grivellé est une parente proche (la tante)[2] d’Hector Guimard, elle est, pour d’autres, une simple amie de la mère d’Hector, c’est-à-dire Marie-Françoise Bailly, épouse de René Germain Guimard. Il vaut mieux faire confiance à l’épouse d’Hector, Adeline Guimard et considérer que Mme Grivellé était la marraine d’Hector.[3]
1.1. Quelques détails biographiques sur A. Grivellé et sa proche famille
Avant de décrire les relations entre certains proches d’Appolonie Grivellé, et afin de faciliter la lecture, il faut noter que le père et le second époux d’Apollonie ont, non seulement le même patronyme, à savoir « Grivellé », mais aussi le même (premier) prénom, à savoir Louis. Cette double homonymie rend parfois la lecture difficile.
1.1. Appolonie Grivellé (1838 – 1933) : ses parents et époux
Le père d’Appolonie Euphémie Grivellé, Louis Eléonore Grivellé, épouse Adèle Appolonie Gillette[4] le 8 septembre 1834 à Livry (Seine et Oise). De cette union naissent (au moins) une fille, Appolonie le 6 janvier 1838 et un fils, Gaston Eugène Arthur en 1847. Louis a une sœur Augustine Thaïs Grivellé, qui épouse le 15 mai 1830 Honoré Sellier. Augustine Grivellé Sellier et Honoré Sellier sont donc respectivement la tante paternelle et l’oncle par alliance d’Appolonie.
Louis Émile Sellier,[5] le frère d’Honoré alors âgé de 37 ans, épouse le 19 janvier 1858 à Paris, à la mairie du 2ème arrondissement Apollonie Euphémie Grivellé, âgée de 20 ans. Le mariage religieux a lieu en l’église Notre Dame de Lorette (actuel 9ème arrondissement). Louis Émile Sellier, propriétaire âgé de 48 ans, décède le 15 Novembre 1869 à Livry, après onze ans de mariage. Trois années plus tard, le 11 avril 1872, Apollonie épouse à 35 ans, en secondes noces, Louis Grivellé, employé de commerce, âgé de 24 ans à la mairie du 10ème arrondissement. De l’union entre Appolonie et Louis Grivellé naît le 28 août 1873, Gaston Prosper Grivellé au 38 rue Molitor, 16ème arrondissement. Lorsque Gaston Prosper est âgé de 3 ans et demi, son père, Louis Grivellé, décède le 15 mars 1877. À cette date, Appolonie est donc veuve pour la seconde fois : son nom d’épouse/veuve est le même que son nom de jeune fille.
Louis Grivellé, le second époux d’Apollonie, naît le 1er avril 1849 à Livry. Le père de Louis est Emmanuel Pierre Nicolas Grivellé et sa mère Élisa Victoire Lemaire. Lorsque Louis Grivellé décède à 28 ans en 1877 en son domicile, au 147 avenue de Versailles, Paris, 16ème arrondissement, Appolonie devient veuve pour la seconde fois et doit élever un fils en bas âge. Appolonie décède à Paris, 4 rue Léo Delisbes, 16ème arrondissement, le 10 janvier 1933 à 95 ans.
Les noms des témoins des mariages, des décès de Louis et Honoré Sellier, d’Appolonie et de Louis Grivellé et de la naissance de Gaston Prosper Grivellé nous permettent de brosser un tableau (au moins partiel) des relations familiales significatives pour Appolonie.

Adeline Oppenheim-Guimard, Portrait d’Appolonie Grivellé, 1915. Cliché du dessin original, graphite, crayon sur papier cartonné. Haut. 47 cm, larg. 35 cm. Signé A O Guimard. Cooper-Hewitt Museum, New York. Don de madame Guimard. Inv. 18411119. URL: http://cprhw.tt/o/2CmZ6/
1.2. Les proches d’Appolonie Grivellé : un oncle et un frère
Honoré Sellier, le frère du premier époux d’Appolonie, à savoir Louis Emile Sellier, épouse Augustine Thaïs Grivellé la tante (paternelle) d’Appolonie en 1830. Honoré Sellier naît le 12 juillet 1808 à Saint Soupplets[6] (Seine-et-Marne) et décède le 19 mars 1890 en son domicile 7 avenue du Rond-Point à Livry. Il est photographe de profession. Grand oncle paternel (par alliance) de Gaston Prosper Grivellé, il a été le témoin de la naissance de son petit neveu.
Le frère d’Appolonie, Gaston Eugène Arthur Grivellé est né le 26 septembre 1847 à Paris, 2ème arrondissement. En 1868 il est domicilié chez ses parents au 123 boulevard Magenta, Paris 10ème arrondissement. Le 6 juin il épouse Éléonide Joséphine Pachot à la mairie du 19ème arrondissement. Les époux Pachot-Grivellé résident tout d’abord 9 rue Curial à Paris, 19ème arrondissement. Le 23 décembre 1869, le jeune couple Pachot-Grivellé perd un enfant de six mois, né à Paris, 19ème arrondissement et décédé au Raincy, prénommé Eugène Prosper Georges. Gaston Eugène, 22 ans, est alors entrepreneur de maçonnerie. A 26 ans, lors de la naissance de son neveu Prosper Gaston le 28 août 1873, il se déclare rentier et domicilié 180 rue de Crimée, Paris 18ème arrondissement. En fait, il est associé avec son beau-père dans une entreprise de plâtres et briques, « Pachot, Pachot frères et Grivellé fils », laquelle est dissoute le 1er octobre 1875. A 29 ans, en 1877, Gaston Eugène est témoin du décès de son beau-frère Louis Grivellé : il exerce alors la profession de plâtrier à Villeneuve Saint-Georges (Seine et Oise, devenu département du Val-de-Marne, 94190).
Voici un aperçu des relations familiales d’Appolonie Euphémie Grivellé (1838-1933). Le signe « ½ » indique une relation de filiation, « & » une relation de mariage et « ? » une date inconnue. La date du mariage figure après « & ». « & (1) » signifie premier mariage et « & (2) » second mariage.

Appolonie, qui possédait des biens fonciers aussi bien à Livry qu’à Paris, a occupé différents domiciles parisiens. Je vais essayer de montrer comment les liens de voisinage tissés grâce à ces différentes résidences ont déterminé certaines commandes faites à Hector Guimard.
1.3. Les domiciles d’Appolonie et de Prosper Grivellé
Après la naissance de Gaston Prosper en 1873, le 147 avenue de Versailles, deviendra non seulement le domicile des époux Louis et Appolonie Grivellé récemment mariés, mais aussi celui d’Hector Guimard. Ce sera aussi l’adresse de différentes personnes dans l’entourage d’Hector. Dès 1882[8] ou au plus tard en 1885,[9] Hector, alors âgé de 15 ou de 18 ans, y demeure et ce jusqu’en 1893 : à 26 ans il s’installe dans un petit immeuble proche au 64 boulevard Exelmans. Très probablement, au même moment, les mère et fils Grivellé déménagent au 34 rue Boileau.[10] A la suite d’un différent entre Hector et ses parents, on peut penser qu’Apollonie avait intérêt à ce que son fils unique ait de la compagnie : en 1882 Gaston Prosper a neuf ans, alors que Hector en a quinze. On imagine donc la relation étroite entre les Grivellé (mère et fils) et l’encouragement qu’ils portèrent à l’émergence de la carrière d’Hector.
Quant à Gaston Prosper (1873-1947), il effectue de brillantes études secondaires à l’École Monge (qui deviendra le Lycée Carnot), puis des études de droit. En 1901, il obtient un doctorat[11] et devient avocat à la cour d’appel de Paris. On le trouve domicilié au 147 avenue de Versailles, au 34 rue Boileau, au 43 rue d’Auteuil lors de son mariage en 1903,[12] puis au 3 rue Goethe : toutes ces adresses étant dans le même arrondissement de Paris, le 16ème. Au moment de son décès, le 7 Décembre 1947, il est domicilié dans le 17ème arrondissement au 65 rue Pierre Demours.[13]
1.4. Le 147 avenue de Versailles et ses alentours
Mme Grivellé possédait depuis 1877[14] au 147 avenue de Versailles non seulement une maison d’un étage, mais aussi un vaste terrain composé de deux parties, séparées par la rue Téniers.[15] Côté Seine il donnait, sur le quai d’Auteuil (renommé quai Blériot plus tard, dont la numérotation actuelle ne correspond pas totalement à celle de 1890). Lorsque Prosper a seize ans environ, en 1888-89, Apollonie Grivellé demande à Hector Guimard de lui construire un restaurant café-concert Le Grand Neptune au 148 quai d’Auteuil. Il s’agit de la première commande faite à l’étudiant-architecte, âgé d’à peine 22 ans. Cette construction faite de bois et de céramique disparaîtra,[16] le terrain revenant à Prosper. En 1910, celui-ci commande un immeuble de rapport de sept étages à Hector, mais il renonce à ce projet en raison de problèmes de droits de voirie (24/6/1911). Il vendra alors le terrain à la Compagnie Parisienne de l’Air comprimé.[17]
Une autre demande de permis de construire sur une autre parcelle du 147 avenue de Versailles, présentée en 1910 par Hector Guimard pour le compte de Prosper Gaston est abandonnée. Le terrain sera plus tard acquis par la Société des tennis de Paris en 1928.[18]
De plus, à cette même adresse — 147 avenue de Versailles, Charles Camille Roszé (1840-1908) se dit domicilié dans les années 1890. Ce fabricant de gants était donc une connaissance proche des Grivellé. C. C. Roszé possédait un terrain 34 rue Boileau, sur lequel Hector Guimard édifie en 1891 un hôtel particulier, le premier qu’il ait construit, à l’âge de 24 ans. C.C. Roszé n’habitait pas ou bien habitait irrégulièrement cet hôtel particulier, car il résidait 8 rue du Caire, 2ème arrondissement. C’est Appolonie (et son fils) qui déclarent y habiter entre 1898 et 1905.[19] L’hôtel Roszé changera de propriétaire en 1905.[20]
La relation de proximité spatiale très proche entre les Grivellé, Hector Guimard et C. C. Roszé peut expliquer la commande passée par Roszé auprès d’Hector. Cette proposition me semble plus vraisemblable que l’hypothèse proposée par Vigne (ibid.: 32). Selon Vigne, Hector aurait pu être en relation avec C. Camille Roszé par l’intermédiaire du père et du frère d’Hector, qui tous deux s’occupaient d’orthopédie et d’hydrothérapie, car au 16 rue Boileau[21] se trouvait un établissement hydrothérapique. Les relations mauvaises ou distantes entre les parents Guimard et leur fils Hector donnent peu de crédit à cette hypothèse.
La proximité immédiate entre les numéros 34 et 38 de la rue Boileau explique que les propriétaires de ces lots (C. C. Roszé et Henri-Eugène Roucher, respectivement) aient choisi le même architecte, à savoir Guimard. Roucher (au 38 rue Boileau vers 1898) a dû être satisfait du travail de Guimard dans la même rue en 1891-1892.
Jouxtant le 147 est le 145 avenue de Versailles, qui se prolongeait alors jusqu’au 146 quai d’Auteuil. Hector Guimard construisit deux pavillons pour le compte de l’épicier et marchand de vins Alphonse Marie Hannequin[22] en 1891-1892, lesquels furent assez rapidement détruits, après la mort du commanditaire.
Enfin, l’épicier Louis Victor Jassedé, (1844-1928), pour qui Guimard avait construit en 1893 un intéressant hôtel particulier au 41 rue du Point-du-Jour (aujourd’hui rue Chardon-Lagache) se révèle également être un voisin. Il achète en effet deux terrains en diagonale du 147 avenue de Versailles, donc du côté pair. L ‘un est au 142[23] de l’avenue et au coin de la rue Lancret, l’autre donne uniquement sur la rue Lancret. Sur ces deux parcelles séparées par une cour, Hector construit en 1904-1905 deux immeubles de rapport, de style proche mais cependant différents. L’ensemble est appelé immeubles Jassedé.[24] Le premier témoigne d’une grande audace de courbes, d’une originalité forte dans les variations des tailles et des formes des balcons ainsi que dans l’utilisation de fontes ornementales de Saint-Dizier. L’autre, aux lignes droites, se remarque par l’utilisation de la pierre meulière jusqu’au premier étage.
Dans la suite, je chercherai à élucider une hypothétique relation familiale entre Hector Germain Guimard et Jules François Guimard, puis je fournirai quelques informations sur les relations familiales, d’une part, entre Hector et son frère (René) Paul et sa sœur Marie (Renée), et d’autre part, entre les grands parents Guimard et leurs petits enfants Marie, Hector et Paul.
2. Quelques détails biographiques sur Hector Germain Guimard et sa proche famille
2.1 Jules Guimard, un prétendu oncle d’Hector Guimard
Une relation de fratrie entre Germain René Guimard, père d’Hector, et Jules François Guimard a été suggérée par Vigne (ibid. : p. 38, 42) en raison de la proximité entre deux tombes aux noms de Guimard et de Jassedé sises au cimetière de Pougues-les-Eaux, Nièvre. Mention a été faite plus haut de deux villas réalisées par Hector Guimard pour le compte de deux cousins Jassédé. A Pougues-les-Eaux, Nièvre, un certain Jules Guimard tenait un hôtel avec son épouse Madeleine et son fils Léon Jules. Pour Vigne, Jules Guimard pourrait être « un oncle paternel d’Hector » (ibid. : p. 38). A mes yeux, cette parenté ne peut pas être établie puisque le père d’Hector Guimard n’est pas celui de Jules Guimard.
Le père d’Hector, Germain René Guimard (7 Septembre 1839 – 7 juin 1899) décède en son domicile 112 boulevard Malesherbes,[25] 17ème arrondissement. Né à Toucy (Yonne) en 1839, il est le fils de Nicolas Guimard, piéton[26] et de Françoise Rougelot. Avant son mariage à Lyon le 22 juin 1867 à la mairie du 2ème arrondissement, avec Marie Françoise Bailly, lingère,[27] née le 20 novembre 1839 à Lajarasse (Rhône), le couple Guimard avait eu deux enfants : une fille Marie Renée, née le 21 février 1866 et un fils Hector Germain, né le 10 mars 1867, tous deux à Lyon, 3ème arrondissement. Ces deux enfants seront reconnus en juin 1867, puis un troisième fils, René Paul, naîtra le 9 décembre 1870 à Lyon, 2ème arrondissement.
Jules François Guimard, né le 3 mai 1836, est un contemporain de Germain René Guimard, le père d’Hector : il n’est, cependant, ni le frère de Germain René ni, donc, l’oncle paternel d’Hector. En effet, Jules François Guimard (3 mai 1836 – 2 février 1926) est né à Dornecy dans la Nièvre. Ses père et mère sont respectivement Jean Baptiste Guimard et Françoise Trottet. Jules décède à Pougues-les-Eaux (Nièvre) au domicile de son fils en 1926 : il ne peut pas être le frère de Germain René, puisque celui-ci et Jules François n’ont pas les mêmes père et mère.
Jules Guimard avait épousé Madeleine Chabert, née à Chavroche dans l’Allier. Celle-ci décède à 61 ans à Pougues-les-Eaux le 15 Décembre 1904 au domicile conjugal, à savoir leur hôtel rue de Paris. Les père et mère de Madeleine Chabert sont François Chabert et Anne Bourzet.
Les époux Guimard-Chabert ont d’abord résidé dans l’Allier, puis à Pougues-les-Eaux. C’est à Villeneuve (Allier) que le 18 janvier 1861 naît de cette union un fils, Léon Jules Guimard.[28] Léon Jules décède à Pougues-les-Eaux, route de Paris, le 31 décembre 1955. Léon Jules n’est pas le cousin germain d’Hector Guimard.
2.2. Hector et son frère (René) Paul
Lors du décès des père et mère des enfants Guimard respectivement en Juin et en Décembre 1899, Vigne (ibid. : p. 21) note que le frère cadet d’Hector, (René) Paul s’occupe seul des formalités d’inhumations provisoire, puis définitive de leurs parents. De plus, Hector n’a pas dessiné la tombe de ses parents, alors qu’il en a dessiné de nombreuses autres.[29] Du fait de la non-coopération entre les deux frères Guimard lors du deuil de leurs parents, Vigne semble accréditer l’hypothèse d’une éventuelle mésentente entre les frères. S’il est certain que (René) Paul était beaucoup plus proche de ses parents qu’Hector tant affectivement que professionnellement, il se pourrait aussi qu’en 1900 les deux frères aient été, chacun de son côté, accaparé par de lourdes préoccupations professionnelles et/ou personnelles, ce qui expliquerait qu’ils aient différé l’inhumation de leurs parents dans un caveau définitif jusqu’au 11 août 1900. En effet, au début et au milieu de l’année 1900, Hector est pris par la commande des édicules du métro parisien, par les constructions ou l ‘aménagement intérieur des maisons Coilliot, H-E. Roucher, du Castel Henriette, de l’hôtel Roy, de la villa Canivet, de La Bluette… Quant à (René) Paul, il doit prendre la succession du cabinet médical de son père et préparer les formalités en vue de son mariage. Le 30 juillet 1900, âgé de 30 ans, il épouse Marguerite Mercier, âgée de 21 ans, à la mairie du 17ème arrondissement. Il s’occupe de l’inhumation de ses parents douze jours plus tard.
L’acte de mariage du couple Guimard-Mercier nous fournit deux informations intéressantes sur la famille Guimard. Les deux parents Guimard étant décédés, (René) Paul obtient le consentement de son aïeule maternelle — il s’agit de Jeanne Marie (Besson) Bailly, cf. note 26 : il affirme avec ses témoins « sous serment qu’ils ignorent le lieu du décès et le dernier domicile de ses aïeuls paternels et de son aïeul maternel ». Le père des frères Guimard avait donc perdu toute trace de ses parents, à savoir Nicolas Guimard et de Françoise (Rougelot) Guimard. Quant à Jeanne Bailly, la grand-mère maternelle des trois enfants Guimard, elle ignorait le destin et le dernier domicile de son époux.
On peut imaginer que les deux frères Guimard avaient en 1900 une relation alors suffisamment proche, puisque, outre trois autres témoins masculins,[30] Hector Guimard figure comme témoin au mariage de son frère : domicilié au Castel Béranger, 16 rue La Fontaine, l’architecte est alors âgé de 33 ans.
Paul prend la succession de l’établissement Institut médical hydrothérapique et orthopédique franco-suédois de son père, 112 boulevard Malesherbes. En 1901 il est promu Officier d’académie. En 1910 il fonde son propre institut au 24/26 rue de Chazelles, Paris 17ème. Grand et mince, une caricature de Mich,[31] parue dans L’Auto du 18/12/1913 le représente comme suit :

Paul Guimard, caricaturé par Mich. L’Auto, 18 décembre 1913.
En 1911 la presse américaine se fait l’écho du succès de cette entreprise et, en particulier, de la piscine (Natatorium), où les clients fortunés se baignent tout en dégustant du thé.[32]
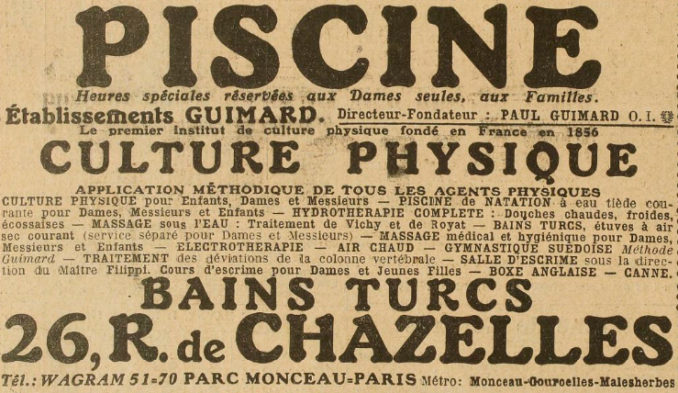
Annonce publicitaire du 26 rue de Chazelles parue dans L’Excelsior du 27 mars 1914.
Cette société au capital de 780.000 francs est mise en liquidation en mars 1920. Quatre ans plus tard Paul Guimard décède à Paris et reposera aux côtés de ses parents au cimetière parisien de Saint Ouen. L’entreprise de Paul a été reprise après son décès, comme le montre la photographie de cet établissement Le Palais de la Natation publiée dans Tout Paris de 1930.
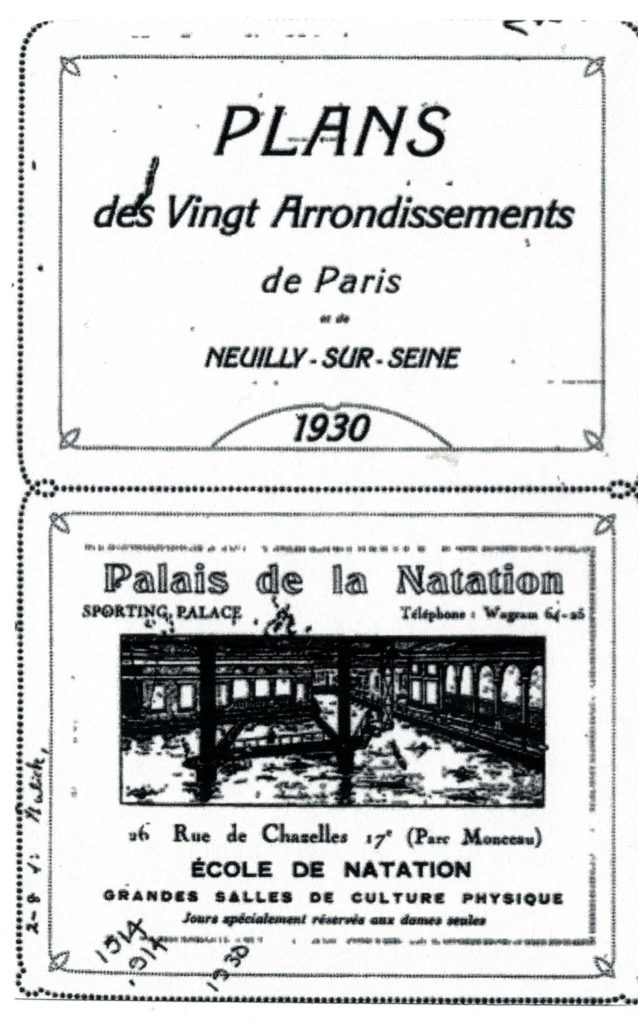
Annonce publicitaire du Palais de la Natation au 26 rue de Chazelles dans Tout Paris, 1930.
2.3. Hector et sa sœur Marie (Renée)
Le 21 février 1866 naît à Lyon (3ème arrondissement) Marie Renée Guimard le premier enfant du couple formé par Germain René Guimard et Marie Françoise Bailly. Les spécialistes d’Hector Guimard ne mentionnent que sa date de naissance, sans aucune autre précision. En 1886 Marie Renée est domiciliée chez ses parents, 13 rue Galvani, 17ème arrondissement. Le 5 janvier 1886 elle épouse Jules Louis Victor Colas, 27 ans, qui est employé de banque et dont les parents sont restaurateurs 158 rue Saint Charles, Paris, 15ème arrondissement. Mineure, Marie Renée obtient le consentement de ses parents, présents lors de la cérémonie de mariage à la mairie du 17ème arrondissement. Du côté de la mariée, joue le rôle de témoin un oncle maternel Cyprien Jean Marie Bailly, 42 ans, domicilié à Saint Symphorien sur Coise (Rhône). Cyprien est le frère de Marie Françoise Bailly, mère des trois enfants Guimard, alors âgée de 47 ans. Cyprien est menuisier, tout comme son père Etienne Bailly. On peut imaginer que le goût d’Hector Guimard pour les bois précieux et pour les formes audacieuses des meubles qu’il a dessinés se sont développées au contact des artisans du bois qu’il a vu œuvrer dans sa famille du côté maternel.
L’acte de mariage de Marie Renée nous permet de situer quelques domiciles du père d’Hector en région parisienne. René Germain Guimard, professeur de gymnastique a été domicilié 56 rue Chevalier à Levallois-Perret,[33] 13 rue Galvani et 112 boulevard Malesherbes, à Paris 17ème arrondissement. En 1886 seul Paul, le fils cadet de René Germain, habite avec ses parents.
Très vite après son mariage, Marie Renée quitte Paris pour Lyon avec son époux devenu professeur de gymnastique, comme son beau-père. Le couple aura cinq enfants en l’espace de dix ans. À notre connaissance, ni Hector ni Adeline ne semblent avoir entretenu de rapports avec leurs neveux et nièces lyonnais. Mais des informations supplémentaires paraîtront prochainement à ce sujet, grâce à Olivier Pons.
Marie-Claude PARIS
Références
CROSNIER-LECONTE, Marie-Laure, chapitre I, Les années d’études. 75-85. In Guimard, Paris, éditions de la Réunion des musées nationaux, p. 75-85, 1992.
GUIMARD, Paris, Musée d’Orsay, 13 avril – 26 juillet 1992, Lyon, Musée des Arts décoratifs et des tissus, 25 Septembre 1992 – 3 Janvier 1993, Paris, éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1992.
JOANNE, Paul, Paris, Sèvres, Saint-Cloud, Versailles, Saint-Germain, Fontainebleau, Saint-Denis, Chantilly : avec la liste des rues de Paris, Paris, Hachette, 1901.
LYONNET, Jean-Pierre, Bruno DUPONT & Laurent SULLY-JAMES, Guimard perdu. Histoire d’une méprise. Paris, éditions Alternatives, 2003.
THIEBAUT, Philippe, Guimard, L’Art nouveau, Paris, Gallimard/ Réunion des Musées Nationaux, 1992.
TOUT PARIS, Annuaire de la société parisienne, Publications La Fare, Paris, p. 1114, 1930.
VIGNE, Georges & FERRE, Felipe, Hector Guimard, Paris, éditions Charles Moreau et Ferré-éditions, 2003.
Notes
[1] Citée dans Thiébaut (1992 : p. 14) et Crosnier-Leconte (1992 : p. 84).
[2] Voir http://www2.archi.fr/CAUE92/c/2/mais31.htm. L’auteur de l’article considère que Mme Grivellé est la tante d’Hector Guimard.
[3] Adeline Oppenheim-Guimard, l’épouse d’Hector, a réalisé en 1915 un portrait au crayon de Mme Grivellé alors âgée de 77 ans. Appoline/Appolonie Grivellé est présentée de trois-quarts, ses cheveux noués en chignon. Ses yeux et son léger sourire sont malicieux. Adeline a exposé ce portrait (n° 15) à la galerie Lewis & Simmons du 12 au 27 Janvier 1922 à Paris. Le Cooper Hewitt Museum, New York, possède un cliché de ce dessin, qui figure ci-dessous. Les Archives of American Art (AAA) à Washington, D. C. possèdent trois clichés de ce même dessin. Au dos du premier, rien n’est écrit. Au dos du second, est écrit « Mme Laurent Oppenheim (Mrs Guimard’s mother) » et au dos du troisième « Mme Grivellé ».
Seule la troisième mention est valide. En effet, Mme Laurent Oppenheim est l’épouse de Laurent Oppenheim, le frère aîné d’Adeline (Oppenheim Guimard). Elle est donc la belle-sœur d’Adeline. Née le 10 juillet 1878 à Louisville, Kentucky, Mme Laurent Oppenheim avait pour nom de jeune fille Amy Schwartz. Elle décède à New York le 5 mai 1955. En 1915, Mme Laurent Oppenheim avait donc 37 ans, et non pas 77 (comme A. Grivellé).
Le troisième cliché des AAA est identique à celui du Cooper-Hewitt. L’identification de Mme Grivellé, comme étant la marraine d’Hector Guimard, ne fait donc pas doute.
[4] Adèle Appolonie Gillette, la mère d’Appolonie Grivellé, naît en 1815 et décède en 1869 à Livry, Seine et Oise (devenu Livry-Gargan, 93130).
[5] Né à Bondy. A la suite du décès de leur père Claude Honoré Sellier le 31 août 1823, les deux frères Sellier, alors mineurs, ont été placés en tutelle.
[6] Aujourd’hui 77165. Saint Soupplets est à une dizaine de kilomètres de Meaux.
[7] Dans les actes de naissance, de mariage et de décès de Prosper Grivellé, on lit non pas Appolonie, mais Appoline Grivellé. Il en va de même dans l’acte de mariage de Louis et Appoline Grivellé, le 11 avril 1872.
[8] Selon Thiébaut (ibid. : p. 14).
[9] Selon Vigne (2003 : p. 22).
[10] Dans le Bulletin de l’Association des dames françaises, de janvier 1894, section d’Auteuil, Mme Grivellé est domiciliée au 34 rue Boileau. Gaston Prosper figure à la même adresse dans la Revue de Touring Club de France.
[11] Intitulé « De la distinction des actes d’autorité et des actes de gestion ».
[12] Voir l’acte de mariage de G. P. Grivellé et de Marie Laure Elisabeth Trémois, 19 Mars 1903, mairie du 16ème arrondissement. Les Grivellé, les Trémois et Hector étaient en relation au moins depuis la naissance de Gaston Prosper. Ernest-Florimond Trémois (1851-1912), attaché à la Banque de France, résidait 34 boulevard Exelmans. En 1909-1910, il fait construire par Hector un immeuble de rapport de sept étages dont les balcons sont ornés de fontes de Guimard éditées à Saint-Dizier. Voir Vigne (ibid. : p. 274-280) pour différentes illustrations de ce superbe immeuble.
[13] Le décès est intervenu rue Pierre Larousse dans le 14ème arrondissement.
[14] Crosnier-Leconte (1992 : p. 84).
[15] Voir le cadastre de la Ville de Paris, Auteuil, 98ème feuille, PP/11808/E, 1860. Cette rue a disparu, voir le cadastre actuel, feuille 000 AH01.
[16] Suite à la crue de la Seine en 1910. De nombreuses photos de l’époque attestent que le quai d’Auteuil et le quai de Passy, l’avenue de Versailles, et la rue van Loo, parallèle à la rue Téniers, ont été inondées, cf. gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69134577.r=inondation+van+loo+agence+rol+1910.langFR ou gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6913351d.r= quai+d%27auteuil.langFR). Du viaduc d’Auteuil ont été déversés de nombreux déchets et ordures ménagères qui ne pouvaient plus être ramassés (ibid : ark:/12148/btv1b6913398t). Cette crue a probablement décidé Prosper Grivellé à utiliser les terrains qui avaient été inondés. Voir les photographies dans Lyonnet et al. (2003 : p. 29).
[17] Vigne (ibid. : 321). D’autres guinguettes que le Grand Neptune peuplaient le quai d’Auteuil, comme par exemple au 156, Le Grand Concert du cadran, cf. gallica.bnf.fr/ark:/ 12148/btv1b9005101m.
[18] Vigne (ibid. : 321). Si les deux commandes de Prosper en 1910 et en 1911 n’aboutissent pas, celle d’un pavillon à Sceaux vers 1911 a donné Le Chalet Blanc. Auparavant, en 1899, Prosper avait demandé à Hector de construire une villa de bord de mer à Hermanville-la Brêche/Lion-sur-mer (14880) La Bluette. Le terrain avait été acheté en deux temps par Mme A. Grivellé : un terrain pour la construction d’une demeure, puis un autre sur le front de mer. La Bluette a peut-être été construite en partie grâce à une somme de 6 000 F-or obtenue par les Grivellé pour la cession à la Ville de Paris de « la partie retranchable » du 147 avenue de Versailles à l’angle de la rue Teniers, cf. Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 17 Février 1899, page 74, délibération du 2/12/1898. Cette expropriation a permis l’alignement de l’avenue de Versailles.
[19] Ceci est en contradiction (partielle probablement) avec ce qu’atteste Prosper Grivellé lors de son mariage le 23 mars1903 à la mairie du 16ème arrondissement : il se dit alors domicilié avec sa mère 43 rue d’Auteuil. Appoline Grivellé a probablement quitté le 34 rue Boileau vers 1902 si l’on en croit Léopold Mar qui, dans le Bulletin de la Société historique d’Auteuil et de Passy d’octobre 1902, signale que Mme Grivellé vient quitter ce lieu. Les jeunes mariés Grivellé-Trémois ont, peut-être, occupé cette villa juste après leur mariage.
[20] Pour les plans et une photographie de cet hôtel particulier, voir Vigne & Ferré (2003 : p. 30-32).
[21] Le guide Joanne de 1901 mentionne un établissement hydrothérapique d’Auteuil (ancien établissement Béni-Barde) au 12 rue Boileau, avec une succursale 63 rue Miromesnil.
[22] En 1908 A.M. Hannequin et son épouse, qui résidaient 46 bis Avenue d’Orléans, ont élu domicile au 145 Avenue de Versailles/146 Quai D’Auteuil, Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris, 26 Septembre 1908.
[23] Le 142 d’aujourd’hui était le numéro 140 dans le cadastre de 1860.
[24] Cet ensemble est inscrit aux Monuments Historiques (1984/07/11). Pour des photographies de l’hôtel Jassedé, voir Thiébault (ibid. : p. 21), Vigne & Ferré (ibid. : p. 212-221). Cette commande donnera lieu à une autre au profit de Charles Jassedé, cousin de Louis, et résidant à Vanves (devenu Issy-les-Moulineaux). Pour des photographies de cette maison de campagne de 1893, voir Vigne & Ferré (ibid. : p. 42-43).
[25] Ce domicile est aussi un lieu de travail. Il s’agit d’un gymnase médical et orthopédique, situé dans le 17ème arrondissement, aujourd’hui à la station de métro Malesherbes. Dans le Guide Joanne de 1901, cette adresse figure à la rubrique des renseignements pratiques (p. XIV) sous le titre de « Le gymnase médical franco-suédois de M. Guimard ». À cette date, il était tenu par René Paul Guimard, le frère d’Hector.
[26] Selon l’état civil de Toucy en 1839, Nicolas Guimard était pâtissier.
[27] Marie Françoise Bailly est née de l’union d’Etienne Bailly avec Jeanne Marie Besson. Lorsqu’elle décède le 28 Décembre 1899, la mère d’Hector est veuve, car, son époux, le père d’Hector, était décédé six mois auparavant. En revanche, la grand-mère maternelle d’Hector, Jeanne Marie Bailly, alors âgée de 85 ans, était encore vivante à Coise (Rhône).
[28] Une publicité dans le Journal Le Gaulois du 4/08/1892, mentionne Le Grand Hôtel à Pougues-les-eaux. « En face le parc, le plus moderne de la station, près les bains, au centre des sources. Omnibus à tous les trains. Poste et télégraphe. Léon Guimard, ppre. »
[29] En 1900 Hector a déjà dessiné les tombes de Victor Rose, des Devos, de Mme Rouchdy Bey Pacha, des familles Obry-Jassedé, des Giron, Mirel et Gaillard, de Nelly Chaumier, de Ernest Caillat. Voir Vigne & Ferré (ibid.) et l’article du Cercle Guimard sur la tombe de Nelly Chaumier: //www.lecercleguimard.fr/fr/decouverte-dune-nouvelle-tombe-guimard-a-blere/
[30] Il s’agit de (i) Joseph Ribard, 40 ans, docteur en médecine, officier de l’Instruction Publique ; (ii) Pierre Gailhard, 51 ans, directeur de l’Académie Nationale de Musique (soit l’actuel Opéra de Paris), Chevalier de la Légion d’Honneur à Levallois, oncle ; (iii) Jean Dardignac, 51 ans, docteur en médecine, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier d’académie à Boulogne.
[31] Merci à Olivier Pons, qui m’a fourni cette caricature.
[32] The Washington Herald, dimanche 1er octobre 1911, p. 14. Notons que l’un des clients du Natatorium était Pierre Gailhard, oncle par alliance de Paul, voir note ci-dessus. Le Natatorium s’appellera aussi Palais de la natation.
[33] Vigne & Ferré (ibid.: p. 22).
Adhésion
En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !
Adhérer au Cercle Guimard
